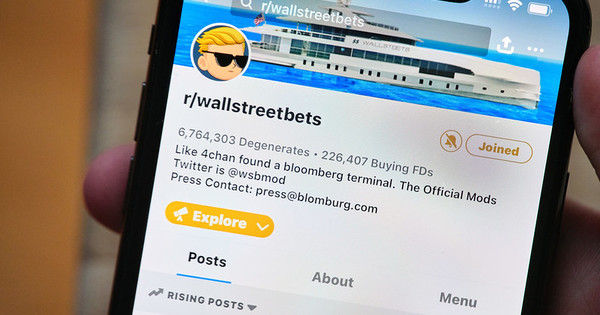Depuis 2017, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est dotée d’une « Stratégie d’investissement face au défi climatique » qui vise à réduire l’empreinte carbone des placements financiers de la Caisse. Pour ce faire, CDPQ tient un compte annuel des tonnes de gaz à effet de serre (GES) découlant de ses différents placements. En 2021, l’institution a annoncé s’être fixé un objectif de réduction de 60% entre 2017 et 2030, visant ainsi à passer de 79 tonnes GES par millions de dollars investis en 2017 à 32 tonnes GES/M$ en 2030. Étant donné que le portefeuille de la Caisse croît à raison d’environ 9% par année, cet horizon de réduction des GES par dollar investi peut-il suffire à abaisser la totalité des émissions associées au portefeuille de la Caisse?
Étiquette : investissement
Bientôt une éthique financière 360° pour la Caisse de dépôt et placement du Québec?
À la suite du dépôt du plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la décarbonisation des investissements financiers sera probablement remise à l’ordre du jour par bien des investisseurs institutionnels soucieux de respecter l’éthique de leur clientèle et de leurs membres. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) poursuivra peut-être sa lancée en réduisant ses investissements dans le gaz et les pipelines. Cet exercice ne devrait cependant pas se restreindre à la dimension environnementale et aurait intérêt, pour garantir le caractère éthique des décisions financières prises par cette société publique qui gère l’épargne-retraite du quart des Québécois·es, inclure des critères sociaux.
« l’ascenseur est brisé : prenez la fusée »
Investir 70 millions de plus au stade du parc Jarry ?
L’ouverture des Internationaux de tennis du Canada nous donne l’occasion de rappeler que Tennis Canada demande à tous les ordres de gouvernement un appui de 70 millions afin de doter le stade IGA, situé au cœur du parc Jarry, d’un toit rétractable. Alors que, depuis 1996, les investissements pour la mise en place du stade totalisent 53,4 millions (dont plus de 41,1 millions provenant de fonds publics) et que la Ville de Montréal alloue environ 1,7 million annuellement à Tennis Canada pour son entretien, cette nouvelle dépense est-elle justifiable ?
L’innovation n’est pas magique
À écouter le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, l’innovation technologique et la recherche et le développement (R-D) sont systématiquement les voies à suivre pour soutenir ou transformer l’économie canadienne. En effet, son plus récent budget comprend 262 mentions du terme « innovation ». Mettons ce choix en contexte.
La Banque du Canada vient d’annoncer que l’État pouvait avoir un effet positif sur l’économie
Depuis la crise économique, la tendance à la mode a été l’austérité. On dépense le moins possible pour éviter tout déficit, considéré comme le pire démon. Le problème avec cette stratégie – s’est-on entêté de répéter à l’IRIS et ailleurs – est qu’elle prive l’économie d’une intervention qui lui serait secourable et favorise la stagnation. Cette stagnation se concrétise par une faible création d’emplois, par un secteur privé morose et par un secteur public en gestion de crise constante. C’est un mauvais moment à passer nous dit-on, il ne faut pas réinvestir maintenant, c’est trop précaire, la croissance est en train de revenir, lentement mais surement.
Ces mythes fiscaux qui ne s’en vont pas
Au début du mois de février, la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke a publié son rapport sur le bilan fiscal du Québec. Le rapport, co-signé par Luc Godbout, revient sur des enjeux chers à ce dernier et qui se retrouvent dans plusieurs de ses publications : l’utilisation plus importante que les autres pays de l’OCDE des impôts sur le revenu par le Québec juxtaposée au recours moins imposant aux taxes à la consommation et cotisations sociales. À la lumière de ce nouveau rapport, et donc de certaines nouvelles données, j’aimerais déboulonner certains mythes dominants dans l’espace public sur la fiscalité, soit 1) le façon dont le Québec traite ses riches sur le plan fiscal et 2) le lien entre l’imposition des sociétés et compétitivité.
Confondre innovation et éducation
Hier, Robert Gagné et son équipe du Centre sur la productivité et la prospérité y sont allés de la 7e édition de leur bilan sur la productivité au Québec. Comme chaque année, le même verdict fatal tombe: le Québec n’est pas assez productif.
7 milliards ça fait beaucoup
Sortir de la crise a un coût. Pour les femmes du Québec, celui-ci s’est élevé à près de 7 milliards $ de 2008 à aujourd’hui. Et ce n’est qu’une partie de l’histoire… Commençons par le début.
En 2008, le Québec, comme la plupart des États occidentaux, a connu une crise économique que plusieurs affirment être la plus sévère depuis le fameux crash boursier de 1929. Pendant deux ans, le gouvernement s’est autorisé à faire des déficits. Par contre, une fois la (maigre) croissance de retour, les politiques d’austérité se sont pointées le bout du nez. Il faut croire que le chant du déficit zéro a été trop séduisant. Bien que de nouvelles dépenses continuaient d’être annoncées, la part du lion des annonces gouvernementales concernait plutôt des compressions. Au total, c’est plus de 23 milliards $ qui ont été coupés de l’économie québécoise par les mesures d’austérité. Et de ce montant, 13 milliards $ ont touché plus particulièrement les femmes, soit 3 milliards $ de plus que les hommes.
Le coût du capital

Dans l’univers du management, la tendance est au contrôle et au resserrement des coûts du travail. Au nom de la compétitivité des entreprises ou des États, une pression permanente s’est installée avec comme objectifs toujours les mêmes cibles : revoir à la baisse des niveaux de rémunération jugés exorbitants, défaire les filets de protection sociale à la charge des employeurs, flexibiliser les liens d’emploi, etc. Cette obstination masque pourtant une autre réalité, soit que l’un des principaux freins à la compétitivité des entreprises des pays dits développés n’est pas tant un coût du travail trop élevé, mais bien le coût du capital.
Dans une récente étude réalisée par le Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ), une équipe de chercheur.e.s a étudié l’évolution de ce que l’on peut appeler le coût économique et le coût financier de tout investissement afin d’éclairer l’évolution du poids de la rente financière sur les économies avancées. Bien que l’étude s’intéresse spécifiquement au cas français, ses conclusions nous permettent de mieux comprendre la place grandissante que prend cette rente par rapport à l’économie productive.