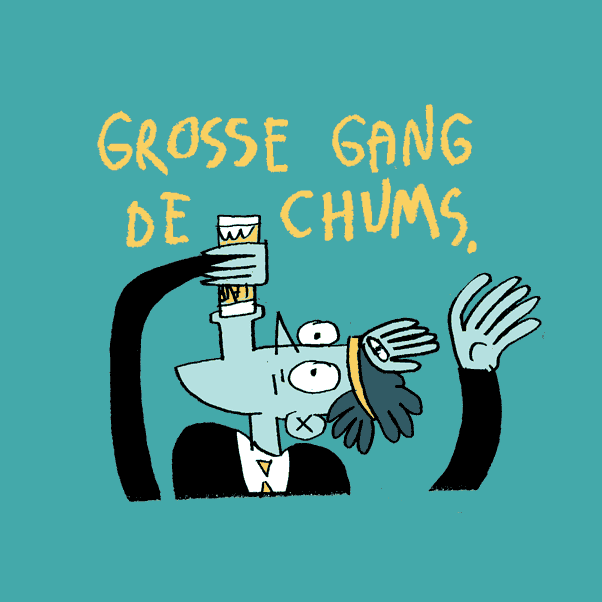Sophie Yanow consulte sa boule de cristal à propos de la face cachée de la mondialisation.
Catégorie : International et libre-échange
Nous dirigeons-nous vers la fin de la pauvreté?
Au printemps dernier, le réputé magazine The Economist faisait sa « une » avec une affirmation saisissante : nous serions mondialement en voie de mettre fin à la pauvreté. De 1990 à 2010, près d’un milliard de personnes seraient passées au-dessus du salaire de 1,25$ par jour. Ce montant est reconnu comme le seuil de l’extrême pauvreté.
Comment aurions-nous collectivement réussi cette réduction de la pauvreté? D’abord, par la croissance des économies en voie de développement, en particulier la Chine et ensuite, par les mesures qui réduisent les inégalités. Pour The Economist, la solution à la pauvreté est donc simple : laissons faire le marché, réduisons l’intervention de l’État et signons des accords de libre-échange. Bref, continuons comme nous l’avons fait, ça nous a si bien servi jusqu’à maintenant.
Libre-échange avec l’Europe : des médicaments plus chers
En début de semaine, j’écrivais sur le peu d’attention donnée à l’Accord de libre-échange que le Canada a signé avec l’Union européenne et qui attend sa ratification. Une étude publiée aujourd’hui par nos collègues du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) montre comment cet accord mènera à une hausse du coût des médicaments.
Même si les négociations ont été tenues en secret et que le texte de l’accord demeure inaccessible aux citoyennes et citoyens, certains éléments ont filtré. Ainsi, nous savons qu’il :
Panne globale de David McNally : petit cours d’autodéfense contre le capitalisme et le néolibéralisme

Si bien des gens voient dans l’économie une science obscure et un domaine réservé aux expert.e.s, c’est en partie parce que le discours économique dominant cultive souvent l’incompréhension en se faisant hermétique et hyperspécialisé. Rendre les processus économiques intelligibles au plus grand nombre, dans le but éventuel de les transformer, est une tâche à laquelle s’attèle cependant contre vents et marées d’irréductibles Gaulois.e.s de la pensée. Avec son essai Global Slump, dont la traduction française vient de paraître aux éditions Écosociété et qui sera lancée ce vendredi à Montréal, David McNally, professeur de science politique à l’Université York, participe admirablement à cet effort.
Dans Panne globale, McNally analyse la crise financière de 2008 comme un nouvel épisode de la « période d’expansion néolibérale » du capitalisme. Le néolibéralisme désigne la stratégie déployée depuis quarante ans par les élites économiques et politiques afin de combattre le pouvoir acquis de chaudes luttes par les salarié.e.s et ainsi les déposséder des fruits de leur travail. À grand renfort d’exemples tirés aux quatre coins du globe, l’auteur montre que depuis les années 1970, la croissance de nos économies s’est faite aux dépens des travailleuses et des travailleurs des pays riches, et a été rendue possible par la création d’une main-d’œuvre précaire dans les pays de la périphérie – la Chine étant évidemment un pôle fondamental de cette nouvelle organisation de la production à l’échelle mondiale.
Sacrifier notre fromage pour nous protéger des Talibans?
En ces temps d’islamisation accélérée du Québec, on ne peut pas demander au gouvernement de tout faire. Bien entendu, dans un monde idéal, il s’inquièterait des conséquences de l’oléoduc à travers lequel Enbridge transportera du pétrole sale à travers le Québec et il cesserait aussi l’austérité budgétaire qui s’avère contre-productive tant d’un point de vue économique que des services à la population.
Mais, il faut savoir prioriser. C’est ainsi que le gouvernement s’est engagé dans la lutte aux signes religieux dans la fonction publique et que cette offensive occupe désormais une place prépondérante dans les débats de société.
La Chine, la croissance et le taux de croissance

De nombreux articles ont paru récemment sur l'inquiétude face au «ralentissement» de la croissance du PIB en Chine. On pouvait par exemple lire dans cet article que la croissance de 7,7% du PIB en 2012 était «la plus faible croissance enregistrée par la Chine depuis 13 ans», et que la «faible» croissance de 7,5 % au premier trimestre jetait des doutes quant aux possibilités de la Chine de maintenir son taux de croissance au dessus de 7 %.
L'objet de ce billet n'est pas de discuter des bienfaits ou des horreurs liés à cette croissance, ni de l'imprécision des données chinoises, mais de tenter d'illustrer que le discours sur la croissance et les taux de croissance peut donner des mauvais signaux de la situation.
Conjoncture économique mondiale : Êtes-vous optimiste ou pessimiste?

La question de la Syrie a monopolisé l’attention lors de la rencontre des chefs d’État du G-20 à St-Petersbourg les 5 et 6 septembre 2013. Ces rencontres sont aussi l’occasion de faire le point sur l’état de l’économie mondiale. À ce sujet, tant des points de vue optimistes que pessimistes ont été exprimés. Faisons un tour d’horizon des éléments qui caractérisent actuellement cette conjoncture économique globale.
Certain.e.s sont donc optimistes, comme on peut le lire dans cet article du Globe and Mail. Cet enthousiasme repose sur plusieurs nouvelles venues des États-Unis dont l’augmentation de 2% annualisé de la consommation, l’augmentation de 12,1% de la valeur des maisons sur un an ainsi que le taux de chômage à 7,3%, le niveau le plus bas de l’après-récession. Les auteurs soulignent aussi le taux d’endettement des ménages le plus faible en une décennie, à 90% du revenu disponible (à titre comparatif, le niveau d’endettement des ménages canadiens oscille au-delà de 160%).
Chine : les pièges urbains

On entend souvent parler de la Chine ces temps-ci, en particulier à propos de sa croissance qui perd de son lustre. En général, on présente les ennuis de la Chine comme des fatalités de son développement économique : en plus de la crise récente, cette baisse de croissance viendrait naturellement avec une augmentation des salaires et l’apparition d’une classe moyenne. Des articles récents nous permettent de dépasser, cette première interprétation et de nous concentrer sur deux problèmes surtout liés à l’urbanisation.
Les migrant.e.s et les hukou
Comme partout, le développement de la Chine se construit à coup de migrations, particulièrement d’exode rural. Passer de la campagne à la ville est le geste premier pour s’intégrer dans l’économie productive. On parle ici de 263 millions de personnes qui ont procédé à cette migration. C'est 20% de la population totale du pays, mais c’est aussi l'équivalent de huit fois la population canadienne.
L’« assistencialisme » brésilien et la désolidarisation

« Aujourd’hui au Rio Grande do Sul, ça va mal en termes de campements. Que s’est-il passé? Le gouvernement a donné le Bolsa Familia aux gens qui étaient en ville et plus personne n’a voulu venir aux campements. On ne réussit plus à mobiliser. Les gens se contentent de cela. »
Ce constat est celui d’une sans-terre brésilienne que j’ai interviewée au début de l’année 2013 dans le sud du Brésil. Après des dizaines d’entrevues et de nombreuses visites dans des communautés sans-terre, force est de réaliser que ce constat est généralisable dans le mouvement. Fort de ses 29 ans d’existence, le Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (MST) au Brésil constitue l’emblème d’un mouvement social des plus influents et des mieux organisés sur les scènes nationale et internationale. Entre 1984 et 2010, à travers des luttes politiques acharnées, le MST et d’autres mouvements sans-terre ont réussi à exiger la redistribution de plusieurs milliers d’hectares de terre à environ 1 million de familles paysannes, et ce, dans un pays où 1% de la population détient 46% des terres.
Avec des centaines de coopératives de production agraire – qui constituent dans certains cas de véritables éco-villages prospères économiquement –, 1,9 millier d’associations de production sur tout le territoire brésilien et 1,5 millions de personnes sous leur bannière, dont environ 15 000 militants.es très actifs, le MST est devenu un modèle d’organisation et de mobilisation sociale. En effet, en terme d’efficacité de production agricole, de subsistance de ses membres et, surtout, de la capacité à édifier des formes d’organisations sociales basées sur la coopération et la solidarité comme principes moteurs de ses communautés, le MST constitue un mouvement politique unique en son genre.
Gaz de schiste : le « chapitre 11 » s’en mêle

Tant au Québec qu’aux États-Unis, les pouvoirs publics légifèrent de façon à protéger les populations des risques liés à l’industrie du schiste. Ces précautions pourraient toutefois se heurter à une disposition controversée de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) : le fameux chapitre 11 sur le droit des investisseurs.
Aux États-Unis, le Bureau of Land Management (BLM) est l’agence du Département de l’Intérieur qui gère l’ensemble des terrains publics du pays et dont la mission consiste à préserver la santé, la richesse de la diversité et la productivité des terres. Récemment, le BLM a recommandé au gouvernement étasunien de cesser l’octroi de baux d’exploitation d’huile de schiste à des fins commerciales. L’Agence propose plutôt à la Maison-Blanche de s’en tenir à l’extraction d’huile de schiste à des fins de recherche et de développement. Étant donné les risques environnementaux élevés et l’incertitude liée à la fiabilité technologique entourant ce type de développement, le BLM privilégie une limitation des risques.
Revoir les avantages fiscaux consentis aux entreprises
Dans notre régime fiscal, il est possible de diminuer son revenu imposable à l’aide de multiples mesures, allant des exemptions et remboursements de taxes, aux déductions, crédits et autres reports d’impôt.
Une petite dose du poison grec, peut-être?
Benjamin Coriat et Christopher Lantenois, deux économistes membre du Collectif des économistes atterrés, ont récemment publié la deuxième partie d’une étude sur la crise grecque.