Le coefficient panier passe de l’IRIS à Statistique Canada
7 mai 2025
Lecture
6min
Depuis le 1er mai 2025, Statistique Canada publie deux nouveaux tableaux de données issus de travaux de recherche initiés par l’IRIS: le coefficient panier et la décomposition du revenu en fonction de la mesure du panier de consommation (MPC). Grâce à ces nouvelles données, disponible à partir de 2015 et pour chaque province canadienne, il est possible d’approfondir nos connaissances sur la distribution des revenus, l’écart entre les riches et les pauvres, le manque à gagner pour combler les besoins des plus démunis et plus encore.
Il faut remonter à 2016 pour trouver l’origine de ces indicateurs, alors que Vivian Labrie et Simon Tremblay-Pepin publiaient à l’IRIS une note portant sur le déficit humain, soit l’argent qui manque aux personnes dans la pauvreté pour atteindre un seuil de couverture minimale des besoins. Le concept était à la fois simple et inédit. En partant des données de 2011 pour le revenu disponible et les seuils de la MPC, qui varient selon la taille des ménages et l’endroit où ils habitent, ils étaient en mesure de comptabiliser l’écart positif et négatif pour chaque ménage. Ce travail les mène à la conclusion que l’argent qui manquait aux plus pauvres entre 2002 et 2011 était plus que largement compensé par l’augmentation des revenus des plus riches. En effet, alors qu’il manquait près de 30G$ pour que les ménages du premier décile puissent combler leurs besoins de base, le décile le plus riche avait des revenus qui excédaient ceux du neuvième décile de plus de 135 G$ sur la même période. En d’autres mots, le revenu excédentaire des 10% les plus riches pouvait compenser le manque de revenu des 10% les plus pauvres et encore laisser dans les poches de ces ménages fortunés plus de 100G$ de revenu de plus que le deuxième décile le plus riche (décile 9).
À la suite de ce travail, Labrie et Tremblay-Pepin publient en 2020 avec Mathieu Dufour une mise à jour de ces chiffres en étudiant la période de 2012 à 2017 et en profitent une fois de plus pour innover en introduisant un nouvel indicateur, soit celui du coefficient panier. Ce dernier permet d’exprimer les revenus des ménages en paniers de consommation équivalents en prenant en considération le nombre de personnes dans le ménage et leur lieu de résidence. Ce calcul donne une meilleure idée du niveau de couverture des besoins pour chaque type de ménage. Par exemple, un revenu de 100 000$ ne permet pas la même qualité de vie selon que l’on habite seul ou dans un ménage de 8 personnes. Ainsi, les données qu’ils ont produites ont permis de voir que les 10% des ménages les plus riches ont, en moyenne, 9 fois la capacité de consommation des 10% les plus pauvres. Bien que leur situation se soit légèrement améliorée entre 2012 et 2017, les plus démunis peinent encore à atteindre le seuil de la MPC alors que les plus riches ont vu leur situation s’améliorer de manière plus significative.
Cet indice panier est ensuite repris en 2021 pour faire une comparaison avec le reste du Canada. Les résultats sont frappants: s’il est vrai que les plus riches du Québec gagnent l’équivalent de moins de paniers de consommation que ceux du reste du Canada, c’est le contraire pour les 20% les plus pauvres qui s’en tirent mieux au Québec qu’ailleurs.
Ce travail d’abord effectué à l’IRIS a poussé Labrie, Tremblay-Pepin et Dufour à publier un article dans une revue scientifique. Au fil des années, de nombreuses rencontres et recherches ont eu lieu afin d’approfondir la compréhension de ces indicateurs et de développer la meilleure façon de les rendre disponibles.
Puis il y a quelques jours, Statistique Canada a annoncé qu’il reprenait ses indicateurs à son compte. Voici les constats que l’on a pu faire jusqu’ici à partir de ces nouveaux tableaux de données.
Dans le graphique 1, le nombre de paniers par personne a été mis en base 100 afin d’illustrer l’évolution pour chaque décile. On constate ainsi qu’entre 2015 et 2019, les variations sont assez mineures, mais que la situation économique des 10% les plus pauvres, et dans une moindre mesure pour le 10% suivant, s’est largement améliorée pour les deux provinces en 2020 et 2021. Le nombre équivalent de paniers pour les plus riches a aussi augmenté pendant la période, ce qui permet de dire que l’enrichissement des plus pauvres ne s’est pas fait au détriment de celui des plus riches. Toutefois, dès 2022, on observe un certain retour à la normale, soit une réduction de la capacité du décile inférieur à combler ses besoins. En 2023, ces derniers s’en tirent mieux qu’en 2019 au Québec, mais sont dans une situation de plus grande précarité en Ontario.
Regardons maintenant comment la situation a évolué au Québec, décile par décile depuis 2015. Pour les fins de la comparaison, nous prendrons les années 2015 (la première disponible), 2020 (celle où on voit la plus grande augmentation) et 2023 (la plus récente). La hausse du coefficient panier en 2020 est généralisée. Tous les déciles en ont bénéficié, mais ce sont les déciles les plus bas qui ont connu la plus forte croissance relative. Dans le cas du décile inférieur, on parle d’une augmentation record de 50% entre 2015 et 2020. Toutefois, en terme réel, c’est le décile supérieur qui a gagné le plus, en voyant ses revenus augmenter d’un demi-panier par personne, soit le double de la hausse du premier décile (environ un quart de panier de plus par personne). Cette situation, qui s’explique entre autres par les programmes de soutien au revenu en temps de pandémie, n’a été que temporaire pour la grande majorité des ménages. En 2023, on observe en effet une baisse pour tous les déciles, à l’exception du décile supérieur. Alors que le décile inférieur avait connu la hausse la plus importante en 2020, c’est également celui qui a connu la baisse la plus forte dans les années suivantes. En fait, plus les ménages sont dans un décile élevé (donc plus leurs revenus sont élevés), moins la diminution est importante par rapport à 2020, jusqu’à devenir nulle pour les plus riches.
Dans le cadre de cet article, nous nous sommes limités à analyser (rapidement) un seul des deux nouveaux tableaux publiés par Statistique Canada. Au vu de la richesse de la série de données que nous venons d’explorer, il est certain que cet autre tableau sera aussi d’une grande utilité pour mettre au jour les inégalités de revenus, l’effet des mécanismes de redistribution sur les ménages et la marge de manœuvre dont disposent (ou pas) les ménages pour répondre à leurs besoins. Après des années à travailler à faire connaître et reconnaître ces indicateurs, on ne peut que se réjouir de les voir gagner en notoriété grâce à leur intégration aux tableaux de données de Statistique Canada. Nous sommes impatient·e·s de voir comment ils seront utilisés, et ce qu’ils permettront de révéler. De notre côté, on a déjà hâte de s’y replonger!

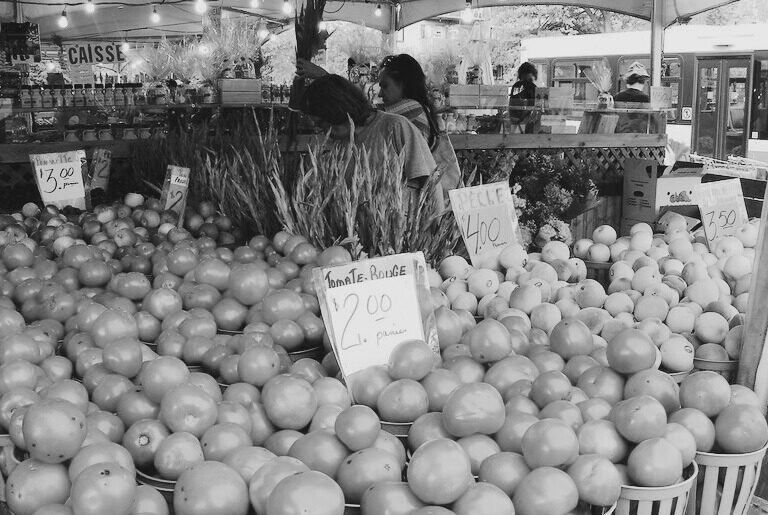
Bravo aux chercheurs de l’IRIS. Cet institut démontre encore une fois la qualité et la pertinence des recherches pour mieux comprendre les réalités de la répartition de la richesse et par conséquent des inégalités. Merci pour votre professionnalisme. Je doute que l’Institut Économique de Montréal puisse en faire autant et ce, avec toute l’objectivité que cela exige.
Le concept de la taxe nuit toujours plus aux moins nantis tant que l’accès aux biens premiers n’est pas garanti pour tous avec un revenu minimum de 43,000$ par années au Québec.
Or, avec un salaire minimum à 16.50$/de l’heure ça donne 33,000$ par année de revenu. C’est 21.50$ de l’heure que ça prend.
Pourquoi un revenu au salaire minimum doit payer des taxes?
Pourquoi quelqu’un qui gagne plus de 250,000$ par année ne paye pas 50% d’impôt ou plus pour ce qui dépasse?
Pourquoi les entreprises sont moins taxées que les citoyens?
Pourquoi les entreprises ont plus d’échappatoires fiscaux que les citoyens alors même que leurs profits sortent du pays?
Les entreprises ont pris le contrôle de nos gouvernements depuis bien plus qu’un siècle et les lois les avantages presque exclusivement.
POUR PLUS D’EQUITE SALARIALE
Constat
Selon moi, le meilleur moyen d’améliorer l’équité entre les citoyens et de diminuer l’écart
entre les salariés riches et pauvres serait d’abolir le principe d’augmentation salariale au pourcentage ;
on comprend bien que 2 % pour un cadre à 80 K$/an correspond à 5 % de hausse pour un travailleur à 32 K$/an
et pour rencontrer les besoins de la vie, je pense que les moins bien payés et les plus jeunes
qui ont de plus lourdes charges à défrayer, qui ont des familles, de jeunes enfants et une maison ou un logement à payer
ont plus de besoins que le quinquagénaire ou sexagénaire dont les enfants sont autonomes ou ont déménagé
et dont la résidence entièrement payée.
Solution
Présumons simplement qu’une entreprise compte 40 travailleurs dont le salaire moyen est de 40 K$/an
et 5 cadres qui gagnent en moyenne 80 K$/an pour une masse salariale totale de 2 M$/an.
Alors, on accordera des hausses à la semaine ou à l’heure, pour faciliter le calcul
on supposera que l’entreprise est prospère et décide de consacrer 45 K$
pour les hausses de ses 45 employés ce qui fera 1000 $ à chacun
pour environ 2000 heures reconnus travaillées, soit environ 50¢ de l’heure.
Ce régime donnera 2,5 % aux travailleurs débutants et 1,25 % aux mieux payés.
Sans inclure les avantages sociaux et de leurs couts, on sait que la hausse indexée aux couts de la vie [IPC]
coutera 40 K$ à l’entreprise si on a établi avec les employés un principe d’équité sociale
pour aider tous les travailleurs à maintenir leur pouvoir d’achat, à payer la hausse régulière de l’IPC de leurs factures,
que les plus méritants pourraient changer de classe d’emploi
ou auraient accès un régime de bonus aux performances exceptionnelle.
***
Résultat
Si ce principe s’applique sur un contrat de travail de 5 ans les employés seront à 45 K$ et les cadres à 85 K$
ce qui diminue progressivement l’écart de hausses qui était 2 fois qui est maintenant 1,88 fois .
Les 15 plus méritants pourront se partager 5 K$ au mérite exceptionnel chaque année.
***
On pourrait aussi choisir un autre moyen : soit de calculer le salaire moyens de tous les travailleurs touchés,
Si on présume, 100 travailleurs dont le salaire va de 40 K$ à 90 K$ / an, que la moyenne s’établit à 60 K$
ensuite appliquer des hausses à l’IPC à ce salaire moyen qui s’appliquera à tous ces employés salariés…
ainsi 5 % de 60,000 $ serait 3000 $ pour 2200 heures payées annuellement incluant vacances et congés fériés.
découlant de ce mode ; les plus jeunes et les moins payés auront plus [7,5 %] et les plus anciens (3 % ) n‘ayant pas plus
de responsabilité recevront des augmentations indexées mais moins élevées que les plus jeunes faisant le même travail.
***
De plus, je pense que ce principe devrait s’appliquer au salaire minimum
Qui devrait être augmenté de 50 ¢ de l’heure travaillée
Au moins, jusqu’à l’atteinte du 20 $ de l’heure dans environ 5 ans
pour ensuite refaire une évaluation selon les indices des hausses de l’IPC et du seuil de pauvreté.
Je pense que ce moyen pourrait aussi contribuer à améliorer l’indice de natalité ;
En effet les jeunes couples ayant un meilleur pouvoir d’achat pourront choisir d’avoir des enfants plus tôt
et même décider de dépasser 2 enfants par famille pour diminuer la pénurie de man d’œuvre.
L’autre point est d’implanter au Québec ou au Canada un régime de rémunération comme au Japon et ailleurs ;
ne JAMAIS payer incluant les bonus et autres avantages, les pdg et chefs de direction, plus de 50 fois le salaire moyen
des travailleurs de l’entreprise qu’ils possèdent ou gèrent. ( ici c’est 200 et même 280 fois )
Bravo à Simon, Viviane et Mathieu et à vous tous de l’Iris.
Une bonne nouvelle pour la compréhension de la situation réelle des ménage à faible revenu. Une reconnaissance de vos travaux qui mérite d’être soulignée.
Félicitations!
Félicitations! c’est en effet une superbe réussite que Statistiques Canada l’adopte !!!!
Ravi pour cette influence sur Statistiques Canada