Lutter contre le gaspillage alimentaire par le don des invendus : retombées et recommandations pour Montréal
28 octobre 2025
Table des matières
Introduction
La présente étude explore les bénéfices et les défis associés à la mise en place de mesures législatives et réglementaires qui obligent ou incitent fortement les industries, commerces et institutions (ICI) à donner leurs invendus à des organismes d’aide alimentaire.
Le premier chapitre explique brièvement comment le gaspillage alimentaire s’est imposé comme enjeu public dans les dernières années. Il se penche sur l’évolution des mesures prises par les États pour s’attaquer à ce problème. Il présente ensuite les grandes lignes de la démarche réglementaire mise en branle à Montréal en vue de réduire le gaspillage alimentaire.
Le chapitre 2 s’intéresse aux exemples internationaux de législation obligeant les entreprises et institutions à donner leurs surplus alimentaires. À travers la présentation des cas français, new-yorkais et californien, on voit que ce type de mesure a mené à une augmentation importante de la quantité de nourriture récupérée. On voit aussi qu’en raison de leur succès, les lois sur le gaspillage alimentaire ont été progressivement étendues. Par ailleurs, le chapitre met en lumière l’importance d’accompagner et de soutenir les organismes de récupération alimentaire pour maximiser les retombées positives de la réglementation.
À partir de données de collecte obtenues auprès de trois organismes, le chapitre 3 évalue le potentiel de récupération alimentaire à Montréal. Les données, ventilées par catégorie d’établissement alimentaire, permettent de voir que les épiceries, les dépanneurs et les boulangeries constituent les trois principaux « gisements » de denrées comestibles récupérables. L’analyse montre aussi combien de repas pourraient être sauvés et quelle quantité de gaz à effet de serre (GES) pourrait être évitée si davantage de nourriture était récupérée.
Enfin, le chapitre 4 s’intéresse aux enjeux vécus par les donateurs potentiels et par les organismes d’aide alimentaire. Il se conclut par une série de recommandations visant à répondre aux préoccupations exprimées par ces acteurs en mettant en place les éléments de base d’un réseau de collecte décentralisé qui renforce les capacités logistiques de récupération alimentaire tout en assurant une forte coordination locale.
CHAPITRE 1 Un enjeu public de plus en plus important
1.1 L’ampleur du problème
En 2011, une étude sur le gaspillage alimentaire publiée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a eu un important retentissement. Le rapport de recherche établissait qu’environ le tiers de la nourriture produite dans le monde était perdue ou gaspillée1. Par la suite, plusieurs chercheurs et chercheuses ont tenté de préciser ce constat en calculant la quantité de nourriture gaspillée dans leurs pays respectifs. Une étude publiée en 2019 par l’organisme Deuxième Récolte soutenait que près de 60 % de la nourriture produite pour les Canadien·ne·s était perdue ou gaspillée, et que le tiers de cette nourriture pourrait être récupéré pour l’alimentation humaine2. Lors d’une mise à jour récente, le même organisme a évalué que le taux de pertes et gaspillage avait diminué à 46,5 % de la nourriture produite, mais que la part de nourriture potentiellement récupérable avait augmenté à 41,7 % de ces pertes et gaspillage3. Au Québec, la plus importante étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaires a été publiée par Recyc-Québec en 2022. Elle conclut que les aliments perdus et gaspillés représentent 41,3 % du tonnage de denrées qui entrent dans le système alimentaire québécois. Les aliments comestibles représentent 39 % de ces résidus4.
Lorsqu’un aliment qui aurait pu être mangé se retrouve au site d’enfouissement, il dégage du méthane, un puissant GES. Ce n’est toutefois que la dernière d’une longue série de conséquences environnementales néfastes du gaspillage alimentaire. Pour bien saisir l’ampleur du problème, il importe de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie des aliments. À chaque étape, des champs à l’assiette, il a fallu utiliser de l’énergie, de l’eau, des terres arables, des ressources matérielles (engrais, bâtiments, plastique, métaux, etc.) et de la main-d’œuvre pour produire, transformer, emballer, transporter, distribuer, mettre en vente et cuisiner les aliments. Quand un aliment comestible est jeté, ce sont toutes ces ressources et tout ce travail qui sont perdus ou utilisés en vain.
Le gaspillage alimentaire contribue aussi à la hausse du prix des aliments5. Pour les entreprises, le gaspillage alimentaire représente des coûts inutiles ou des pertes de revenus qui ont pour effet de réduire les marges de profit, à moins qu’ils soient compensés par des hausses de prix. Dans le contexte actuel d’augmentation de l’insécurité alimentaire6, une action coordonnée contre le gaspillage semble particulièrement avisée, d’autant plus qu’il paraît insensé que des aliments comestibles soient jetés aux poubelles alors que des familles peinent à s’acheter les denrées dont elles ont besoin.
Depuis une quinzaine d’années, le problème du gaspillage alimentaire occupe de plus en plus de place dans le débat public de nombreux pays. À titre d’exemple, le nombre d’articles de presse sur le sujet est passé de 7 en 2007 à entre 1 600 et 3 000 par année entre 2013 et 2021 en France, tandis qu’il a connu une hausse de 564 articles en 2007 à 3 101 en 2021 aux États-Unis7. La plupart des acteurs du système alimentaire reconnaissent la nécessité d’agir contre le gaspillage alimentaire, bien qu’il y ait des désaccords sur les manières de s’y prendre et sur la part de responsabilité de chacun8.
Graphique 1
La pyramide inversée de la réduction du gaspillage alimentaire
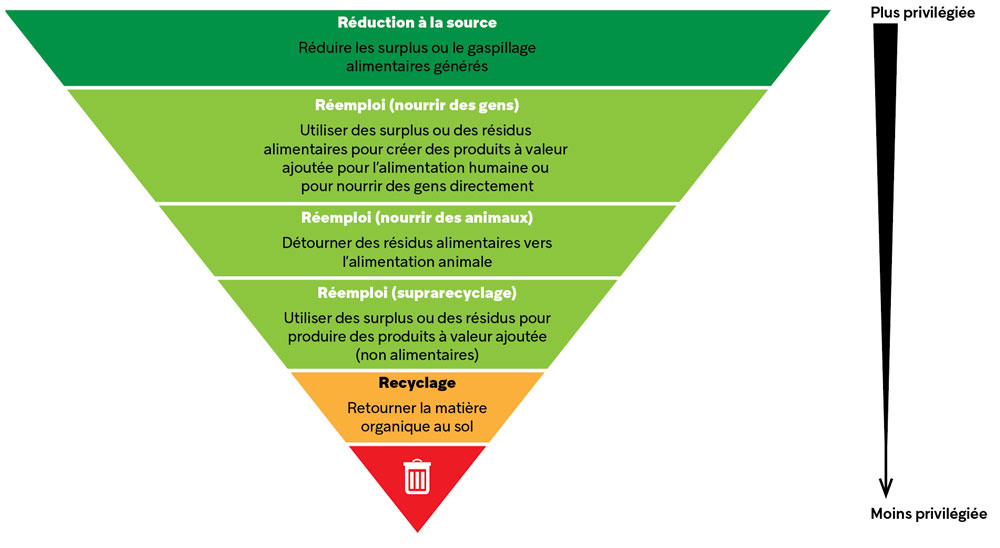
Une représentation de l’enjeu du gaspillage alimentaire fait toutefois largement consensus dans la littérature scientifique et dans les politiques publiques de divers pays : la pyramide inversée de la réduction du gaspillage. Sous une forme ou une autre, avec des variations mineures, elle est reprise dans la plupart des rapports de recherche sur le sujet et a été intégrée aux obligations législatives ou réglementaires dans certains territoires. Cette pyramide stipule que la réduction du gaspillage alimentaire doit privilégier la prévention, c’est-à-dire la réduction à la source (éviter la création de surplus alimentaires) d’abord et avant tout. Si la génération de surplus ne peut être évitée, ceux-ci doivent dans un premier temps être redistribués vers l’alimentation humaine et, dans un deuxième temps, vers l’alimentation animale. Les aliments qui ne peuvent être récupérés doivent être traités en favorisant en ordre d’importance la digestion anaérobie (production de biogaz par la méthanisation), le compostage et l’incinération avec récupération d’énergie. Enfin, seule une petite partie des résidus alimentaires devrait être envoyée aux sites d’enfouissement.
1.2 Les limites de l’approche volontaire
Durant les années 2010, en parallèle avec la visibilité croissante de l’enjeu du gaspillage alimentaire dans l’espace public, on a assisté à la mise en place dans différents pays d’instances consacrées, comme le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en France (2013) et le « Zero Food Waste Forum » aux États-Unis (2014)9. Ces instances rassemblent des acteurs de la chaîne alimentaire à titre volontaire et les incitent à s’engager pour réduire le gaspillage. Elles ont contribué à la mise en place d’une multitude d’initiatives, dont le lancement de campagnes de sensibilisation qui ont fait connaître le problème, mais qui ont aussi permis à certaines entreprises de se déresponsabiliser en ciblant principalement les comportements individuels des consommateurs et des consommatrices10.
Or, le gaspillage et les pertes surviennent tout au long de la chaîne alimentaire : selon la plus récente étude de Deuxième Récolte sur le gaspillage alimentaire au Canada, seuls 17 % du gaspillage d’aliments comestibles auraient lieu à la maison, tandis que 32 % sont associés à la fabrication/transformation, et 20 % à la vente au détail et aux hôtels, restaurants et institutions (HRI) combinés11. Par ailleurs, même lorsque le gaspillage a lieu au sein des ménages, il peut être influencé par des facteurs externes, dont le marketing qui encourage la surconsommation12.
De plus, alors que l’approche volontaire suppose une participation active des acteurs concernés, des chercheurs et des chercheuses ont émis des doutes sur la capacité de l’industrie agroalimentaire à s’autoréglementer. Des recherches ont montré, par exemple, que les supermarchés pouvaient sous-estimer la quantité de nourriture jetée13, ou encore qu’il pouvait y avoir un écart significatif entre les discours de réduction adoptés par les compagnies et les pratiques effectivement mises en place14.
Un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, la prise de conscience de l’importance du gaspillage alimentaire a mené à la prolifération de projets – à but lucratif ou non – visant à réduire le gaspillage ou à faciliter la redistribution d’aliments qui auraient été gaspillés autrement. Quoique ces projets aient généralement des retombées positives, leur multiplication a entraîné des défis de coordination et de planification, soulevant parfois des tensions entre les initiatives récentes et des organisations déjà établies15. Par ailleurs, des observateurs et observatrices notent qu’en raison de leur taille, les projets de lutte contre le gaspillage ont souvent des effets limités et ne suffisent pas à régler le problème, qui nécessite une action soutenue de la part des administrations publiques ainsi qu’un changement d’échelle pour s’y attaquer de manière globale16.
1.3 Le tournant législatif
Ces considérations sur les limites de l’approche volontaire ont contribué à un changement de stratégie de la part de plusieurs États, qui se tournent vers l’intervention législative et réglementaire depuis quelques années. À cet égard, la France a fait office de pionnière en devenant le premier pays à se doter d’une loi spécifique sur le gaspillage alimentaire au niveau national17. En 2016, l’Assemblée nationale française a adopté la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Celle-ci inscrit la pyramide du gaspillage alimentaire dans la législation, interdit de rendre intentionnellement des aliments impropres à la consommation humaine et oblige les supermarchés de plus de 400 m² à proposer des conventions de don à des associations d’aide alimentaire18.
La même année, l’Italie a adopté la loi Gadda, qui prévoit un ensemble de mesures pour lutter contre le gaspillage et favoriser la redistribution des invendus alimentaires. Comme on le verra, plusieurs autres pays, États, régions ou villes se sont dotés de moyens législatifs ou réglementaires pour s’attaquer au gaspillage alimentaire. Même dans les pays comme le Royaume-Uni et la Norvège, qui misent surtout sur la concertation avec le secteur privé et qui n’ont pas adopté de loi nationale sur le gaspillage alimentaire, il y a une tendance à favoriser davantage l’intervention étatique et la régulation gouvernementale19.
Les mesures adoptées par la France ont eu un écho important dans les médias et dans les sphères qui s’intéressent à l’enjeu du gaspillage alimentaire. Elles ont notamment eu une influence directe sur les propositions réglementaires mises en œuvre en Californie et dans l’État de New York, qui seront décrites ci-dessous.
1.4 La démarche réglementaire montréalaise
À l’heure actuelle, il n’existe pas de loi québécoise portant spécifiquement sur le gaspillage alimentaire, bien que deux projets de loi en ce sens aient été déposés par deux députés de l’opposition, en 2023 et en 202420. Tout comme l’approche française, les deux projets de loi suggèrent d’obliger les établissements alimentaires à proposer des ententes de don à des organismes d’aide alimentaire. Ces projets de loi n’ont cependant pas été adoptés. Au niveau fédéral, un projet de loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire la quantité d’aliments gaspillés au Canada a été déposé par une députée de l’opposition en 2023, mais il n’a pas été adopté21.
À Montréal, une démarche de réflexion et d’action au sujet du gaspillage alimentaire a été enclenchée en 2019 lorsque des citoyen·ne·s ont lancé une pétition qui a obtenu les 15 000 signatures requises pour forcer la tenue d’une consultation publique, en vertu du droit d’initiative prévu par la Charte montréalaise des droits et responsabilités. En s’inspirant notamment du modèle français, les pétitionnaires demandaient à la Ville de « se dote[r] de mesures (changements réglementaires, plan d’action, incitatifs, etc.) répondant aux meilleures pratiques, afin qu’il n’y ait plus de gaspillage et de destruction d’aliments encore propres à la consommation par les commerces, institutions et industries22 ». La consultation publique a eu lieu de décembre 2020 à février 2021, puis la commission responsable a remis son rapport en avril 2021. Ce dernier présente les conséquences environnementales, économiques et sociales du gaspillage alimentaire, ainsi que certaines initiatives de réduction du gaspillage, et émet des recommandations, dont celle-ci :
Mettre en place une réglementation effective d’ici 2025 qui aura pour effet de rendre obligatoire, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, la conclusion d’une entente de redistribution des invendus encore propres à la consommation avec un organisme reconnu pour les secteurs du commerce de détail et de la restauration, en débutant par le secteur de la grande distribution et de l’hôtellerie23.
Inciter ou contraindre les ICI à donner leurs aliments non servis ou non vendus à des organismes communautaires est l’action prioritaire qui a été mentionnée le plus souvent par les participant·e·s à la consultation publique24. Des donateurs et des récupérateurs potentiels ont cependant émis des préoccupations liées notamment aux coûts et à la charge de travail que cette recommandation implique.
Pour favoriser l’augmentation des dons de surplus alimentaires tout en apaisant les craintes exprimées, la Ville de Montréal a mandaté la Maison de l’innovation sociale (MIS) pour élaborer des propositions de règlement en partenariat avec les acteurs du système alimentaire montréalais25. Cette démarche de consultation, qui comprenait des ateliers, a débouché sur les propositions suivantes :
1.L’obligation de tri, obligeant certains établissements à trier leurs denrées retirées de la vente ou non consommées afin d’en maintenir le maximum dans les circuits pour l’alimentation humaine, notamment par le don.
2.La déclaration obligatoire, obligeant certains établissements à déclarer les quantités d’aliments et de résidus alimentaires envoyés au compostage (ou à la biométhanisation) et à l’enfouissement26.
Les deux mesures visent environ 1 700 établissements, soit l’ensemble des détaillants-restaurateurs, des entrepôts-distributeurs et des transformateurs ayant un niveau d’activité « grand et très grand » selon la catégorisation effectuée par la Division de l’inspection des aliments (DIA) de la Ville de Montréal, qui agit à titre de mandataire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)27. La première mesure prévoit l’obligation pour les donateurs de mettre en place un plan de gestion de la qualité du don et de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire 28, ainsi que l’obligation pour les récupérateurs de tenir un registre mensuel de dons par générateur. Il est envisagé que la réglementation soit éventuellement étendue à l’ensemble des établissements alimentaires.
La présente étude est complémentaire de la démarche lancée par la MIS et la Ville de Montréal puisqu’elle permet de mieux cerner les répercussions de l’éventuelle réglementation. En premier lieu, nous analysons comment d’autres administrations ont mis en œuvre des règlements visant à redistribuer les invendus et quelles ont été les retombées de ces efforts. Nous évaluons ensuite le potentiel de récupération alimentaire de Montréal selon la taille des établissements et selon les secteurs. Enfin, nous proposons des recommandations pour assurer la bonne mise en œuvre de règlements favorisant le don des surplus alimentaires.
CHAPITRE 2 Les exemples internationaux
Dans ce chapitre, nous présentons les principaux exemples internationaux d’administrations publiques qui ont adopté des dispositions législatives obligeant certains établissements alimentaires à donner leurs invendus à des organismes d’aide alimentaire. Nous nous penchons principalement sur les modalités choisies par les États concernés et sur les effets qu’ont eus les mesures adoptées.
2.1 Les exemples européens
À l’échelle internationale, les objectifs de développement durable de l’ONU, adoptés en 2015, proposent de réduire le gaspillage alimentaire de moitié d’ici 203029. En 2023, prenant acte de cet objectif, la Commission européenne a adopté une directive qui oblige les États membres de l’Union européenne à réduire de 30 % le gaspillage alimentaire dans le commerce de détail et dans les ménages, ainsi qu’à réduire de 10 % le gaspillage alimentaire dans les secteurs de la fabrication et de la transformation30.
2.1.1Le modèle français
La France a précédé l’initiative européenne en mettant en place dès 2016 une loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « loi Garot », du nom du ministre responsable. En plus d’interdire la destruction de denrées encore consommables et d’établir une hiérarchie de la réduction du gaspillage qui privilégie la prévention et l’utilisation des invendus pour l’alimentation humaine, cette loi oblige les commerces de détail alimentaires de plus de 400 m² à conclure avec une ou plusieurs associations caritatives habilitées une convention qui précise les modalités du don de leurs invendus alimentaires31.
La mesure parfois décrite comme une « obligation de donner » prend donc concrètement la forme d’une obligation de signer une entente avec un organisme d’aide alimentaire reconnu. Le gouvernement français propose des conventions types dont les acteurs concernés peuvent s’inspirer32, mais la loi ne prévoit pas d’exigences précises concernant, par exemple, le volume, la nature ou la fréquence des dons. Les dispositions réglementaires stipulent que les associations récipiendaires peuvent refuser le don en tout ou en partie si elles n’ont pas les capacités logistiques pour le prendre en charge ou si les denrées sont jugées impropres à la consommation. Les commerces qui font plus de 10 000 euros de dons peuvent bénéficier de réductions d’impôt correspondant au coût de revient des denrées33. La loi Garot prévoit des amendes en cas de non-respect, mais celles-ci sont rarement appliquées34.
Une première évaluation de la loi de 2016 a été menée en 2019 par deux parlementaires, soit Guillaume Garot, l’instigateur de celle-ci, et Graziella Melchior35. Il et elle ont interrogé des acteurs du système alimentaire français (à la fois du milieu communautaire et du secteur privé), qui ont unanimement souligné que la loi avait eu un effet structurant pour la lutte anti-gaspillage. La plupart ont estimé que la loi de 2016 avait contribué à une prise de conscience collective de la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. Sur le plan quantitatif, les Banques Alimentaires ont constaté une hausse de 23 % des dons entre 2015 et 2018, tandis que les Restos du cœur (une importante organisation française de lutte contre la pauvreté) ont constaté une hausse de 24 % des dons d’invendus alimentaires entre 2016 et 2018. Près de 95 % des magasins interrogés ont dit pratiquer le don. Les personnes interrogées ont cependant critiqué le manque de contrôle effectif des pratiques répréhensibles et des dons qui sont parfois de mauvaise qualité. Ce dernier phénomène est en partie attribuable aux applications anti-gaspillage comme Too Good To Go, qui offrent des produits en fin de vie à rabais, ce qui retarde le moment où ils sont livrés aux organismes d’aide alimentaire.
Une autre évaluation menée en 2019 a aussi constaté les retombées largement positives de la loi36. Celle-ci a facilité la création de partenariats entre les entreprises et les organismes d’aide alimentaire. Les conventions de don ont d’ailleurs permis de clarifier les rôles des partenaires en fournissant un cadre qui établit certains éléments clés de la récupération alimentaire, comme la fréquence des collectes pour chaque association ou encore la durée du partenariat entre donateur et récupérateur, ce qui a réduit la compétition entre les associations d’aide alimentaire. Le nombre de compagnies qui font des dons a augmenté considérablement depuis la mise en œuvre de la loi. Les organismes bénéficiaires ont aussi enregistré une hausse importante de la quantité d’aliments donnés. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les organismes dont l’aide alimentaire est une activité parmi d’autres, qui ont vu leurs dons bondir et qui ont donc pu renforcer ce créneau, tandis que les organismes dont la récupération alimentaire était déjà la mission principale (comme les banques alimentaires) ont connu une hausse plus modeste. La loi a aussi favorisé une diversification des dons alimentaires, qui s’est traduite par une augmentation de la proportion de produits frais, particulièrement les fruits et légumes. Les personnes sondées ont souligné que la loi avait accru la visibilité de l’enjeu du gaspillage alimentaire auprès du grand public. Comme Melchior et Garot, les auteurs et autrices de l’étude ont toutefois noté que la qualité des dons laissait parfois à désirer. Ils et elles ont aussi constaté que, par manque de bénévoles et de capacités logistiques, les organismes ne parvenaient pas toujours à récupérer la totalité des invendus. Plusieurs des recommandations proposées dans le rapport – pour améliorer la qualité des dons et pour élargir la loi Garot à d’autres secteurs – ont été mises en œuvre par les élu·e·s français·e·s.
En effet, en raison de son succès et pour tenir compte de certains défis rencontrés en cours de route, la loi Garot a été étendue à plusieurs reprises par l’adoption de nouvelles lois qui en ont augmenté la portée et ont instauré des mesures additionnelles de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, l’obligation de proposer une convention de don a été progressivement appliquée aux plus grandes cantines et cafétérias (un secteur très important en France), aux plus gros joueurs de l’industrie agroalimentaire et enfin aux grossistes. De plus, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (« loi EGalim », 2018) a introduit l’obligation pour les restaurateurs de proposer à leur clientèle des contenants pour emporter les restes. Cette loi a ensuite été modifiée pour obliger les entreprises et institutions visées par la loi Garot à mettre en place un plan de gestion de la qualité du don prévoyant la formation et la sensibilisation du personnel. De surcroît, la loi EGalim a introduit l’exigence de poser un diagnostic anti-gaspillage alimentaire. Puis, en 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (« loi AGEC ») a renforcé les sanctions en cas de non-respect des dispositions anti-gaspillage, a introduit des procédures de contrôle et de suivi de la qualité du don et a créé un label anti-gaspillage pouvant être accordé à toute personne contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire37.
Bien que la qualité des dons demeure un problème récurrent selon les associations concernées38, la loi Garot a eu un effet positif en contribuant à l’expansion du système français de récupération alimentaire, comme le souligne le président de la banque alimentaire de Paris et d’Île-de-France dans une récente entrevue-bilan :
Cette loi a joué un rôle de catalyseur pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et, par voie de conséquence, sur l’aide alimentaire. Elle a permis d’apporter une source plus régulière de dons, avec le monde de la grande distribution. Elle a été vraiment importante pour faire face à tous les besoins de l’aide alimentaire39.
2.1.2La Belgique
Bien que l’exemple français ait été beaucoup plus médiatisé, entre autres parce que la France a eu la première loi nationale sur le sujet, c’est en Belgique que les premières expériences d’obligation de don des invendus alimentaires ont eu lieu. Dès 2012, la petite ville wallonne de Herstal a imposé aux grandes surfaces locales d’offrir leurs invendus aux associations d’aide aux plus démuni·e·s40. Constatant le succès de cette initiative, le parlement wallon l’a étendue à l’ensemble de la région de la Wallonie en 2014. Cependant, l’obligation de don des invendus ne concerne que les supermarchés de plus de 2500 m2. De plus, les commerces ne doivent se soumettre à cette obligation que lorsqu’ils renouvellent leur permis d’environnement, un permis renouvelable seulement aux 15 ans41. En théorie, un établissement qui aurait renouvelé son permis en 2013, un an avant l’apparition de la nouvelle réglementation, n’aurait donc pas à s’y conformer avant 2028.
Dans ce contexte, les organismes d’aide alimentaire wallons déplorent que trop peu d’entreprises soient obligées de donner leurs denrées non vendues42. Ils dénoncent aussi la piètre qualité des dons reçus. Ces constats les poussent à revendiquer des améliorations législatives et réglementaires qui permettraient à la Wallonie de suivre la voie française. Faisant face à une diminution des quantités de denrées collectées et à une augmentation des demandes d’aide alimentaire, la Fédération des services sociaux demande que l’obligation de don soit appliquée aux entreprises de la transformation et de la distribution alimentaire ainsi qu’aux supermarchés d’une superficie d’au moins 400 m2 (comme en France)43. Elle réclame aussi un meilleur contrôle de la qualité des dons.
En 2024, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance qui répond en partie aux attentes des associations d’aide alimentaire. Elle impose aux grandes surfaces de plus de 1000 m2 de proposer leurs invendus alimentaires consommables en premier lieu aux associations caritatives, puis à des entreprises de transformation « pour favoriser une économie circulaire » et, enfin, à des entreprises privées de revente44. En privilégiant le don avant la revente, la mesure est conçue pour augmenter la quantité de dons tout en évitant la diminution de la qualité que les organismes d’aide alimentaire attribuent en grande partie aux applications de revente, comme on l’a vu en ce qui concerne la France. Pour faciliter la mise en œuvre du don des invendus, le gouvernement bruxellois a augmenté le soutien financier aux plateformes logistiques de récupération alimentaire45.
2.1.3Ailleurs en Europe
D’autres gouvernements européens prennent ou prévoient de prendre des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est le cas notamment de l’Espagne, qui a adopté en avril 2025 une loi sur la prévention des pertes et du gaspillage alimentaire. Celle-ci impose aux acteurs du système alimentaire de mettre en place un plan de prévention qui explique les mesures prises pour reconnaître, prévenir et réduire les pertes et le gaspillage alimentaires. Quoique le don des surplus alimentaires ne soit pas obligatoire, il est fortement encouragé par cette loi, notamment parce que les plans de prévention doivent respecter la pyramide de la réduction du gaspillage privilégiant le don pour la consommation humaine, parce que les donateurs bénéficient de déductions fiscales et parce que la loi encourage la signature de conventions de don avec des organismes sans but lucratif46. La loi s’applique à tous les secteurs de la chaîne alimentaire, mais les petites entreprises en sont exemptées. En cas d’infraction ou de récidive, les amendes prévues sont sévères. D’autres pays européens comme l’Allemagne, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas et le Danemark se sont dotés de plans nationaux pour lutter contre le gaspillage alimentaire sans nécessairement passer par la voie législative47.
2.2 Les exemples étasuniens
Dans le contexte étasunien, la question du gaspillage alimentaire s’inscrit dans le cadre de mesures pour réduire la quantité de déchets dans les dépotoirs. Elle est associée à la mise en place de plans visant à favoriser le « recyclage » (compostage ou biométhanisation) des matières organiques. Tout comme en Europe, les autorités préconisent généralement que les denrées alimentaires soient redistribuées aux consommateurs et consommatrices avant d’être « recyclées ».
Depuis 1996, la « loi du Bon Samaritain » (Good Samaritan Act) protège les donateurs étasuniens d’aliments contre les poursuites dans l’éventualité où la nourriture donnée rendrait malade48. Un principe semblable est inscrit au Code civil du Québec49.
Le gouvernement fédéral offre des incitatifs fiscaux pour encourager le don des invendus. Douze états offrent des incitatifs fiscaux additionnels pour encourager le don des excédents alimentaires. La Californie offre les incitatifs les plus généreux, y compris pour les coûts associés à la récupération et au transport des denrées50.
2.2.1La Californie
En Californie, le don obligatoire des invendus est un des éléments découlant du Senate Bill 1383 (ou SB 1383), une loi sur la gestion des matières organiques qui exige notamment que l’État atteigne l’objectif de récupérer pour la consommation humaine au moins 20 % de la nourriture qui est présentement jetée51.
La loi SB 1383 impose aux générateurs commerciaux de nourriture de récupérer le maximum de nourriture qui aurait autrement été jetée52. Pour ce faire, ils doivent signer un contrat ou une entente écrite avec une organisation de récupération alimentaire. Pour pallier une limite de la loi française (qui laisse les générateurs décider des quantités qu’ils donnent et des ressources humaines et logistiques qu’ils veulent y consacrer), la loi californienne indique que les générateurs doivent donner le « maximum » de leurs excédents comestibles disponibles53. La réglementation californienne est moins stricte que celle de la France en ce qui concerne la définition des organismes de récupération alimentaire : ceux-ci n’ont pas à être habilités, et il peut s’agir d’organisations à but lucratif, ce qui est critiqué par les banques alimentaires californiennes54.
Ces exigences sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 pour les générateurs de niveau 1 (supermarchés, épiceries de 1000 m2 et plus, fournisseurs de services alimentaires, distributeurs et grossistes) et le 1er janvier 2024 pour les générateurs de niveau 2 (restaurants de 250 places et plus, hôtels de 200 chambres et plus, établissements de santé de 100 lits et plus, grands événements, administrations publiques et établissements d’éducation qui ont une cafétéria).
La loi 1383 fixe un objectif global à l’échelle de l’État, mais ce sont les administrations locales (villes et comtés) qui sont responsables de sa mise en œuvre. Elles ont comme responsabilité de mettre en place un programme de récupération alimentaire ou, s’il y en a déjà un, d’en accroître les capacités. Elles doivent aussi faire des efforts d’éducation et de sensibilisation auprès des générateurs de résidus alimentaires, notamment sur les manières de réduire le gaspillage55. En consultation avec les acteurs concernés, les administrations locales doivent estimer la quantité de nourriture récupérable, ainsi que compiler, publier et mettre à jour une liste des organisations de récupération alimentaire.
Plutôt que de prévoir un plan de gestion de la qualité du don comme la France, SB 1383 interdit spécifiquement le « donation dumping », c’est-à-dire de donner des aliments que l’organisme ne souhaite pas avoir ou qui sont impropres à la consommation. En cas de non-respect de cette interdiction, l’organisme d’aide alimentaire peut réclamer une compensation financière au générateur56. De plus, tout comme en France, le modèle d’entente de don proposé par l’État réaffirme explicitement le droit de refuser les dons inappropriés. Alors que les départements français ont peu de moyens d’assurer le contrôle de la réglementation sur le gaspillage, les autorités californiennes ont la possibilité de procéder à des inspections nombreuses57. Si un générateur réduit ses surplus alimentaires à zéro, il est en pratique exempté de l’obligation de donner à condition qu’il demeure capable de prouver qu’il ne jette aucune denrée comestible58.
L’organisme CalRecycle, l’équivalent de Recyc-Québec, est chargé d’offrir des outils de sensibilisation, d’accorder des subventions et de publier des rapports d’étape. Il note que, depuis la mise en œuvre de SB 1383, 100 % des communautés californiennes ont étendu leurs programmes de récupération alimentaire et qu’en 2023, ces programmes locaux ont permis de collecter 217 000 tonnes de nourriture, soit 94 % de l’objectif de 202559.
Une enquête effectuée en 2024 auprès des banques alimentaires de la Californie permet de décrire certaines retombées de SB 1383. Menée à l’initiative de l’association californienne des banques alimentaires, cette étude a sondé 33 des 41 banques alimentaires de l’État60. En réponse au sondage, 64 % des banques alimentaires interrogées ont dit que le nombre de donateurs avait augmenté depuis l’entrée en vigueur de SB 1383 (contre 33 % qui n’ont pas constaté de changement)61. Plus de la moitié (55 %) des banques alimentaires disent que les quantités données ont augmenté, alors que 30 % disent que les quantités sont restées semblables (les 15 % restants affirmant que les quantités données ont diminué). Les banques alimentaires les plus grosses ont connu une plus forte croissance des dons. Pour les 15 banques alimentaires qui ont fourni des données détaillées sur le nombre de livres de denrées reçues, la hausse a été de 16,5 % entre 2021 et 202362. Les plus petites banques alimentaires ont constaté une légère baisse durant l’année de l’entrée en vigueur de la loi, puis une augmentation l’année suivante. Cela pourrait être attribuable aux efforts de mise en place, vraisemblablement plus exigeants pour les organismes de petite taille dont les employé·e·s doivent parfois jouer plusieurs rôles. Plus du tiers (36 %) des banques alimentaires ayant répondu au sondage ont affirmé qu’elles avaient reçu plus d’aliments nutritifs, comme de la viande et des fruits et légumes (contre 48 % qui n’ont pas observé de changement à cet égard et 16 % qui ont vu une détérioration).
Cependant, environ la moitié (52 %) des banques alimentaires ont noté qu’elles recevaient plus d’aliments impropres à la consommation depuis l’entrée en vigueur de la loi (contre 39 % qui n’ont pas observé de changement). Dans des entretiens avant ou après le sondage, des responsables de banques alimentaires ont souligné l’importance des efforts de sensibilisation et d’éducation qu’elles faisaient de manière répétée auprès des générateurs pour s’assurer d’obtenir des dons de qualité63. Comme en Europe, la qualité des dons est donc un enjeu important.
La plupart des banques alimentaires californiennes ont dû investir dans l’acquisition de nouveau matériel et l’embauche de personnel pour gérer l’afflux de dons additionnels. Plusieurs déplorent qu’elles n’aient pas reçu suffisamment de financement pour couvrir ces coûts, entre autres parce que plusieurs subventions étaient ponctuelles, alors que certaines dépenses étaient récurrentes. Par conséquent, 24 % des banques alimentaires disent que les coûts de SB 1383 dépassent ses bénéfices (contre 30 % qui disent que les bénéfices sont supérieurs aux coûts et 33 % qui disent que les deux s’équivalent)64.
Il importe de noter que les insatisfactions par rapport à la loi proviennent surtout de banques alimentaires rurales, qui constatent que les administrations locales des zones rurales manquent souvent à leurs obligations en ce qui concerne l’éducation des donateurs et le soutien aux organismes de récupération alimentaire65. Le rapport conclut que la loi a permis aux banques alimentaires de distribuer davantage de nourriture à leur communauté, mais il recommande que les autorités publiques offrent plus de soutien financier et administratif aux acteurs de la récupération alimentaire pour faciliter leur travail.
2.2.2L’État de New York
Depuis janvier 2022, dans l’État de New York66, tous les générateurs de résidus alimentaires désignés doivent séparer les excédents alimentaires dans le but d’en donner le plus possible pour la consommation humaine67. Les générateurs désignés sont ceux qui génèrent en moyenne plus de deux tonnes de résidus alimentaires par semaine. La loi s’applique aux prisons, aux collèges et universités, aux hôtels, aux centres sportifs, aux restaurants, aux épiceries et supermarchés, aux centres commerciaux, aux grossistes, aux distributeurs et à quelques autres secteurs d’activité, mais elle exclut les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et les écoles primaires et secondaires.
Dans le cadre réglementaire qui précise les modalités de la loi, on explique que le maximum possible (« the maximum extent practicable ») signifie que les donateurs doivent maximiser les dons en mettant en œuvre les meilleures pratiques de gestion et en tenant compte du rapport coût-efficacité et de la faisabilité68. À la différence des lois française et californienne, la loi new-yorkaise n’oblige pas les générateurs à signer des ententes de don avec des organismes. Elle ne contient pas non plus de disposition sur la qualité des dons. Par contre, le cadre réglementaire stipule que les donateurs doivent travailler de concert avec les organismes d’aide alimentaire (définis comme des organismes sans but lucratif) pour respecter leurs critères de don, doivent être à l’écoute de leurs besoins et de leurs limites logistiques et doivent réduire au minimum la quantité de nourriture que ces organismes devront jeter69. Beaucoup de générateurs ont des partenariats avec plusieurs organisations.
L’entrée en vigueur de la loi a été accompagnée d’efforts de mise en œuvre importants. Le Department of Environmental Conservation (DEC) dresse la liste des générateurs désignés, produit du matériel éducatif et prépare un rapport annuel. Il finance Feeding NYS, un organisme qui récupère lui-même de la nourriture, mais qui est surtout chargé de créer des partenariats entre les entreprises visées par la loi et les banques alimentaires régionales. Feeding NYS a fait du jumelage (« matchmaking ») avec des centaines de donateurs70. L’organisme a aussi redistribué 2 millions de dollars américains provenant du DEC aux banques alimentaires de l’État afin qu’elles se dotent de véhicules, de chauffeurs et d’équipement pour la récupération alimentaire. D’autres subventions ont été accordées directement par le DEC aux banques alimentaires, aux organisations d’aide alimentaire et aux municipalités. Le DEC soutient aussi financièrement le Center for EcoTechnology, un organisme qui offre de l’assistance technique aux commerces et institutions qui veulent réduire ou mieux gérer leurs résidus alimentaires. Ce centre offre un service d’aide téléphonique (« hotline ») et de l’accompagnement personnalisé sur les lieux d’activité des générateurs71. Ses services s’adressent aussi aux petits générateurs de surplus alimentaires qui ne sont pas obligés de donner, mais qui sont incités à le faire.
La loi a eu des résultats impressionnants. Le programme de récupération alimentaire de Feeding NYS est passé de 150 000 livres récupérées à sa création en 2021 à 4,2 millions de livres récupérées en 202372. Pour l’ensemble des générateurs désignés de l’État (qui peuvent faire des dons par le biais du programme de Feeding NYS, faire leurs propres démarches de don auprès d’autres associations ou passer par d’autres banques alimentaires), l’augmentation a été de 60 % entre 2021, avant l’entrée en vigueur du don obligatoire, et 202273 : d’une année à l’autre, la quantité totale récupérée est passée de 25,2 millions de livres à 40,3 millions de livres74. Comme en Californie et en France, la croissance des dons a été particulièrement marquée pour les fruits et légumes, la viande et les œufs, ce qui a permis de diversifier l’aide alimentaire.
Les données des générateurs proviennent de la déclaration obligatoire qui est exigée annuellement de leur part. Environ les trois quarts des générateurs ont bel et bien rempli leur déclaration, ce qui laisse présager une augmentation future des dons à mesure que les autres générateurs se conformeront aux exigences de la loi. Le manque de personnel, la formation du personnel et le besoin de soutien pour établir des liens avec les organismes bénéficiaires ont été les défis les plus fréquemment mentionnés par les donateurs75.
Considérant que l’initiative législative a été un succès, les autorités de l’État de New York ont décidé d’en étendre la portée en abaissant le seuil à partir duquel un générateur de résidus alimentaires est soumis à l’obligation de donner76. Ce seuil sera d’une tonne de résidus alimentaires par semaine en janvier 2026, puis d’une demi-tonne en janvier 2028.
2.3 La loi comme catalyseur
Tant en France qu’aux États-Unis, les lois sur le don des invendus ont joué un rôle de catalyseur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout d’abord, elles ont mené à la mise en place de nouveaux programmes, de mesures locales et de plans d’action. Elles ont aussi mené à la création de nouveaux partenariats entre différents acteurs. De plus, elles ont favorisé l’émergence d’une pluralité d’associations et d’entreprises qui s’attaquent au gaspillage alimentaire en transformant les invendus en ressources.
Dans les cas français et new-yorkais, ces lois ont aussi mis en branle un processus qui a mené à leur propre extension. La loi Garot a même été le prélude à une intervention législative plus large sur la réduction des déchets. En effet, en plus de renforcer la loi Garot, la loi AGEC interdit de jeter les invendus non alimentaires (vêtements, électroménagers, meubles, jouets, matériel électronique, produits de soins personnels, etc.)77.
Par ailleurs, les lois sur le don des invendus ont contribué à accroître la visibilité du gaspillage alimentaire, tant auprès des employé·e·s du système alimentaire qu’auprès du grand public. Il est donc possible que cet effet médiatique ait contribué à des réductions du gaspillage alimentaire que les données disponibles ne peuvent pas saisir. Enfin, les lois adoptées, particulièrement la loi française, ont servi d’inspiration pour d’autres gouvernements qui ont pu s’appuyer sur les expériences d’ailleurs pour rédiger leurs propres propositions législatives, qui reprennent des éléments de ces lois tout en apportant des réponses aux problèmes soulevés78.
Compte tenu des résultats positifs obtenus ailleurs, il semble judicieux d’adopter une réglementation sur le don obligatoire des invendus à Montréal. Les cas internationaux étudiés soulignent en même temps l’importance de prévoir des dispositions pour s’assurer de la qualité des dons, comme l’obligation pour les donateurs d’avoir un plan de gestion de la qualité. Les exemples internationaux révèlent aussi la pertinence d’offrir du soutien financier et logistique aux acteurs concernés pour favoriser une mise en œuvre efficace de la réglementation.
CHAPITRE 3 Évaluation du potentiel de récupération alimentaire à Montréal
Dans ce chapitre, nous estimons le potentiel de récupération alimentaire dans les ICI de Montréal selon les catégories d’établissements alimentaires. Pour ce faire, nous nous appuyons principalement sur des données détaillées fournies par La Tablée des Chefs, Bouffe-Action de Rosemont et La Transformerie, trois organismes qui font de la récupération alimentaire depuis plusieurs années. Le principe de base des calculs effectués consiste à estimer, pour chaque catégorie d’entreprises et d’institutions, la quantité typique de denrées qui peut être récupérée par établissement, puis à calculer quelle quantité de nourriture serait récoltée si la collecte était faite dans tous les établissements de cette catégorie de l’île de Montréal. Compte tenu du degré d’incertitude inhérent à ces projections, nous présentons un scénario modeste et un scénario ambitieux pour chaque catégorie. La méthodologie utilisée s’inspire notamment d’une étude semblable réalisée pour les villes de Denver, Nashville et New York par le Natural Resources Defense Council (NRDC), un organisme sans but lucratif étasunien qui s’appuie sur la recherche pour proposer des politiques publiques environnementales79.
La DIA de la Ville de Montréal nous a fourni des tableaux répertoriant tous les établissements alimentaires de l’île de Montréal en fonction de leur taille80. Selon les règles du MAPAQ, les établissements sont classés en deux catégories selon leur niveau d’activité : petit/moyen et grand/très grand. Il s’agit bel et bien de deux catégories : à l’heure actuelle, il n’existe pas de catégorisation plus fine permettant de savoir quels établissements sont petits ou moyens et lesquels sont grands ou très grands81.
La distinction entre les deux niveaux d’activité est relative à chaque catégorie d’entreprises et d’institutions. Ainsi, les garderies de niveau grand/très grand sont celles qui comptent 80 enfants et plus, tandis que les restaurants de niveau grand/très grand sont ceux qui vendent 250 repas et plus par jour. Il en découle qu’un établissement peut être de niveau grand/très grand même s’il est physiquement plus petit qu’un établissement de niveau petit/moyen d’une autre catégorie. À titre d’exemple, même si les hôpitaux sont généralement plus grands que les garderies, il y a des hôpitaux de niveau petit/moyen et de niveau grand/très grand, tout comme il y a des garderies classées petit/moyen et grand/très grand.
En tout, on compte un peu plus de 11 000 établissements de niveau petit/moyen et un peu moins de 1 700 établissements de niveau grand/très grand. Ceux-ci sont divisés en trois secteurs d’activité : détaillant-restaurateur (qui inclut l’ensemble des restaurants et des commerces de détail, mais aussi toutes les institutions qui offrent des repas à leurs bénéficiaires, comme les écoles et les résidences pour aîné·e·s), entrepôt/distribution et transformation. La première étape du calcul d’impact a été de déterminer le nombre d’établissements pour chacune des 44 catégories de détaillants-restaurateurs, 11 catégories d’entreposeurs-distributeurs et 15 catégories de transformateurs. Prenant en considération les critères de catégorisation définis par le MAPAQ82, nous avons ensuite regroupé les catégories d’établissement similaires en catégories plus larges qui permettent la comparaison avec les données fournies par les organismes de récupération alimentaire. Par exemple, les catégories « Boulangerie », « Pâtisserie-boulangerie » et « Pâtisserie-dépôt » ont été fusionnées en une seule catégorie (« Boulangerie »). Ces catégories sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. Les regroupements effectués sont expliqués plus en détail dans les sections correspondantes. Dans certains cas, les établissements alimentaires ont été recodés pour qu’ils soient associés à la catégorie qui leur correspond le mieux. Par exemple, alors que la plupart des cafés sont catégorisés dans « Casse-croûte », certains d’entre eux se retrouvent dans la catégorie « Épicerie avec préparation ». Aux fins de cette étude, ces derniers ont donc été combinés avec la catégorie « Casse-croûte ».
Le potentiel de récupération alimentaire à Montréal dont il est question dans ce chapitre tient compte des denrées déjà récupérées par différents organismes. Montréal a en effet la chance d’avoir un vigoureux système de récupération alimentaire déjà en place. En termes de quantité de nourriture récupérée, Moisson Montréal est de loin l’acteur le plus important de ce système83. Avec son programme de récupération en supermarchés (PRS) et ses partenariats avec d’autres grandes chaînes alimentaires, Moisson Montréal a récolté environ 2 500 tonnes de nourriture en 2024-202584. En ajoutant les denrées collectées auprès de 457 producteurs, transformateurs, distributeurs et autres partenaires, Moisson Montréal atteint 16 300 tonnes de nourriture récupérées85.
Parmi les autres organisations impliquées dans la récupération alimentaire, il y a notamment La Corbeille Bordeaux-Cartierville, dont le projet Défi alimenterre a permis de récupérer 513 tonnes de denrées auprès de 53 donateurs, principalement des producteurs agricoles et des grossistes86. L’organisme Bouffe-Action de Rosemont a récupéré 367 tonnes de nourriture en 2024-202587, alors que La Tablée des Chefs a récolté 295 tonnes en 202488. Mission Bon accueil et Deuxième Récolte sont aussi des acteurs importants de la récupération alimentaire. La Transformerie a également une importante capacité de récupération et de transformation alimentaire. Il existe plusieurs autres organismes qui font de la récupération alimentaire à plus petite échelle.
Il est donc difficile de recenser l’ensemble des initiatives existantes sur le territoire. Par ailleurs, certains établissements alimentaires donnent leurs surplus à leurs employé·e·s en fin de journée. Étant donné la confidentialité des données, les différentes méthodes de calcul et périodes de comptabilisation, le risque de double compte89 et le manque d’informations sur les établissements visés90, il est présentement impossible de déterminer avec certitude combien de kilos de nourriture sont récupérés à Montréal91. Cependant, dans les calculs pour chaque catégorie d’entreprises et d’institutions, nous avons soustrait les établissements pour lesquels nous avons des données confirmant que les invendus sont récupérés. Puisque nous incluons les magasins couverts par Moisson Montréal, la grande majorité des aliments déjà collectés est prise en compte.
En soustrayant ainsi les entreprises et institutions qui font déjà don de leurs invendus déjà couvertes, nous présumons qu’elles n’ont pas de quantités supplémentaires à donner. Or, il se peut qu’un établissement fasse des dons réguliers à un organisme sans pour autant donner la totalité de ses invendus. Par exemple, il se peut que l’organisme concerné ait seulement les capacités logistiques pour passer deux journées par semaine et qu’il ne puisse donc pas prendre les surplus des autres jours. Il se peut aussi qu’un commerce sous-estime la quantité d’aliments comestibles qu’il pourrait donner. Parmi les intervenant·e·s rencontré·e·s, certain·e·s ont dit que leur organisme récupérait déjà la quasi-totalité de ce qui pouvait être récupéré chez les établissements visés, tandis que d’autres jugeaient qu’il serait possible d’aller en chercher plus. D’autres ont affirmé ne pas pouvoir répondre, ne sachant pas comment les donateurs gèrent leurs stocks et à combien d’organismes ils font des dons. La situation varie donc d’un organisme à l’autre et d’un établissement à l’autre. Ajouter l’obligation de poser un diagnostic de gaspillage alimentaire à la réglementation, comme l’envisage le prototype réglementaire présenté ci-haut, permettrait d’avoir une meilleure idée du potentiel de récupération alimentaire dans les établissements qui font déjà des dons.
Dans les sections suivantes, nous présentons la démarche et les calculs pour chacune des 15 catégories d’établissements alimentaires que nous avons formées à partir des 44 catégories de détaillants-restaurateurs92. Les sections sont présentées en ordre d’importance selon la quantité de nourriture qu’on peut récupérer dans chaque catégorie d’établissements d’après le scénario le plus ambitieux, soit la somme des établissements de niveau petit/moyen et de niveau grand/très grand93. Nous présentons ensuite un tableau synthétique qui montre le potentiel total de récupération alimentaire à Montréal selon les deux scénarios. Enfin, nous analysons le nombre de repas qui seraient maintenus dans les circuits pour l’alimentation humaine et les émissions de GES qui seraient évitées si ces denrées étaient récupérées.
3.1 Potentiel par catégorie d’établissement (commerces et institutions)
3.1.1Épiceries
La catégorie « Épiceries » comprend les catégories « Boucherie-épicerie », « Charcuterie/fromage » et « Épicerie avec préparation ». Cette dernière catégorie a été triée pour déplacer les dépanneurs, les cafés et les casse-croûte vers les catégories correspondantes. Dans le cas des établissements de niveau grand/très grand, nous avons aussi inclus les boucheries et les poissonneries, dont certaines ont un volet épicerie. Les épiceries ne comprennent pas les supermarchés, qui constituent une catégorie en soi. Il s’agit donc essentiellement d’épiceries spécialisées (épiceries « santé » et épiceries associées à différentes communautés culturelles, notamment), de fruiteries et d’épiceries de quartier, y compris certaines chaînes d’alimentation qui sont de plus grande envergure sans être des supermarchés94. Le tableau 2 présente le nombre de commerces concernés, les hypothèses utilisées et le potentiel de récupération estimé.
Les kilos par collecte ont été établis à partir de plus de 1 500 collectes effectuées par Bouffe-Action et La Transformerie dans 12 épiceries. Pour les scénarios modestes, les 25 kg correspondent à la récolte moyenne de toutes les épiceries d’un organisme et des 3 plus petites épiceries de l’autre organisme. Étant donné que nous ne pouvons pas déterminer avec certitude quelles épiceries sont de niveau petit/moyen ou de niveau grand/très grand, certaines d’entre elles ayant été anonymisées, nous conservons 25 kg/collecte pour les deux scénarios modestes. Le scénario petit/moyen ambitieux correspond à la moyenne des 12 épiceries, tandis que le scénario grand/très grand ambitieux correspond à la moyenne des 4 plus grandes95.
Le nombre de collectes (2 par semaine pour un total de 100 par année) est une estimation prudente qui suppose que certains aliments (non périssables, réfrigérables ou congelables) seraient mis de côté pour les jours de collecte, mais que les invendus qui doivent être récupérés le jour même ne seraient pas toujours récoltés. Dans l’échantillon, le nombre de collectes varie d’une collecte hebdomadaire à une collecte par jour de semaine.
Dans les scénarios présentés, on suppose la participation de toutes les épiceries. Dans l’État de New York, 77 % des épiceries désignées ont déclaré avoir fait des dons96. Si le même taux de participation s’appliquait ici, la quantité totale récupérée varierait de 1 620 850 kg à 3 565 870 kg (petit/moyen) et de 100 100 kg à 288 288 kg (grand/très grand). Les deux organismes qui nous ont fourni leurs données constatent qu’environ 10 % de ce qu’ils reçoivent est composté. Par ailleurs, il est probable qu’un diagnostic de gaspillage alimentaire dévoile un potentiel de don plus élevé, comme nous le verrons plus loin en ce qui concerne une étude de cas réalisée dans un supermarché.
3.1.2Dépanneurs et magasins à rayons
Cette catégorie comprend les catégories « Épicerie97 », « Aliments naturels » et « Magasin à rayons », ainsi que les dépanneurs qui étaient placés dans la catégorie « Épicerie avec préparation ». Elle inclut notamment des magasins à un dollar ainsi que des pharmacies. Les établissements d’une importante chaîne de pharmacies ont été soustraits du décompte parce que cette chaîne a une entente de don des invendus avec Deuxième Récolte.
Étant donné que nous n’avons pas pu obtenir de données de collecte pour cette catégorie, soit parce que les données sont confidentielles ou parce que les organismes qui nous ont transmis leurs données ne recueillent pas de denrées dans ce type de commerces, nous nous appuyons sur les taux de dons annuels par magasin utilisés par le NRDC dans son étude sur le potentiel de récupération alimentaire à Denver, Nashville et New York. Le NRDC tire ses données de 488 dépanneurs ayant des partenariats avec l’organisme Food Donation Connection98.
Alors que le NRDC applique à l’ensemble des magasins le taux de don du 75e percentile dans son scénario modeste et du 90e percentile dans son scénario ambitieux, nous avons opté pour plus de prudence en prenant le taux de don médian (50e percentile) pour les magasins de niveau petit/moyen et le 75e percentile pour les magasins de niveau grand/très grand. Dans ce dernier cas, le 75e percentile reflète le fait que ces magasins ont un plus gros volume de marchandises et la capacité de consacrer davantage de ressources humaines et matérielles à la récupération alimentaire.
Le tableau 3 montre les résultats pour les dépanneurs et les magasins à rayons. Comme le scénario modeste du NRDC, notre scénario modeste pour les magasins de niveau petit/moyen suppose que 15 % d’entre eux participent, ce qui reflète le fait qu’il est plus difficile de rejoindre les petits établissements et que ceux-ci ont moins de temps et d’énergie à consacrer à la récupération alimentaire, ou encore qu’il est moins « rentable » pour un organisme d’aller y récupérer des denrées. Dans le scénario ambitieux pour le niveau petit/moyen, nous incluons 45 % des commerces, soit le taux de participation le plus faible pour les différentes catégories de générateurs visés par la loi de l’État de New York99. Suivant les mêmes calculs avec un taux de participation de 100 %, la quantité récoltée pourrait être estimée à 3 047 883 kg. Pour les commerces de niveau grand/très grand, nous supposons un taux de participation de 45 % dans le scénario modeste et de 100 % dans le scénario ambitieux.
Selon nos calculs, les dépanneurs et les magasins à rayons constituent au total la deuxième source d’invendus alimentaires sur le plan du volume. Deux enquêtes menées par Les Coops de l’information ont montré l’ampleur du gaspillage alimentaire qui peut survenir dans certains commerces de ce type, notamment en raison des changements saisonniers et des produits qui ont atteint leur date de péremption, mais qui sont encore bons100.
3.1.3Boulangeries
Pour les boulangeries, nous avons eu accès aux données de Bouffe-Action et de La Tablée des Chefs pour près de 12 000 collectes dans plus d’une vingtaine d’établissements. La Tablée des Chefs vise généralement des collectes quotidiennes dans les boulangeries qu’elle met en lien avec des organismes d’aide alimentaire. Nous avons donc repris ce nombre de collectes comme hypothèse dans notre scénario ambitieux pour les plus grandes boulangeries. Pour les autres scénarios, nous calculons une collecte hebdomadaire ou aux trois jours (en présumant quelques collectes en moins pour tenir compte des vacances et imprévus). La quantité de 25 kg/collecte correspond à la moyenne de l’ensemble des boulangeries ayant un partenariat avec La Tablée pour les trois années pour lesquelles nous avons des données. Dans les scénarios petit/moyen modeste et petit/moyen ambitieux, nous avons respectivement utilisé le 25e percentile et le 10e percentile (arrondis) de kg/collecte pour les boulangeries.
Alors qu’un règlement favorisant les dons pourrait mener à une réduction progressive des dons à mesure que les entreprises concernées prennent conscience du gaspillage alimentaire, les données sur trois ans des boulangeries ne montrent pas de tendance évidente en ce sens. On peut supposer que c’est parce que les quantités vendues sont difficiles à prévoir et que les boulangeries ont intérêt à présenter des étals bien garnis aux consommateurs et consommatrices.
Les boulangeries sont parmi les catégories de commerces pour lesquelles la récupération alimentaire est la plus facile. La plupart des produits n’ont pas à respecter la chaîne du froid. Ils sont consommés largement donc ils peuvent être redistribués aisément et ils sont peu périssables ou faciles à revaloriser101. Depuis quelques mois, La Tablée des Chefs a lancé un projet pilote de mise en liaison de coopératives d’habitation avec des boulangeries locales. Des résident·e·s s’organisent pour récupérer les invendus de leur boulangerie de quartier et les donner aux membres de leur coopérative. Étendu à tous les immeubles de logements sociaux et communautaires (soit plus de 480 coopératives d’habitation, plus de 900 bâtiments d’habitation à loyer modique et plus de 250 OSBL d’habitation102), un tel projet permettrait de récupérer des quantités importantes de nourriture sur l’ensemble du territoire montréalais tout en offrant des aliments de qualité à des populations souvent à faible revenu.
3.1.4Restaurants à service complet
Cette catégorie comprend les catégories « Restaurant » et « Brasserie » (c’est-à-dire les bars qui ont un menu complet de nourriture). Il s’agit des restaurants qui servent des repas aux tables103. Pour calculer le potentiel de récupération alimentaire dans ces établissements, nous utilisons les taux de dons annuels établis par le NRDC à partir des dons enregistrés par Food Donation Connection pour plus de 6 000 restaurants104. Le NRDC estime que moins de 5 % des restaurants aux États-Unis donnent leurs surplus alimentaires (1,7 % des restaurants étasuniens donnent leurs invendus à Food Donation Connection, la plus grande organisation de récupération alimentaire pour ce secteur)105. Les taux de participation utilisés dans le tableau 5 sont les mêmes que pour les dépanneurs et magasins à rayons ci-haut. Nous procédons aussi de la même manière en ce qui concerne les taux de don selon le percentile.
Étant donné que les restaurants comptent beaucoup de localisations qui ont chacune une faible quantité de surplus alimentaires, la récupération dans ce secteur pourrait être optimisée en se concentrant sur les plus gros établissements, ceux qui sont proches les uns des autres, ou encore ceux qui offrent des invendus que les associations d’aide alimentaire ont généralement plus de difficulté à se procurer, comme la viande106. Étant donné que les restaurants disposent de cuisines et d’une main-d’œuvre dotée de compétences culinaires, ils sont bien placés pour mettre en œuvre des stratégies de réduction du gaspillage alimentaire107. Une réglementation qui les oblige à diagnostiquer le gaspillage, à trier et à donner leurs excédents peut être un incitatif à agir par la prévention à la source.
Étant donné que dans les tableaux de la DIA les cuisines d’hôtels sont catégorisées principalement comme « Restaurant » ou comme « Cafétéria » sans être nécessairement associées à leur hôtel respectif, nous n’avons pas pu calculer le potentiel de récupération alimentaire spécifique à l’hébergement touristique. On sait toutefois que ce potentiel est important étant donné que les établissements de ce secteur préparent aussi des repas pour des banquets, des réceptions, des congrès et autres événements. La Tablée des Chefs organise d’ailleurs la récupération de denrées dans plusieurs hôtels.
3.1.5Résidences pour personnes âgées
Pour le calcul du potentiel de récupération alimentaire dans les résidences pour personnes âgées, nous nous appuyons sur les données colligées par les services alimentaires du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en partenariat avec La Tablée des Chefs. Les données obtenues concernent près de 1 300 collectes dans 15 résidences en 2024-2025. En utilisant le répertoire des installations de santé et services sociaux de Montréal108, nous avons recensé le nombre de lits d’hébergement dans les résidences concernées, puis nous avons calculé le nombre de kilos par lit à partir du nombre total de kilos récupérés durant l’année. Nous avons ensuite appliqué ce ratio au nombre moyen de résident·e·s des résidences privées pour aîné·e·s d’après le registre du ministère de la Santé et des Services sociaux109.
L’analyse des données sur trois ans nous a permis de constater une baisse des quantités de nourriture récoltées entre 2022 et 2024. Nous avons communiqué avec les responsables de l’alimentation de deux résidences qui nous ont indiqué que, dans leurs centres respectifs, ces baisses étaient attribuables à la démarche de réduction du gaspillage entamée depuis la mise en place de la récupération des surplus. En réduisant leurs excédents, les centres en question ont pu espacer le nombre de collectes de nourriture. Pour les résidences, les surplus alimentaires représentent un coût qui peut difficilement être transféré aux consommateurs et consommatrices, particulièrement dans les institutions publiques où les repas sont gratuits. Il y a donc un incitatif à la réduction du gaspillage. Dans le tableau 6, pour refléter cette tendance à la diminution des surplus, le nombre de kilos par résident·e du scénario modeste correspond au taux de 2024 (après les efforts de réduction), tandis que le nombre de kilos par résident·e pour le scénario ambitieux correspond au taux de 2022.
3.1.6Écoles primaires et secondaires
Pour déterminer le potentiel de récupération alimentaire dans les écoles primaires et secondaires, nous avons combiné les catégories « Cafétéria institution d’enseignement » et « École/mesures alimentaires », puis nous avons trié la liste obtenue pour en retirer les doublons et les collèges et universités. Nous avons ensuite estimé le nombre moyen d’élèves par école selon le niveau petit/moyen ou grand/très grand en ayant recours à un tableau des écoles de Montréal préparé par l’IRIS dans le cadre de la recherche sur l’estimation des coûts d’un programme d’alimentation scolaire universel110. Nous utilisons le taux de don annuel proposé par le NRDC, soit entre 1 et 4 livres par année par élève, un taux que le NRDC qualifie de « conservateur111. »
Les écoles primaires et secondaires peuvent être un maillon essentiel d’une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Réparties sur l’ensemble du territoire, les écoles disposent souvent de cuisines qui pourraient potentiellement être utilisées pour transformer des surplus alimentaires récupérés dans d’autres commerces et institutions. Les aliments récupérés ailleurs pourraient aussi être intégrés aux repas préparés pour les élèves. De plus, la lutte contre le gaspillage alimentaire pourrait faire partie d’un projet pédagogique d’éducation alimentaire et environnementale qui ferait participer les élèves à toutes les étapes, de la récupération de la nourriture à la planification et à la préparation des repas112.
3.1.7Supermarchés
Les données pour les supermarchés proviennent des mêmes sources que pour les épiceries. Elles reflètent près de 2 000 collectes dans 12 supermarchés. Dans le tableau 8, le nombre de kilos par collecte pour le scénario modeste correspond à la moyenne des 8 supermarchés de l’un des deux organismes, tandis que le scénario ambitieux correspond à la moyenne des 12 supermarchés. Les calculs effectués ont été comparés avec la moyenne par magasin du NRDC et de Moisson Montréal pour s’assurer qu’ils soient réalistes.
Comme nous l’avons exposé au début du chapitre, les commerces qui donnent déjà leurs invendus ont été soustraits du calcul. C’est ce qui explique que le potentiel de récupération soit nul dans les supermarchés de niveau grand/très grand : Moisson Montréal récolte déjà les denrées de 134 grands magasins d’alimentation, alors qu’il y a 116 supermarchés de niveau grand/très grand. De même, 30 des 63 supermarchés ont été soustraits du calcul (18 de Moisson Montréal ainsi que les 12 des 2 autres organismes).
Toutefois, à partir d’une analyse de terrain des résidus alimentaires d’un supermarché qui donne déjà à des organismes et qui a une gestion des matières organiques meilleure que la moyenne, le chercheur indépendant Éric Ménard a montré que la part d’aliments récupérables pouvait être beaucoup plus grande que ce qui était effectivement donné. En une semaine, Ménard a mesuré 1 089 kg donnés, 1 172 kg de retailles potentiellement récupérables, 399 kg de produits récupérables tels quels et 310 kg de produits potentiellement récupérables113. En utilisant les mêmes proportions pour tous les supermarchés de niveau grand/très grand et en s’en tenant uniquement aux produits récupérables tels quels, on pourrait récupérer 278 980 kg supplémentaires dans le scénario modeste et 407 740 kg supplémentaires dans le scénario ambitieux. Ce constat permet de souligner l’importance de faire un diagnostic de gaspillage alimentaire et d’accompagner les supermarchés pour maximiser la quantité de denrées récupérée.
3.1.8Collèges et universités
Pour les collèges et universités, nous partons du taux de don annuel du NRDC pour les écoles en l’ajustant à la hausse pour tenir compte de la consommation alimentaire plus grande d’une population composée de jeunes adultes114. Nous prenons aussi en considération le fait que, par rapport aux élèves du primaire et du secondaire qui mangent à la cafétéria, les étudiant·e·s des collèges et universités ont plus de chances de manger à la maison ou de manger à l’extérieur, notamment parce que leur horaire est plus flexible. Le nombre réel d’étudiant·e·s pour chaque collège et université a été recensé à partir de données du ministère de l’Enseignement supérieur ou des collèges eux-mêmes115.
Dans certains collèges et universités, il existe déjà des projets étudiants de récupération alimentaire, dont la Récup’ de bouffe du comité environnemental de l’Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM116. Aux États-Unis, l’organisation Food Recovery Network mobilise des milliers d’étudiant·e·s pour faire de la récupération alimentaire et des actions de lutte contre l’insécurité alimentaire sur les campus et dans la communauté117. La mise en place d’une réglementation contre le gaspillage alimentaire peut être une occasion de stimuler et de soutenir des réseaux semblables, en partenariat avec les organismes communautaires locaux.
3.1.9Cafétérias
La catégorie « Cafétéria » comprend des cafétérias d’employé·e·s de différentes entreprises et institutions. Les calculs effectués sont basés sur les données de La Tablée des Chefs pour plus de 1 000 collectes en 3 ans dans une quinzaine de cafétérias. L’analyse des données sur trois ans ne montre pas de tendance à la diminution des surplus alimentaires.
3.1.10Garderies
Pour évaluer le potentiel de récupération alimentaire dans les garderies, nous utilisons le taux de don annuel du NRDC pour les écoles en l’ajustant en fonction des besoins alimentaires d’enfants d’âge préscolaire118. Le nombre d’enfants par garderie a été établi à partir de la liste complète des garderies à Montréal119.
Bien que leur potentiel de récupération soit relativement faible, les garderies peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elles peuvent notamment recevoir des produits récupérés dans d’autres établissements, d’autant plus que bon nombre d’entre elles possèdent des cuisines qui peuvent servir à transformer ces aliments.
3.1.11Restaurants à service rapide
Dans le cadre de cette étude, les restaurants à service rapide incluent les catégories suivantes de la DIA : « Restaurant mets pour emporter », « Restaurant service rapide », « Bar laitier », « Bar laitier saisonnier », « Camion-cuisine », « Cantine mobile », « Distributrice automatique » et « Local de préparation ». Les hypothèses utilisées sont les mêmes que pour les restaurants à service complet, mais le taux de don annuel est moindre.
3.1.12Traiteurs
Pour les traiteurs, nous utilisons un taux de don basé sur les données du NRDC. Celui-ci note qu’il y a très peu de sources et de données qui permettent d’évaluer le gaspillage alimentaire pour cette catégorie d’établissement.
3.1.13Cafés et casse-croûte
Cette catégorie comprend les catégories « Casse-croûte » (qui inclut surtout des cafés, mais aussi certains petits comptoirs alimentaires), « Confiserie/chocolaterie » et tous les cafés et casse-croûte qui étaient dans la catégorie « Épicerie avec préparation ». Le taux de don annuel a été calculé à partir de celui du NRDC, qui s’appuie sur les données de Food Donation Connection pour 5 306 cafés120. Les établissements d’une chaîne connue de cafés ont été soustraits du calcul parce que celle-ci a une entente de don des invendus avec Deuxième Récolte.
3.1.14Hôpitaux
Pour les hôpitaux, nous recourons aux données de La Tablée des Chefs pour plus de 3 400 collectes effectuées sur 3 ans dans une vingtaine d’hôpitaux. En parcourant les rapports statistiques annuels des installations de santé et de services sociaux121, nous avons déterminé le nombre de repas servis dans chaque hôpital pour calculer un ratio de kilos récupérés annuellement par repas servi. Nous avons ensuite appliqué ce ratio aux hôpitaux qui n’ont pas déjà un partenariat avec La Tablée122.
Bien que chaque hôpital ait un potentiel de récupération alimentaire important, la plupart d’entre eux récupèrent déjà leurs surplus alimentaires avec La Tablée, d’où un potentiel global additionnel relativement faible. Comme pour les résidences pour personnes âgées, nous supposons que la baisse du nombre de kilos récupérés par repas servi constatée entre 2022 et 2024 est attribuable aux efforts de réduction du gaspillage alimentaire123. Dans le tableau 15, le taux de récupération modeste correspond au taux de récupération plus bas qui suit la réduction du gaspillage, tandis que le taux ambitieux précède cette démarche.
Dans la catégorisation effectuée par la DIA, certains établissements de niveau petit/moyen ont un nombre de repas servis supérieur à des établissements de niveau grand/très grand. Dans tous les cas, puisque tous les hôpitaux sont des établissements d’assez grande taille, il serait justifié que la réglementation s’applique à tous sans distinction de niveau d’activité. Comme ils ne peuvent pas transférer les coûts du gaspillage aux patient·e·s et que ces coûts représentent des sommes qui pourraient être consacrées à d’autres missions, les hôpitaux sont bien placés pour mettre en œuvre une diminution du gaspillage alimentaire.
3.1.15Marchés publics
Pour les kiosques et étals des marchés publics, nous avons obtenu les données de La Récolte engagée, une initiative du Centre de ressources et d’action communautaire Petite-Patrie. Concrètement, La Récolte engagée a installé une chambre froide au marché Jean-Talon pour permettre aux marchands d’y déposer les fruits et légumes invendus de la journée124. Nous avons calculé la médiane des dons par marchand125, le 25e percentile et le 75e percentile depuis 2017 et les avons appliqués aux kiosques et étals des autres marchés publics de Montréal.
Les dons à La Récolte engagée sont volontaires et anonymes. Les responsables du projet ne savent donc pas combien de marchands participent réellement, mais la majorité d’entre eux disent connaître le projet et déposer leurs surplus dans la chambre froide. Les quelques marchands qui ne participent pas évoquent notamment le manque de personnel pour trier les denrées ou bien l’absence de surplus comestibles. Il est possible qu’une obligation de trier et de réaliser un diagnostic de gaspillage mène à une augmentation de la quantité de denrées récupérées auprès de ces marchands.
3.2 Potentiel de récupération alimentaire (autres catégories)
3.2.1Entreposage-distribution et transformation
En raison d’enjeux de confidentialité, il n’a pas été possible d’obtenir des données détaillées de récupération alimentaire auprès d’entreprises de l’entreposage, de la distribution et de la transformation. Par ailleurs, l’étude du NRDC n’a pas calculé le potentiel de récupération alimentaire de ces secteurs. Moisson Montréal indique toutefois dans son rapport annuel avoir récupéré 13 836 454 kg auprès de 457 producteurs, transformateurs, distributeurs et autres partenaires126.
En l’absence de données précises sur les dons effectués par ces compagnies (et compte tenu de la grande diversité des entreprises en question), nous nous sommes plutôt tournés vers des données sur la génération de résidus alimentaires par secteur pour déterminer la part attribuable aux deux secteurs concernés. La fabrication et le commerce de gros produisent ensemble 66,4 % des résidus alimentaires contre 26,4 % pour l’ensemble des commerces et institutions décrits ci-dessus127. Autrement dit, ces deux secteurs (« Entrepôt-distribution » et « Transformation ») produisent environ 2,5 fois plus de résidus alimentaires que les commerces et institutions catégorisés dans « Détaillant-restaurateur ». En appliquant ce ratio au potentiel de récupération alimentaire total calculé pour les 15 catégories de détaillant-restaurateur et en soustrayant les kilos de nourriture déjà récupérés par Moisson Montréal, nous obtenons un potentiel de récupération combiné pour « Entrepôt/distribution » et « Transformation » qui va de 2 252 569 kg (scénario modeste) à 16 245 905 kg (scénario ambitieux). Considérant le plus haut niveau d’incertitude entourant ces calculs, nous donnons ces résultats à titre indicatif sans les inclure dans le potentiel de récupération alimentaire total.
3.2.2Autres établissements
Par manque de données pertinentes ou parce que ces catégories sont trop hétérogènes, nous n’avons pas calculé le potentiel de récupération alimentaire pour les catégories « Autres », « Centre d’accueil », « Entrepôt », « Véhicule de livraison », « Vendeur itinérant » et « Événements spéciaux ». La taille et la nature de ces derniers peuvent varier considérablement, d’où la difficulté de calculer leur potentiel de récupération, mais ils constituent néanmoins une source importante de gaspillage à prendre en compte. Par exemple, La Tablée des Chefs a récupéré plus de 40 000 kg dans une dizaine d’événements en 2024.
La catégorie « Bar salon, taverne » n’a pas été incluse parce que ces établissements servent très peu de nourriture128. À l’exception des boucheries et des poissonneries de niveau grand/très grand, qui ont été ajoutées aux épiceries, le potentiel de récupération alimentaire n’a pas été calculé pour les catégories « Boucherie » et « Poissonnerie » parce que nous ne disposons pas de données sur ces établissements. La récupération alimentaire peut y être plus complexe à gérer (importance de la chaîne du froid), mais ces établissements peuvent fournir un apport considérable en protéines.
Les établissements de la catégorie « Cuisine domestique129 » n’ont pas été intégrés aux calculs parce qu’ils sont trop petits pour être une source substantielle de denrées récupérées. Nous n’avons pas non plus analysé les 409 établissements montréalais qui sont inspectés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments au lieu d’être sous la responsabilité de la DIA. Comme ce sont des entreprises exportatrices qui vendent souvent des volumes importants, il est probable qu’elles recèlent un potentiel de récupération alimentaire substantiel.
Enfin, les organismes d’aide alimentaire n’ont pas été inclus parce qu’ils sont eux-mêmes des acteurs de premier plan de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cependant, lorsque ce n’est pas déjà le cas, il peut être intéressant de tisser des liens entre eux pour qu’ils puissent se soutenir dans la gestion des surplus alimentaires.
3.3 Potentiel de récupération alimentaire total
Le tableau 17 montre le potentiel de récupération alimentaire total pour l’ensemble des commerces et institutions selon le scénario. Comme nous l’expliquons au début du chapitre, il s’agit du potentiel de récupération alimentaire supplémentaire, qui s’ajoute au volume déjà récupéré à l’heure actuelle. Les résultats ont été convertis en tonnes et arrondis à l’unité.
Selon nos calculs, en récupérant les invendus de tous les commerces et institutions de niveau grand/très grand, il serait possible d’aller chercher entre 649 tonnes et 1 636 tonnes de denrées alimentaires. Il s’agit d’une estimation prudente, comme on l’a vu pour chacune des catégories d’établissements. En y ajoutant tous les établissements de niveau petit/moyen, on arrive à un total qui varie de 3 928 tonnes à 9 489 tonnes. Bien que le potentiel par établissement soit plus grand pour les plus gros établissements, le nombre élevé de petits et moyens établissements fait de ceux-ci une source considérable de denrées alimentaires potentiellement récupérables.
Pour avoir une idée de l’ordre de grandeur qu’ils représentent, on peut comparer ces résultats avec les denrées recueillies par Moisson Montréal, dont le programme de récupération alimentaire est le plus important à Montréal. Par rapport au programme de récupération en supermarchés (PRS), le potentiel associé aux établissements de niveau grand/très grand représenterait une hausse de 26 % (scénario modeste) à 66 % (scénario ambitieux) des quantités collectées. Par rapport à l’ensemble des dons reçus par Moisson Montréal (PRS + producteurs, distributeurs, transformateurs et autres partenaires), le potentiel associé aux établissements de niveau grand/très grand représenterait une hausse de 4 à 10 % des denrées récoltées, tandis que le total (grand/très grand et petit/moyen combinés) représenterait une hausse de 24 à 58 %.
Le tableau 17 permet de voir les catégories qui offrent le plus grand potentiel de récupération. Si l’on s’en tient aux établissements de niveau grand/très grand, il s’agit, dans l’ordre, des épiceries, des boulangeries, des résidences pour personnes âgées, des collèges et universités, et des écoles.
3.4 Repas épargnés
Si la nourriture potentiellement récupérable était effectivement donnée, elle représenterait annuellement entre 1,2 et 3 millions de repas pour les établissements de niveau grand/très grand, et entre 7 et 17,5 millions de repas pour l’ensemble des établissements. Le calcul s’appuie sur la norme de 1,2 livre (544 g) par repas proposée par ReFED, un important organisme étasunien de lutte contre le gaspillage alimentaire130.
Il est important de mentionner que le don des surplus peut être un outil pour atténuer l’insécurité alimentaire, mais qu’il ne peut être considéré à lui seul comme une solution durable au problème de l’insécurité alimentaire. La redistribution des surplus n’est pas suffisante pour enrayer la faim et elle n’est pas toujours adaptée aux besoins des ménages précaires. La littérature scientifique sur le sujet démontre en effet que l’insécurité alimentaire n’est pas causée en premier lieu par un manque d’accès aux aliments à proprement parler, mais surtout par une situation financière précaire qui force les ménages à réduire leurs dépenses alimentaires pour pouvoir payer les autres nécessités131. L’élimination de la faim doit donc passer par de réelles politiques de lutte contre la pauvreté qui permettent à l’ensemble de la population d’atteindre un revenu viable132.
Néanmoins, grâce à leurs initiatives de dépannage alimentaire, les organismes d’aide alimentaire jouent un rôle essentiel de soutien auprès des populations les plus vulnérables133. Ils permettent aussi aux citoyen·ne·s de développer leurs capacités (cuisines collectives, groupes d’achat, etc.) et servent souvent de porte d’entrée vers d’autres services sociaux. Au cours des dernières années, le nombre de demandes d’aide alimentaire a augmenté considérablement au Québec, et les intervenant·e·s du milieu déplorent le manque de denrées pour répondre à tous les besoins134. À condition que les organismes soient accompagnés pour que la récupération alimentaire elle-même ne représente pas un fardeau, le don des surplus peut être une source importante d’aliments supplémentaires.
Par ailleurs, au-delà de la quantité d’aliments récupérée, il importe aussi de souligner que l’atteinte d’une véritable sécurité alimentaire implique la capacité de se procurer des aliments nutritifs adaptés à ses goûts et à ses pratiques culturelles. Plusieurs organismes d’aide alimentaire tiennent d’ailleurs compte de ces facteurs pour la nourriture qu’ils distribuent.
3.5 GES évités, quantité d’eau économisée et empreinte matérielle
En utilisant la référence établie par ReFED135, le don des surplus alimentaires permettrait d’éviter l’enfouissement, le don des surplus alimentaires permettrait d’éviter de 2 492 à 6 168 tonnes de GES pour les établissements de niveau grand/très grand et de 14 208 à 34 240 tonnes pour l’ensemble des établissements. Cela équivaut aux émissions annuelles de 581 à 1 439 voitures (grand/très grand) et de 3 314 à 7 987 voitures (tous les établissements)136. Le nombre élevé d’établissements de niveau petit/moyen explique que la quantité de GES évitée soit nettement plus grande lorsque l’on inclut l’ensemble des établissements.
Pour atténuer le plus possible les conséquences environnementales de la récupération alimentaire elle-même, attribuables en grande partie au transport des denrées137, il est préférable de favoriser le développement d’un réseau de récupération alimentaire qui permet de récolter les aliments à l’échelle la plus locale possible. Cela permet de réduire les distances parcourues par les véhicules à moteur utilisés, voire d’envisager des collectes par vélos-cargos ou par vélos avec remorque. En ce qui concerne la collecte de plats préparés, notamment auprès des hôtels et restaurants, pour réduire l’utilisation de plastique à usage unique, il serait possible d’envisager la mise en place d’un système de contenants réutilisables consignés comme l’a fait la ville de Prévost138.
En utilisant les paramètres de ReFED, qui tiennent compte du type d’aliments offerts dans chaque type d’ICI139, le don des surplus alimentaires permettrait d’économiser de 454 267 à 1 078 000 tonnes d’eau pour les établissements de niveau grand/très grand et de 2 300 000 à 5 488 000 tonnes d’eau pour l’ensemble des établissements.
De manière exploratoire, nous estimons que le don des surplus alimentaires permettrait de réduire l’empreinte matérielle du système alimentaire montréalais de 3 816 à 9 613 tonnes pour les établissements de niveau grand/très grand et de 23 083 à 55 759 tonnes pour l’ensemble des établissements. L’empreinte matérielle correspond aux tonnes métriques de matière impliquée dans la production, la distribution et la consommation d’un bien ou d’un service. Elle inclut par exemple des ressources comme le fourrage utilisé pour nourrir les animaux, l’essence utilisée pour les transporter et le plastique requis pour emballer la viande. L’empreinte matérielle permet de tenir compte d’autres dimensions de la crise écologique qui ne sont pas nécessairement prises en compte, comme la destruction d’habitats naturels, l’érosion des sols et la raréfaction des ressources140.
3.6 Coûts envisagés
Le tableau 18 présente une estimation prudente des coûts d’approvisionnement et de transport devant être payés par les organismes de récupération alimentaire pour récupérer les aliments comestibles dont il est question dans ce chapitre. Le calcul s’appuie sur l’analyse effectuée par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) dans une étude réalisée en 2015 sur le modèle de Moisson Montréal. Nous avons pris l’estimation la plus basse et l’estimation la plus haute établies par RCGT et les avons ajustées à l’inflation, puis multipliées par le nombre de kilos correspondant à chacun des scénarios. Nous avons ensuite validé ces estimations en les comparant aux données les plus récentes de Moisson Montréal141. Ce calcul correspond aux frais de fonctionnement pour le volet approvisionnement et transport du travail de récupération alimentaire. Il ne comprend donc pas les frais d’administration, de communication, de loyer, etc. Le calcul porte sur les coûts d’approvisionnement et de transport parce que ceux-ci sont directement corrélés à l’augmentation de la quantité de denrées142, mais il est possible que les autres frais des organismes augmentent aussi dans une moindre mesure. À titre indicatif, dans le cas de Moisson Montréal, la totalité des charges assumées par l’organisation correspond environ à trois fois les frais d’approvisionnement et de transport. De plus, les montants indiqués ci-dessus reflètent des dépenses de roulement : ils n’incluent donc pas l’achat d’équipements additionnels (dont les camions), qui sont abordés à la section suivante. Par ailleurs, l’étude de RCGT concluait que les coûts d’approvisionnement et de transport représentaient environ 2 % de la valeur totale des denrées distribuées143.
Les calculs sont basés sur le modèle de récupération alimentaire de Moisson Montréal, qui détient une expertise de longue date et qui bénéficie d’économies d’échelle importantes. De plus, Moisson Montréal fait principalement affaire avec de grands donateurs, ce qui tend à simplifier la logistique de collecte. La récupération auprès d’un plus grand nombre d’établissements, effectuée par plusieurs organismes de tailles différentes, impliquera vraisemblablement des coûts par kilo plus élevés. Il existe un certain degré d’incertitude quant au coût réel par organisme selon les établissements visés, les méthodes de récupération utilisées, les types d’aliments récoltés, etc. Cependant, les coûts pour les organismes peuvent être minimisés par la création d’un maillage local fort qui permet de réduire les distances et d’optimiser l’utilisation des ressources. C’est dans cet esprit qu’ont été élaborées les recommandations du prochain chapitre144.
CHAPITRE 4 Mise en œuvre et recommandations
Considérant le succès des initiatives réglementaires semblables ailleurs dans le monde et le potentiel de récupération alimentaire élevé des établissements alimentaires montréalais, il semble tout indiqué d’encourager l’adoption à Montréal d’un règlement favorisant le don des surplus alimentaires. La possibilité qu’un tel règlement génère des retombées positives dépendra cependant largement des capacités logistiques des acteurs concernés et des mesures prévues pour les soutenir. Dans les sections suivantes, nous abordons donc certains enjeux vécus par les acteurs de la chaîne alimentaire, puis nous mettons de l’avant des recommandations pour y répondre, notamment par la création d’une instance municipale consacrée à la coordination de la lutte contre le gaspillage alimentaire et par la mise en place de mesures d’accompagnement pour les acteurs du système alimentaire montréalais.
4.1 Les générateurs de résidus alimentaires
Dans le rapport de Recyc-Québec sur la quantification du gaspillage, la très grande majorité des membres de l’industrie agroalimentaire interrogés ont exprimé un « désir altruiste de bien faire les choses145 » en réduisant le gaspillage alimentaire. Les entreprises interrogées ont en même temps dit vouloir obtenir « au moins un certain retour sur investissement, donc elles ne veulent pas jeter (ou donner) les aliments avant que leur durée de conservation soit minimale ou expirée146 ».
Cette volonté de réduire le gaspillage sans pour autant donner les aliments peut expliquer la montée en popularité dans les dernières années de plateformes comme FoodHero ou Too Good To Go, qui permettent aux commerces d’écouler leurs invendus au rabais. D’un côté, plusieurs organismes d’aide alimentaire déplorent que ces applications entraînent une diminution du volume de denrées données, ou encore une baisse de la qualité puisque les aliments sont donnés plus tard, lorsqu’ils n’ont pas trouvé preneur par le biais de ces plateformes147. De l’autre côté, le recours à ces applications semble être efficace pour réduire le gaspillage alimentaire. En contexte de forte hausse du prix des aliments148, il permet aussi à des ménages d’obtenir facilement des produits à plus bas prix, à condition d’avoir accès à un téléphone intelligent capable de télécharger les applications en question.
Dans la littérature scientifique sur le gaspillage alimentaire, les mesures favorisant le don des invendus sont parfois critiquées parce qu’elles relèvent de la gestion des surplus, et non de la réduction à la source et du changement des pratiques qui mènent au gaspillage149. Or, les exemples internationaux de lois sur le don des invendus laissent croire que les deux éléments – prévention et redistribution – peuvent être complémentaires. En premier lieu, les lois elles-mêmes ont eu un effet de sensibilisation à l’enjeu du gaspillage alimentaire. Ensuite, des mesures comme l’obligation de tri et le diagnostic de gaspillage ont amené des entreprises à constater l’ampleur de leur gaspillage et à poser certains gestes pour y remédier. De ce point de vue, la réglementation contre le gaspillage alimentaire a incité certaines entreprises à internaliser une externalité négative.
Enfin, les lois ont participé à la création et à la croissance d’un marché d’entreprises et d’associations sans but lucratif qui offrent des services de réduction du gaspillage alimentaire150. Des entreprises françaises comme Phenix ou Comerso proposent aux entreprises et institutions un accompagnement ou un service clé en main pour se conformer aux lois sur le don des invendus151. Ces options peuvent être avantageuses pour des donateurs qui veulent limiter le temps de travail consacré à la gestion des dons ou qui n’ont pas l’expertise requise. Les entreprises en question proposent en même temps aux commerces et institutions de changer leurs manières de faire pour diminuer les quantités d’invendus. Les entreprises de ce type font généralement leurs profits en prenant une part des montants reçus en crédits d’impôt pour dons alimentaires ou bien en recevant une portion des économies réalisées grâce à la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire.
Il est probable qu’une réglementation montréalaise sur le don des surplus contribue à l’émergence d’entreprises semblables ici. Des organisations comme celles associées à Synergie Québec, qui accompagnent des entreprises et des communautés dans le développement d’une économie circulaire en faisant en sorte que les rejets des uns deviennent les ressources des autres, seraient bien placées pour occuper le nouveau créneau créé par la réglementation152. Il existe par ailleurs des fonds que les entreprises montréalaises peuvent obtenir pour soutenir leurs démarches de réduction du gaspillage alimentaire153.
En France et aux États-Unis, les donateurs de denrées alimentaires peuvent obtenir des réductions d’impôt pour leurs dons. C’est le cas ici aussi. Les avantages fiscaux s’appliquent aux producteurs agricoles et aux entreprises de fabrication et de transformation d’aliments, mais pas aux grossistes, aux distributeurs et aux détaillants-restaurateurs154. Pour connaître le coût de ces dispositions fiscales et évaluer la pertinence de les étendre à d’autres acteurs, nous avons fait une demande d’accès à l’information auprès de Revenu Québec. On nous a cependant indiqué qu’il n’était pas possible de distinguer les dons de denrées alimentaires des autres dons effectués155. Une demande subséquente concernant les dons (en denrées et en argent) faits par des entreprises alimentaires nous a permis d’obtenir des données sommaires qui montrent que le nombre de sociétés qui ont obtenu un crédit d’impôt pour don est moins grand que le nombre de donateurs effectifs156, ce qui laisse croire que davantage d’entreprises pourraient bénéficier de déductions fiscales pour les dons qu’elles font déjà.
La stratégie du gouvernement du Québec en matière de valorisation de la matière organique prévoit la mise en place prochaine de l’obligation pour les ICI de détourner les matières organiques de l’élimination vers des avenues de recyclage157. Dans ce contexte, les aliments donnés représentent autant de matières organiques pour lesquelles les ICI n’ont pas à payer de frais de gestion des matières résiduelles. Une étude soulignait d’ailleurs en 2015 que « […] la collecte de denrées effectuée gratuitement par Moisson Montréal [avait] permis aux 290 fournisseurs d’économiser au moins 1,4 million de dollars en coûts d’enfouissement158 ». Dans une analyse d’impact d’un éventuel règlement sur l’interdiction d’éliminer les résidus alimentaires, RCGT et Stratzer concluent que « [l]a réglementation ajoutera des tâches pour les employés des établissements visés, mais n’amènera pas les établissements à augmenter leur nombre d’employés159 ». Considérant qu’une grande part du travail de collecte sera effectué par les organismes, et compte tenu de la possibilité que la réglementation contribue à une réduction nette du gaspillage, il est probable que la même conclusion s’applique en ce qui concerne la réglementation favorisant le don des invendus.
D’après l’expérience de certaines villes étasuniennes, soutenir financièrement les organismes d’aide alimentaire pour leur donner les moyens de récupérer les invendus alimentaires peut être plus économique que de payer pour l’élimination des résidus alimentaires160. Aux États-Unis, certaines entreprises, comme Goodr, offrent à la fois un service de récupération alimentaire en vue du don à des associations et des services de gestion des matières résiduelles (récupération pour le compostage et réduction des déchets, notamment)161. La combinaison de ces deux types d’activités peut être intéressante, mais le modèle privé risque d’être moins efficace que la prise en charge publique ou la prise en charge par des organismes sans but lucratif de récupération alimentaire, compte tenu des désavantages de la sous-traitance de services publics au secteur privé à but lucratif162.
En France, la loi AGEC a mené à la création d’un « label anti-gaspillage », c’est-à-dire une certification reconnue valorisant les acteurs de la chaîne alimentaire qui contribuent de différentes manières à la réduction du gaspillage alimentaire163. La mise en place d’une certification semblable, à l’échelle montréalaise ou québécoise, pourrait être un incitatif additionnel à la réduction du gaspillage et répondre au désir de reconnaissance des efforts accomplis par des donateurs potentiels lors des consultations organisées par la MIS et la Ville de Montréal164.
Lors de ces consultations, les générateurs ont mentionné le souhait d’avoir de l’accompagnement pour faciliter le don des invendus, un besoin exprimé aussi par les organismes bénéficiaires165.
4.2 Les organismes d’aide alimentaire
Dans un rapport élaboré à partir d’un sondage réalisé auprès d’organismes d’aide alimentaire166, Camille Fleurent indique que la plupart des organismes interrogés sont plutôt favorables à l’adoption d’un règlement sur le don des invendus alimentaires, mais qu’ils expriment des réserves quant aux conséquences d’un tel règlement167. Ces organismes accueillent positivement la possibilité d’obtenir plus de dons pour nourrir leurs bénéficiaires, notamment dans un contexte où ils peinent à répondre à la demande et où plusieurs d’entre eux doivent recourir à l’achat d’aliments. Cependant, certains organismes notent qu’ils n’ont pas les employé·e·s ou les bénévoles nécessaires pour gérer plus de dons. En revanche, d’autres organismes constatent qu’ils ont un nombre suffisant de bénévoles, voire qu’ils doivent en refuser.
Tandis que plusieurs organismes sondés disent avoir les installations pour recueillir plus de dons, d’autres mentionnent que leurs capacités d’entreposage des denrées sont limitées. Le transport des denrées alimentaires est aussi un enjeu fréquemment soulevé par les organismes. En effet, dans le modèle actuel, la plupart des organismes d’aide alimentaire doivent aller chercher les aliments à Moisson Montréal, dont l’entrepôt est situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Pour beaucoup d’organismes, ce déplacement implique de louer un camion et exige des ressources substantielles (temps de déplacement et frais liés au carburant, notamment).
Dans le cadre des consultations organisées par la MIS et par la Ville de Montréal, les organismes d’aide alimentaire ont émis des préoccupations similaires. Ils considèrent que les dons supplémentaires seraient les bienvenus étant donné que les denrées sont présentement insuffisantes pour combler les besoins d’aide alimentaire, mais ils soulignent des défis logistiques auxquels certains d’entre eux font face168. Ces défis incluent notamment le manque d’espace d’entreposage dans certains organismes, le manque de personnel et le manque d’infrastructures nécessaires à la transformation des aliments ou au maintien de la chaîne du froid (réfrigérateurs et congélateurs). Les organismes consultés notent aussi des difficultés associées à la récupération des aliments à Moisson Montréal : temps de déplacement, gestion des horaires, manque de chauffeurs ou chauffeuses et coût de location du camion169.
Pour répondre à ces défis, les organismes consultés proposent plusieurs solutions orientées vers la création d’un réseau décentralisé de récupération alimentaire à l’échelle des quartiers et des arrondissements. Tout en reconnaissant l’importance de Moisson Montréal, qui assure la qualité et l’équité dans le partage des denrées, les organismes proposent le développement de circuits courts et d’ententes directes avec les donateurs pour réduire les distances parcourues et limiter les intermédiaires qui allongent la chaîne de distribution (ce qui retarde l’arrivée des denrées et augmente donc les pertes)170. Ils suggèrent aussi la création d’espaces locaux de mutualisation des ressources et de coordination, entre autres pour éviter la compétition entre les organismes pour l’accès aux denrées. En même temps, les organismes expriment le souhait qu’il y ait un tiers indépendant qui puisse centraliser certains processus, dont la collecte de données, et offrir de la formation et de l’accompagnement.
Ces suggestions font écho à un rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) qui s’appuie sur une enquête auprès d’associations d’aide alimentaire françaises pour recommander des améliorations au système de dons alimentaires en France. L’ADEME constate qu’il y a parfois un éparpillement des efforts et un manque d’organisation territoriale171. Pour surmonter ce problème, elle suggère que les organisations impliquées dans la récupération et la redistribution de denrées participent aux projets alimentaires territoriaux, des initiatives de concertation visant à valoriser les circuits courts. L’ADEME recommande aussi que les associations se rencontrent pour se répartir les jours de collecte, partager les produits en surplus et se doter de moyens logistiques communs (camions, chambres froides, lieux d’entreposage, etc.)172.
Plusieurs initiatives de la sorte existent déjà à Montréal. On peut penser, par exemple, au projet de mutualisation de Bouffe-Action qui permet à plusieurs organismes du quartier Rosemont d’avoir accès régulièrement à des camions réfrigérés173, ou encore à l’ÉpiCamion, un projet semblable dans Le Sud-Ouest174. Puisque l’adoption d’un règlement sur le don des invendus va augmenter le nombre de donateurs et accroître la quantité de denrées, il convient de prévoir la mise en place d’infrastructures pour renforcer les réseaux de collecte existants et soutenir les organismes impliqués.
4.3 Recommandations pour la mise en œuvre réussie de la réglementation et l’accompagnement des acteurs concernés
Dans cette section, nous proposons cinq recommandations pour augmenter le don des surplus et pour faciliter le travail de gestion des invendus effectué par les donateurs et les récupérateurs. Ces recommandations s’inspirent des exemples internationaux, prennent en considération les besoins exprimés par les acteurs du système alimentaire et tiennent compte des défis particuliers posés par la volonté de tirer parti du potentiel de récupération calculé au chapitre 3, qui implique de recueillir des denrées auprès d’un grand nombre de donateurs.
Recommandation 1
- Que la Ville de Montréal se dote le plus rapidement possible d’un règlement favorisant le don des surplus alimentaires inspiré des meilleures pratiques d’autres administrations.
Cette réglementation devrait au minimum inclure l’obligation de trier les aliments comestibles, de réaliser un diagnostic de gaspillage alimentaire et de mettre en place un plan de gestion de la qualité du don qui prévoit la formation et la sensibilisation du personnel. Elle devrait aussi encourager la signature d’ententes de don avec les organismes bénéficiaires, puisque ces ententes clarifient les responsabilités de chacun et offrent une protection minimale contre les dons de mauvaise qualité.
Cette réglementation devrait d’abord s’appliquer à l’ensemble des établissements de niveau grand/très grand (détaillant-restaurateur, entrepôt/distribution et transformation). Comme en France, en Californie et dans l’État de New York, elle pourrait prévoir un délai d’application175 pour permettre aux ICI et aux organismes de redistribution alimentaire de se préparer, mais celui-ci devrait être relativement court considérant que Montréal est en retard par rapport à l’objectif que l’agglomération s’était fixé en 2020, soit de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025176. L’application du règlement aux grands établissements permettrait aux acteurs associés à l’écosystème de la récupération alimentaire (incluant les organismes, les donateurs et la Ville de Montréal) de mettre en place des mesures d’accompagnement, de créer des infrastructures et de développer une expertise qui faciliteraient ensuite l’extension du règlement à d’autres acteurs de la chaîne alimentaire.
En effet, étant donné l’ampleur du gisement de denrées que représentent les établissements de niveau petit/moyen, le règlement devrait progressivement être étendu à l’ensemble des établissements en fonction de leur taille. Pour ce faire, il pourrait être judicieux que le diagnostic de gaspillage alimentaire et la déclaration obligatoire s’appliquent immédiatement à tous les établissements, ce qui permettrait d’avoir une meilleure idée de la quantité de résidus alimentaires produite par chaque établissement pour pouvoir les classer de manière plus fine. L’obtention de données sur les quantités de résidus alimentaires générées permettrait en effet de déterminer plus précisément des seuils pour appliquer la réglementation graduellement aux établissements de niveau petit/moyen, en commençant par ceux qui produisent le plus de matières organiques.
Dans son plan directeur de gestion des matières résiduelles, la Ville de Montréal estimait que la valeur du gaspillage alimentaire évitable dans l’agglomération était d’environ 1,1 milliard de dollars par année, soit l’équivalent d’un peu plus de 1 100 dollars par ménage177. Bien que la récupération alimentaire demande une organisation logistique importante, elle peut avoir un rapport coût-bénéfice très positif. Par exemple, la banque alimentaire Moisson Montréal estime que chaque dollar qu’elle dépense permet de distribuer plus de 15 dollars de nourriture178.
Pour accompagner les donateurs et les organismes d’aide alimentaire dans la mise en œuvre de la réglementation, nous avançons la proposition suivante :
Recommandation 2
- Que la Ville de Montréal se dote d’un service de coordination de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans le cadre de la démarche pour favoriser le don des invendus, ce service pourrait faciliter la création de partenariats, notamment en préparant un modèle d’entente de don comme le font la France et la Californie179. Il pourrait créer une plateforme pour la mise en commun de données sur les donateurs, les organismes et la collecte de denrées, en plus d’offrir de l’accompagnement pour gérer la collecte et l’analyse des données, comme l’ont suggéré des organismes durant les consultations. De même, le service pourrait aider les organismes avec des tâches administratives comme la gestion des reçus du crédit d’impôt pour dons alimentaires. Dans un souci d’amélioration constante et de partage de l’expérience montréalaise avec d’autres administrations qui voudraient aller dans le même sens, le service pourrait produire un rapport annuel sur l’avancée de la lutte contre le gaspillage alimentaire, comme le fait l’État de New York.
Le NRDC fournit des conseils pour l’embauche d’une personne coordonnatrice à la lutte contre le gaspillage alimentaire180. En plus de s’assurer de la collaboration avec les autres services municipaux concernés par cette question, l’équipe du service aiderait à la consolidation des liens entre les donateurs et les organismes, ainsi qu’entre les organismes eux-mêmes. Elle veillerait à atténuer les disparités entre territoires en ce qui concerne les infrastructures et les ressources disponibles181, par exemple en soutenant la création de projets de récupération alimentaire dans les quartiers où il n’y en a pas.
Suivant l’exemple de l’État de New York, il serait pertinent que le service municipal ait une ligne téléphonique et un courriel pour répondre aux questions des donateurs et des organismes au sujet de la réglementation et, plus généralement, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le service pourrait orienter les donateurs et les organismes vers les ressources utiles et offrir du soutien technique, de l’accompagnement personnalisé et du partage de bonnes pratiques.
Considérant que la littérature scientifique et les mesures internationales les plus avancées insistent sur l’importance de la prévention et sur la nécessité d’agir en amont pour éviter de générer des excédents alimentaires, le service municipal devrait avoir un mandat large de soutien à la réduction du gaspillage alimentaire. La mise en place du don des invendus constituerait sa première mission, mais il pourrait ensuite soutenir d’autres initiatives en fonction des meilleures pratiques, comme des projets de réduction à la source, de sensibilisation du public et de développement d’une économie circulaire (notamment par la revalorisation de résidus alimentaires généralement jugés non comestibles qui peuvent le devenir s’ils sont transformés).
La mission du service municipal ne serait pas de se substituer aux organismes du système alimentaire montréalais, mais de leur offrir de l’aide dans la réalisation de leur travail. En ce sens, son rôle serait amené à évoluer en fonction des besoins identifiés par les acteurs du milieu. Le service agirait aussi comme point de référence pour répondre aux questions sur la réglementation et pour rediriger les personnes vers les organismes appropriés. En elle-même, la réglementation sur le don des invendus contribuera probablement à une plus grande mobilisation des acteurs concernés par rapport à l’enjeu du gaspillage alimentaire, mais ses effets seront multipliés si elle s’accompagne d’une infrastructure de soutien appropriée.
Nous considérons que la création d’une entité municipale dédiée à ces tâches constituerait une manière d’assurer une gouvernance claire et un bon suivi de la mise en œuvre de la réglementation. De plus, cela permettrait d’alléger le poids potentiel de la réglementation pour les organismes d’aide alimentaire, dont certains ont souligné leur manque de ressources182 et leur désir d’être accompagnés, notamment pour les tâches administratives. Par ailleurs, la création d’une instance municipale offrirait une certaine pérennité institutionnelle et un point d’accès facilement identifiable pour les acteurs touchés par l’enjeu du gaspillage alimentaire. La proposition s’inspire en partie de l’exemple californien, où l’organisme public CalRecycle et les administrations locales sont amenées à jouer un rôle proactif. Une autre option serait d’adopter une approche semblable à celle de l’État de New York, qui a confié plusieurs tâches de soutien à des organismes à but non lucratif.
Les recommandations suivantes peuvent être considérées comme des ingrédients de base à réunir pour faciliter l’implantation de la réglementation dans les quartiers de Montréal. Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous privilégions la voie du service municipal, mais ces propositions pourraient aussi être mises en œuvre par des organismes communautaires, par des instances de concertation locales, par les arrondissements ou par un partenariat entre ces différents acteurs183.
Recommandation 3
- Que le service municipal de lutte contre le gaspillage alimentaire soutienne le renforcement des réseaux locaux de récupération alimentaire, notamment en finançant l’achat d’un camion et l’embauche d’un chauffeur ou d’une chauffeuse par quartier ou arrondissement.
Compte tenu du grand nombre d’établissements alimentaires concernés et des besoins exprimés par les organismes d’aide alimentaire, le succès de la réglementation sur le don des invendus sera d’autant plus grand si la Ville soutient l’émergence et la consolidation d’écosystèmes de redistribution à l’échelle des quartiers, comme le recommandait déjà la consultation publique sur la cessation du gaspillage184. Loin de remplacer le travail essentiel de Moisson Montréal auprès des grands donateurs de denrées, ces écosystèmes peuvent être complémentaires puisqu’ils viennent combler un maillon manquant de la chaîne de redistribution alimentaire. Les moyens logistiques (camion, équipements, personnel, etc.) mis en place à l’échelle locale permettraient en effet d’organiser plus facilement des tournées de récupération dans les nombreux établissements de petite et moyenne taille qui seraient visés par la réglementation, alors que Moisson Montréal a surtout développé une expertise de récupération auprès des plus gros établissements, comme les supermarchés et les grossistes majeurs.
L’achat de camions répond à un souci exprimé par les organismes, pour lesquels le transport des denrées peut être un fardeau significatif. Il répond aussi au premier défi qui sera posé par la mise en place de la réglementation, soit l’augmentation du nombre de donateurs à desservir185. Les camions pourraient être mis à la disposition de plusieurs organismes en fonction des besoins identifiés au niveau local. L’embauche de chauffeurs ou chauffeuses professionnel·le·s peut réduire les risques d’accident ou de dommages et assurer un meilleur entretien des véhicules, en plus de permettre au personnel des organismes de se consacrer à d’autres tâches. Qu’une personne soit attitrée à cette fonction de manière permanente offre aussi une constance qui peut aider à solidifier les liens entre les donateurs et les organismes. Les personnes embauchées joueraient de fait un rôle essentiel qui irait au-delà de la conduite du camion : rencontres avec les donateurs, tri préalable sur place, transfert d’informations au personnel des organismes d’aide alimentaire, etc.
Le tableau 19 présente les coûts initiaux et récurrents de l’achat de camions réfrigérés avec chauffeurs et chauffeuses. Nous présentons un scénario modeste (1 par arrondissement, soit 19 en tout) et un scénario ambitieux (1 par quartier, en nous référant aux territoires délimités par les 32 tables de quartier186). Pour le prix des camions, nous avons pris les montants maximaux du guide du Collectif Récolte produit dans le cadre du programme Système alimentaire local et intégré à Montréal (SALIM). Nous avons inclus une unité de réfrigération. Pour les chauffeurs et les chauffeuses, nous nous appuyons sur la convention collective des cols bleus et nous ajoutons un modificateur basé sur l’Enquête sur la rémunération globale de l’Institut de la statistique du Québec pour tenir compte de l’ensemble des coûts pour l’employeur.
Dans les territoires où il y a déjà des camions mutualisés, les montants prévus pourraient soit servir à l’achat d’un camion additionnel pour augmenter le potentiel de récupération, ou bien servir à financer d’autres équipements de collecte, comme des vélos électriques avec remorque là où la géographie le permet. Ils pourraient aussi servir à financer l’achat d’autres équipements utiles, comme du matériel d’entreposage, des réfrigérateurs et des congélateurs.
Recommandation 4
- Qu’un·e spécialiste en approvisionnement local communautaire soit embauché dans chaque quartier ou arrondissement.
Le concept de spécialiste en approvisionnement local communautaire (SALC) a été élaboré par l’équipe du SALIM en collaboration avec des organismes communautaires. Il s’agissait d’embaucher une personne qui servirait plusieurs organismes et qui aurait comme objectif de faciliter l’approvisionnement des organismes participants en aliments locaux et sains, notamment en créant des liens avec des producteurs locaux et en facilitant différents processus logistiques187. L’idée a été testée avec succès lors d’un projet-pilote dans le Grand Sud-Ouest en 2022.
La présence d’un·e SALC dans chaque quartier ou arrondissement pourrait jouer un rôle crucial dans l’extension de la récupération alimentaire à Montréal. Dans chaque territoire, la personne attitrée pourrait aider à tisser des partenariats entre les donateurs et les récupérateurs. Elle pourrait encourager certains donateurs, notamment les écoles, les institutions d’enseignement supérieur et les garderies, à s’impliquer activement dans la démarche de récupération alimentaire. De plus, elle pourrait coordonner des efforts de formation et de sensibilisation auprès des donateurs pour assurer la bonne qualité des dons.
Le ou la SALC pourrait aussi faire le pont entre les organismes pour veiller à ce que les aliments soient répartis de manière optimale en fonction de la main-d’œuvre disponible, de l’infrastructure en place et des besoins d’aide alimentaire. En développant une connaissance fine de la réalité locale, le ou la SALC pourrait, par exemple, constater que la cuisine d’une école est sous-utilisée et qu’elle pourrait servir à transformer des aliments sur le point de périr, ou encore qu’un organisme a des espaces de stockage inutilisés qu’il pourrait partager avec d’autres membres du réseau de lutte contre le gaspillage188. Le ou la SALC pourrait aussi aider à trouver de nouveaux débouchés pour les aliments en surplus189. Il s’agirait en somme de trouver différentes méthodes pour fluidifier le travail de liaison et d’organisation qui est au cœur de la récupération alimentaire.
Le projet pilote de SALC dans le Grand Sud-Ouest a montré qu’un facteur de réussite était que les processus administratifs soient sous la responsabilité d’un « organisme-moteur ». À l’inverse, le roulement du personnel dans les organismes et les capacités financières différentes de ceux-ci sont apparus comme des défis du projet190. Pour surmonter ces défis et pour assurer une certaine coordination entre les SALC de chaque territoire, il serait sans doute pertinent que ceux-ci et celles-ci soient embauché·e·s par l’éventuel service municipal de lutte contre le gaspillage alimentaire ou par une autre instance permanente chargée d’accompagner les organismes de récupération alimentaire.
Le tableau 20 présente le coût approximatif de l’embauche des SALC en s’appuyant sur la convention collective des cols blancs de la Ville de Montréal.
Les recommandations 3 et 4 combinées auraient un coût total initial de 6 320 000 dollars (scénario modeste) à 10 644 000 dollars (scénario ambitieux) et un coût récurrent de 4 040 000 dollars (modeste) à 6 804 000 dollars (ambitieux). Ces deux mesures fourniraient des éléments de base pour faciliter le travail des organismes et pour déterminer les infrastructures nécessaires dans chaque territoire en tenant compte de ce qui existe déjà et de ce qui peut être développé. À ce sujet, dans la première année de mise en œuvre de la réglementation, les SALC joueraient un rôle essentiel de cartographie des besoins logistiques propres à chaque territoire.
Dans un deuxième temps, là où le besoin se fait sentir, il serait possible d’envisager la création de pôles logistiques complets qui pourraient être utilisés par plusieurs organismes et qui incluraient des locaux pour le tri, des espaces de stockage et de réfrigération, des cuisines de transformation, etc. De tels pôles pourraient servir aussi à d’autres types d’organismes, par exemple en agriculture urbaine. Ils pourraient aussi s’arrimer aux plans de développement de communautés nourricières dont certains arrondissements se sont dotés191. Ces pôles pourraient être élaborés en partenariat avec Moisson Montréal, qui a récemment créé le projet pilote du Pôle de l’Est de Montréal pour décentraliser la distribution des ressources alimentaires en réponse à des besoins identifiés par les organismes du secteur192.
À titre indicatif, au tableau 21, nous avons calculé le coût de la construction de petites cuisines de transformation en utilisant la méthode de calcul élaborée dans l’étude de l’IRIS sur les coûts d’un programme d’alimentation scolaire universel. Le coût comprend seulement l’aménagement de la cuisine, en considérant, d’une part, que la location ou l’achat d’un local peut varier considérablement selon les quartiers et, d’autre part, qu’il est possible, notamment par le biais des SALC, de trouver des locaux qui pourraient être utilisés à cette fin.
Recommandation 5
- Qu’un fonds soit créé pour renforcer les capacités logistiques des organismes de récupération alimentaire et d’aide alimentaire existants.
Comme on l’a vu, il existe un vigoureux système de récupération alimentaire à Montréal. Après l’adoption de la réglementation sur le don des invendus, plusieurs organismes déjà actifs seront forcément appelés à en faire plus et auront donc besoin de capacités logistiques additionnelles. Dans la mesure où ces organismes détiennent déjà de l’expertise et possèdent déjà certaines infrastructures appropriées, le renforcement de leurs capacités apparaît comme un moyen efficace de soutenir la récupération et la redistribution alimentaires en misant sur les forces du réseau actuel. Le montant total alloué à ce fonds pourrait être déterminé à partir d’une enquête menée par le service municipal de coordination de la lutte contre le gaspillage auprès des organismes du système alimentaire montréalais. Le soutien financier du gouvernement québécois constituerait un atout précieux pour assurer le succès de la réglementation et répondrait aux pistes de réduction du gaspillage alimentaire abordées dans la Politique bioalimentaire 2018-2025193.
À titre comparatif, l’État de New York a accordé 6,4 millions de dollars américains aux banques alimentaires et aux organismes d’aide alimentaire lors de la mise en place de la loi sur le don des invendus194. En 2024, Moisson Montréal a mis en place un programme de bourses destinées aux organismes et visant à financer l’achat d’équipements essentiels pour soutenir les personnes en situation de précarité. Moisson Montréal indique qu’elle a accordé 2 millions de dollars, mais qu’il aurait fallu au moins 5 millions de dollars pour financer l’ensemble des projets soumis195. Dans le contexte de la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation, les besoins seraient probablement supérieurs.
***
Prises ensemble, ces recommandations aideraient les donateurs et les organismes à s’ajuster au nouveau contexte réglementaire et à relever le défi d’une extension de la récupération alimentaire. La création d’un service municipal de coordination de la lutte contre le gaspillage alimentaire (ou d’un organisme équivalent) assorti de moyens conséquents pour soutenir la récupération alimentaire à l’échelle des quartiers – en fournissant des véhicules avec chauffeurs et chauffeuses, en embauchant du personnel de coordination locale et en prévoyant un fonds pour renforcer les capacités logistiques des organismes – donnerait une impulsion positive au réseau actuel de collecte de denrées. Les estimations présentées dans cette étude démontrent qu’il existe un potentiel de récupération substantiel, tandis que l’analyse des expériences française et étasuniennes montre que l’adoption de règlements sur le don des invendus aide à mieux structurer le milieu de la récupération alimentaire et à accroître la quantité de dons recueillis. En s’inspirant des meilleures initiatives de ces États, la Ville de Montréal pourrait devenir une précurseure dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au Québec et au Canada. Le futur règlement montréalais pourrait ensuite potentiellement servir de prototype pour d’autres villes et pour l’ensemble du Québec.
1 FAO, Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention, 2011, p. v.
2 DEUXIÈME RÉCOLTE, La crise évitable du gaspillage alimentaire, 2019, p. 5.
3 DEUXIÈME RÉCOLTE, La crise évitable du gaspillage alimentaire : mise à jour, 2024, p. 6.
4 L’étude de Recyc-Québec fait une distinction entre les aliments comestibles perdus ou gaspillés (ACPG) et les parties non comestibles associées (PNCA), alors que Deuxième Récolte parle plutôt de gaspillage évitable et inévitable pour désigner des réalités similaires. Alors que les ACPG peuvent être consommés tels quels, les PNCA sont en grande partie des résidus alimentaires non comestibles, mais incluent aussi des parties d’aliments qui peuvent être comestibles ou non en fonction des normes culturelles (ex., épluchures de carottes et tiges de brocoli) ou qui sont jetées, mais qui pourraient être rendues comestibles si elles étaient transformées (ex., production de bouillon à partir d’os d’animaux ou de marmelades à partir de pelures d’agrumes). Le premier pourcentage indiqué correspond à la somme des deux catégories (ACPG + PNCA) par rapport à l’ensemble de la nourriture produite, tandis que le deuxième pourcentage indiqué correspond aux ACPG (ou gaspillage évitable) par rapport à la somme des ACPG et des PNCA. RECYC-QUÉBEC, Étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaires au Québec, 2022, p. 8.
5 FAO, op. cit., p. 1.
6 MOISSON MONTRÉAL, Bilan-Faim 2024 : un record alarmant.
7 Marie MOURAD, De la poubelle à l’assiette : contre le gaspillage alimentaire, Paris, L’Harmattan, 2022, p. 15-16.
8 Ibid., p. 79.
9 Ibid., p. 16.
10 Ibid., p. 145.
11 DEUXIÈME RÉCOLTE, op. cit., p. 14. Les autres secteurs mentionnés sont la distribution (13 %), le stockage/classement (13 %) et les pertes avant les récoltes (5 %).
12 Carrie Julia BRADSHAW, « Waste Law and the Value of Food », Journal of Environmental Law, vol. 30, no 2, 2018, p. 2. Julia SZULECKA, Carrie BRADSHAW et Ludovica PRINCIPATO, « Food Waste Governance Architectures in Europe: Actors, Steering Modes, and Harmonization Trends », Global Challenges, vol. 8, no 11, 2024, p. 4.
13 Clara CICATIELLO et Silvio FRANCO, « Disclosure and Assessment of Unrecorded Food Waste at Retail Stores », Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 52, 2020.
14 Bree DEVIN et Carol RICHARDS, « Food Waste, Power, and Corporate Social Responsibility in the Australian Food Supply Chain », Journal of Business Ethics, vol. 150, no 1, 2018.
15 MOURAD, op. cit., p. 73.
16 Daniel N. WARSHAWSKY, « The Devolution of Urban Food Waste Governance: Case Study of Food Rescue in Los Angeles », Cities, vol. 49, 2015.
17 Marie MOURAD, La lutte contre le gaspillage alimentaire en France et aux États-Unis : mise en cause, mise en politique et mise en marché des excédents alimentaires, thèse de doctorat (sociologie), Paris, Institut d’études politiques, 2018, p. 288.
18 « Lutte contre le gaspillage alimentaire : les lois françaises », Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2024, agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises (page consultée le 20 janvier 2025).
19 SZULECKA, BRADSHAW et PRINCIPATO, op. cit., p. 8.
20 Projet de loi no 393 : Loi visant à lutter contre le gaspillage alimentaire (présenté par madame Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun), Assemblée nationale du Québec, Québec, Éditeur officiel du Québec, 2023. Projet de loi no 697 : Loi visant à lutter contre le gaspillage (présenté par monsieur Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine), Assemblée nationale du Québec, Québec, Éditeur officiel du Québec, 2024.
21 Projet de loi C-360 : Loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à réduire la quantité d’aliments gaspillés au Canada (présenté par madame Bonita Zarillo, députée de Port Moody —Coquitlam), Chambre des communes du Canada, Parlement du Canada, 2023.
22 « Demande de consultation publique : faire cesser le gaspillage alimentaire à Montréal », Ville de Montréal, 2019, montreal.ca/petitions/detail/5d0d49bcfa6f9100107a5fa3?fbclid=IwAR34W1RMReaeusG5xOi1ft8L9VP8UJ974Ar6HH2BVyRMRuDh3Hx68ifR60s (page consultée le 14 juillet 2025).
23 COMMISSION PERMANENTE SUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS, Consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire : rapport et recommandations, 2021, p. 26.
24 Ibid., p. 18
25 MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE, Expérimentation réglementaire pour la cessation du gaspillage alimentaire, 2024, p. 5.
26 MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE, Rapport de la phase de prototypage, 2025, p. 9.
27 « Établissements alimentaires », Données Montréal, 2025, donnees.montreal.ca/dataset/etablissements-alimentaires (page consultée le 14 juillet 2025). Les données proviennent de la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.
28 Dans une phase subséquente de la démarche réglementaire montréalaise, il a été suggéré que le diagnostic pourrait être une mesure volontaire plutôt qu’une obligation.
29 « Ensure sustainable consumption and production patterns », United Nations, 2025, sdgs.un.org/goals/goal12#targets_and_indicators (page consultée le 28 janvier 2025).
30 « Food waste reduction targets », European Commission, 2025, food.ec.europa.eu/food-safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-reduction-targets_en?prefLang=fr (page consultée le 28 janvier 2025).
31 « LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire », Légifrance, 2025, www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/ (page consultée le 15 juillet 2025).
32 « Don alimentaire : un modèle de convention entre distributeurs et associations », Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2025, agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations (page consultée le 15 juillet 2025).
33 Le coût de revient correspond au coût de production et de distribution du produit. Il est donc différent du prix de vente, qui inclut aussi une marge de profit.
34 Barbara REDLINGSHÖFER, « Le gaspillage alimentaire dans les villes : une approche par le métabolisme urbain pour éclairer les politiques », Techniques Sciences Méthodes, no 1/2, 2024, p. 63.
35 Graziella MELCHIOR et Guillaume GAROT, Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 du Règlement par la commission des affaires économiques sur l’évaluation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, Assemblée nationale (France), 2019.
36 EY, Evaluation of the Application of the Provisions of the Law of 11 February 2016 on the Fight Against Food Waste, and the Implementing Decree of 28 December 2016, Synthesis of the Final Report, Ministry of Agriculture and Food, 2019.
37 « Les évolutions réglementaires », Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2024, agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-les-lois-francaises (page consultée le 20 janvier 2025).
38 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, Comprendre les causes des pertes alimentaires au sein des associations de don alimentaire, les mesurer et tester des actions de réduction, 2023. AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, Quelles solutions pour un don alimentaire de meilleure qualité? Constats et recommandations, 2023.
39 Orphée DAILLET, « Loi Garot : comment la France a fait du gaspillage alimentaire un levier pour lutter contre la précarité alimentaire », Sciences & Avenir, 24 octobre 2024, www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/reportage-loi-garot-comment-la-france-a-fait-du-gaspillage-alimentaire-un-levier-pour-lutter-contre-la-precarite-alimentaire_181695.
40 Caroline ADAM, « À Herstal, les supermarchés doivent donner les invendus aux démunis », RTBF, 12 juillet 2012, www.rtbf.be/article/a-herstal-les-supermarches-doivent-donner-les-invendus-aux-demunis-7803622.
41 Romane BONNEMÉ, « Gestion des invendus alimentaires : obligations, incitants et réglementations, selon que vous serez… franchisés ou intégrés… », RTBF, 31 mars 2023, www.rtbf.be/article/gestion-des-invendus-alimentaires-obligations-incitants-et-reglementations-selon-que-vous-serez-franchises-ou-integres-11174363.
42 Maïté WARLAND, « “Nous ne sommes pas la poubelle des grandes surfaces” : le secteur de l’aide alimentaire demande plus de contrôle sur les dons », RTBF, 6 novembre 2023, www.rtbf.be/article/nous-ne-sommes-pas-la-poubelle-des-grandes-surfaces-le-secteur-de-l-aide-alimentaire-demande-plus-de-controle-sur-les-dons-11282187.
43 FÉDÉRATION DES SERVICES SOCIAUX, Plaidoyer des plateformes logistiques de l’aide alimentaire : les plateformes logistiques de l’aide alimentaire sont menacées. Premières victimes : les plus démunis, 2024, p. 14.
44 Anthony PLANUS, « Bruxelles va plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire », Gondola, 15 mars 2024, www.gondola.be/fr/news/bruxelles-va-plus-loin-dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire.
45 « Le gouvernement bruxellois fait un pas de plus pour la réduction du gaspillage alimentaire dans les supermarchés », Maron Trachte, 2024, maron-trachte.brussels/2024/03/14/le-gouvernement-bruxellois-fait-un-pas-de-plus-pour-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-dans-les-supermarches/ (page consultée le 17 juillet 2025).
46 Clémence LEPLA, « En Espagne, une loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire », The Conversation, 30 juin 2025, theconversation.com/en-espagne-une-loi-pour-lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire-257361.
47 « Europe : quand les gouvernements s’engagent contre le gaspillage », Phenix, 2022, www.wearephenix.com/pro/europe-quand-les-gouvernements-sengagent-contre-le-gaspillage/ (page consultée le 19 mars 2025).
48 Carrie BRADSHAW, « Good Samaritan Laws and Surplus Food Redistribution: a Solution in Need of a Problem? », Briefing Paper, School of Law, University of Leeds, 2024.
49 LÉGISQUÉBEC, « Article 1471 », Code civil du Québec, Publications Québec, www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/CCQ-1991?code=se:1471&historique=20230814.
50 « U. S. Food Waste Policy Finder », REFED, 2025, policyfinder.refed.org/?category=recovery&key=tax-incentives (page consultée le 17 juillet 2025).
51 « Food Recovery Questions and Answers », CalRecycle, 2025, calrecycle.ca.gov/organics/slcp/faq/foodrecovery/ (page consultée le 18 juillet 2025).
52 « Commercial edible food generators are required to arrange to recover the maximum amount of their edible food that would otherwise be disposed. » CALRECYCLE, SB 1383 Model Food Recovery Agreement : CalRecycle Statewide Webinar, 2020, p. 12.
53 MOURAD, 2022, op. cit., p. 169.
54 « SB 1383 Food Waste Regulations: Key Topics Overview », California Association of Food Banks, www.cafoodbanks.org/wp-content/uploads/2021/02/SB1383_Overview.pdf (page consultée le 21 janvier 2025)
55 CALRECYCLE, 2020, op. cit., p. 7.
56 Ibid., p. 27.
57 MOURAD, 2022, op. cit.
58 CALRECYCLE, 2025, op. cit.
59 « California’s Climate Progress on SB 1383 », CalRecycle, 2025, calrecycle.ca.gov/organics/slcp/progress/ (page consultée le 18 juillet 2025).
60 CALIFORNIA ASSOCIATION OF FOOD BANKS, Costs & Benefits of SB 1383: Food Bank Data & Perspectives, 2025, p. 6.
61 Ibid., p. 9.
62 Ibid., p. 10. Calculs de l’IRIS.
63 Des responsables québécois de la récupération alimentaire que nous avons rencontré·e·s nous ont fait part du même constat, à savoir que l’éducation auprès des employé·e·s des commerces donateurs devait être refaite régulièrement, notamment en raison du roulement de personnel.
64 Ibid., p. 17.
65 Ibid., p. 22
66 Ces dispositions réglementaires ne s’appliquent pas à la Ville de New York, qui a sa propre réglementation. Celle-ci n’inclut pas d’équivalent du don obligatoire des invendus. Cela dit, l’organisme new-yorkais City Harvest, fort de ses 160 employé·e·s et de ses 20 000 bénévoles, a été parmi les premiers à organiser des tournées de « food rescue » dans les années 1980. Il a été une des sources d’inspiration de Moisson Montréal. « NYS Food Donation and Food Scraps Recycling Law. Legislative Guidance », Department of Environmental Conservation, 2021, extapps.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/foodscrapsleg.pdf (page consultée le 28 janvier 2025). MOURAD, op. cit., p. 69. « Parler sans faim : le podcast de Moisson Montréal – épisode 1 – M. Pierre Legault », Moisson Montréal, 2025, www.youtube.com/watch ?v=naT12Oab-WI&list=PLELjn8vJ4tPpjJ7hNMW__JxpktUpjmaIo&index=6&ab_channel=MoissonMontr%C3 %A9al (page consultée le 21 juillet 2025).
67 « All designated food scraps generators shall separate their excess edible food for donation for human consumption to the maximum extent practicable. » « TITLE 22 Food Donation and Food Scraps Recycling. SECTION 27-2203 Designated food scraps generator responsibilities », The New York State Senate, 2025, www.nysenate.gov/legislation/laws/ENV/27-2203 (page consultée le 21 juillet 2025).
68 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, Summary of Express Terms – 6 NYCRR PART 350 – Food Donation and Food Scraps Recycling, 2025, p. 4.
69 Ibid., p. 8.
70 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, New York State Food Donation and Food Scraps Recycling Law. Report to the Governor and Legislature, 2023, p. 16.
71 Ibid., p. 10-11.
72 Ibid., p. 15
73 Les données plus récentes ne sont pas disponibles puisque le rapport 2023 présente les données de 2022 et que le rapport 2024 n’a pas encore été rendu public.
74 Ibid., p. 5.
75 Ibid., p. 6.
76 Cole ROSENGREN, « New York Gov. Hochul signs law expanding organics recycling mandate », Waste Dive, 15 mai 2024, www.wastedive.com/news/new-york-state-expand-organics-recycling-food-donation/716122/.
77 « Ce qu’il faut savoir de la loi AGEC ; la loi anti gaspillage et ses évolutions », Phenix, www.wearephenix.com/pro/loi-agec-loi-anti-gaspillage/, (page consultée le 21 juillet 2025).
78 Il est d’ailleurs intéressant de noter que la France a accordé très peu de financement additionnel aux banques alimentaires et aux associations d’aide alimentaire alors qu’elles en demandaient, tandis que la Californie et l’État de New York ont tous les deux prévu des subventions dès le départ. MOURAD, 2022, op. cit., p. 168.
79 « Our experts », Natural Resources Defense Council, 2025, www.nrdc.org/experts (page consultée le 22 juillet 2025). JoAnne BERKENKAMP et Caleb PHILLIPS, Modeling the Potential for Food Rescue: Denver, New York City and Nashville, 2017.
80 La liste de tous les établissements alimentaires peut être consultée en ligne : « Établissements alimentaires », Ville de Montréal, 2025, donnees.montreal.ca/dataset/etablissements-alimentaires (page consultée le 22 juillet 2025).
81 La déclaration obligatoire de données sur la gestion des matières résiduelles, prévue dans la démarche réglementaire montréalaise présentée ci-dessus, permettrait de voir jusqu’à quel point le niveau d’activité est associé à la quantité de résidus alimentaires générés et, par conséquent, de préciser les seuils d’application du règlement.
82 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC, Guide d’application. Permis de vente au détail et de restauration, 2024.
83 Des membres de la direction de Moisson Montréal ont été consultées dans le cadre de cette étude, ce qui a permis de mieux connaître la réalité de l’organisme, mais les données détaillées de collecte n’ont pas pu être partagées pour des raisons de confidentialité. Les données présentées proviennent donc des rapports annuels de l’organisme.
84 MOISSON MONTRÉAL, Rapport annuel 2024-2025. Innover pour mieux nourrir : 40 ans de leadership en sécurité alimentaire, 2025, p. 17
85 Ibid., p. 18.
86 LA CORBEILLE, La saine alimentation, un défi alimenterre. Rapport 2024-2025, 2025, p. 2. Communication de l’auteur avec le chargé de projet.
87 BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT, Nourri par la communauté. Rapport annuel 2024-2025, 2025.
88 LA TABLÉE DES CHEFS, données partagées avec l’auteur.
89 Par exemple, Deuxième récolte récupère des denrées alimentaires, mais en donne une partie à Moisson Montréal. Mission Bon accueil fait de la récupération tout en étant bénéficiaire des opérations de récupération de Moisson Montréal.
90 Par exemple, des organismes montréalais peuvent recevoir des denrées provenant d’établissements situés à l’extérieur de Montréal. Ces denrées s’ajoutent donc à la quantité totale récupérée sans toutefois réduire le potentiel de récupération alimentaire des établissements montréalais.
91 En 2022, à partir d’un sondage auprès d’acteurs du système alimentaire québécois, Recyc-Québec évaluait à 23 000 tonnes la quantité d’aliments comestibles excédentaires récupérés pour être redistribués aux populations vulnérables en situation d’insécurité alimentaire dans l’ensemble du Québec. RECYC-QUÉBEC, op. cit., p. 27.
92 Pour des raisons méthodologiques qui seront expliquées à la section pertinente, les secteurs d’activité entrepôt/distribution et transformation font l’objet d’un traitement séparé.
93 Ce mode de présentation nous a semblé le plus pertinent pour bien voir le potentiel de récupération global.
94 Selon le guide du MAPAQ, la superficie des épiceries-boucheries peut varier entre 400 et 2 500 mètres carrés. MAPAQ, op. cit., p. 36.
95 Le choix de prendre les six plus petites épiceries dans les scénarios modestes et les quatre plus grandes pour le scénario grand/très grand ambitieux reflète des profils de collecte qui émergent de l’analyse des données. Il permet de faire une estimation qui tient partiellement compte des différents types d’épiceries (petites fruiteries par rapport aux moyennes surfaces, par exemple).
96 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, op. cit., p. 5.
97 Contrairement à ce que son nom indique, la catégorie « Épicerie » des tableaux de la DIA contient presque exclusivement des dépanneurs et des pharmacies. Elle inclut très peu d’épiceries.
98 BERKENKAMP et PHILLIPS, op. cit., p. 15.
99 Il s’agit du taux de déclaration pour la catégorie des restaurants. L’État de New York n’inclut pas de dépanneurs parmi les générateurs désignés. DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, op. cit., p. 5.
100 Marc ALLARD, Marie-Christine BOUCHARD, Mathieu LAMOTHE et Patricia RAINVILLE, « Couche-Tard jette des milliers de contenants recyclables encore pleins », Le Soleil, 3 avril 2023, www.lesoleil.com/2023/04/03/enquete–couche-tard-jette-des-milliers-de-contenants-recyclables-encore-pleins-261d3a5b820bc39079bb2ac62f8e564b/. Marie-Christine BOUCHARD, Marc ALLARD, Patricia RAINVILLE, Justine MERCIER et Mathieu LAMOTHE, « Le grand gaspillage de Dollarama », Le Soleil, 29 avril 2024, www.lesoleil.com/enquete/2024/04/29/le-grand-gaspillage-de-dollarama-LSVV7RAPJRER3JKMU33VPMVSO4/.
101 Bouffe-Action, qui calcule la part d’aliments récupérés jetés au compost, note que celle-ci est presque nulle dans le cas des pains, pâtisseries et viennoiseries.
102 « Membres », Fédération de l’habitation coopérative du Québec, 2025, fhcq.coop/fr/membres (page consultée le 25 juillet 2025). « L’OMHM en chiffres », Office municipal d’habitation de Montréal, 2025, www.omhm.qc.ca/fr/a-propos-de-nous/lomhm-en-chiffres (page consultée le 25 juillet 2025). « À propos de la FOHM », Fédération des OSBL d’habitation de Montréal, 2025, fohm.org/a-propos-de-la-fohm/ (page consultée le 25 juillet 2025).
103 Les restaurants rapides sont abordés plus loin.
104 BERKENKAMP et PHILLIPS, op. cit., p. 13.
105 Ibid., p. 41.
106 Ibid., p. 18.
107 Sur ces stratégies et leurs impacts dans le domaine de la restauration, voir Jade LÉVESQUE, Contribution à la compréhension des enjeux environnementaux et économiques du gaspillage alimentaire et de la performance de stratégies pour sa réduction en restauration indépendante dans une perspective d’amélioration de l’éco-efficience, thèse de doctorat (sciences des aliments), Québec, Université Laval, 2023.
108 « Installations : Lieux physiques », Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2025, m02.pub.msss.rtss.qc.ca/M02ListeInstall.asp?Install=Region (page consultée le 25 juillet 2025).
109 Dans les faits, les résidences pour personnes âgées incluent à la fois des résidences publiques et des résidences privées, dont la taille et les services alimentaires peuvent être différents. Il n’a pas été possible de dresser la liste complète du nombre de résident·e·s dans les résidences publiques, d’où cette estimation à partir des RPA pour les besoins de cette recherche. « Registre des résidences privées pour aînés », Ministère de la Santé et des Services sociaux, k10.pub.msss.rtss.qc.ca/K10accueil.asp (page consultée le 31 mars 2023).
110 Anne PLOURDE, Un programme universel d’alimentation scolaire pour le Québec : état des lieux, bienfaits et estimation des coûts, IRIS, 2023.
111 BERKENKAMP et PHILLIPS, op. cit., p. 15.
112 PLOURDE, op. cit., p. 38.
113 Éric MÉNARD, Analyse du gaspillage alimentaire à Montréal : études de cas dans les secteurs commercial et industriel, 2019, p. 23.
114 ALIMA, CENTRE DE NUTRITION SOCIALE PÉRINATALE, Coût du Panier à provisions nutritif et économique (PPNE), avril 2025.
115 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Tableau. Répartition de l’ensemble des effectifs étudiants inscrits dans les cégeps, selon l’organisme responsable et les trimestres d’automne et d’hiver pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025. « L’ÉNT en chiffres », École nationale de théâtre du Canada, 2025, ent-nts.ca/fr/apropos/ (page consultée le 28 juillet 2025). MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Tableau 2. Répartition des effectifs étudiants inscrits pour obtenir un DEC ou Tremplin DEC inscrits à temps plein, selon la langue d’enseignement de l’organisme responsable, l’organisme responsable, la langue de l’organisme fréquenté et l’organisme fréquenté, pour l’automne 2023. FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS D’UNIVERSITÉ, Les étudiant·es internationaux·ales dans les universités québécoises : portrait de la situation, 2024. INSTITUT DE TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC, Rapport annuel 2023-2024, 2024. STATISTIQUE CANADA, Effectifs des collèges selon le domaine d’études détaillé, l’établissement, et les caractéristiques du programme et de l’étudiant, inactif, 2023.
116 « Comité environnemental », Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM, aessuqam.org/comite-environnemental/ (page consultée le 28 juillet 2025).
117 « Chapters », Food Recovery Network, www.foodrecoverynetwork.org/chapters (page consultée le 28 juillet 2025).
118 ALIMA, op. cit.
119 « Liste des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies en fonction », Données Québec, 2025, www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/liste-des-centres-de-la-petite-enfance-cpe-et-des-garderies-en-fonction/resource/89af3537-4506-488c-8d0e-6d85b4033a0e?filters=REGION%3A6%2520-%2520Montr%25C3%25A9al.
120 BERKENKAMP et PHILLIPS, op. cit., p. 15.
121 « Rapports statistiques annuels des CH, CHSLD et CLSC (AS-478) », Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2023-2024, www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/rapports-statistiques-annuels/ (page consultée le 29 juillet 2025).
122 Pour quelques établissements, il a été impossible de faire le calcul parce que les données sur les repas servis n’étaient pas disponibles. Le potentiel de récupération alimentaire réel est donc vraisemblablement un peu plus élevé.
123 Sara CHAMPAGNE, « Révolution verte à la cafétéria de l’hôpital », La Presse, 19 juin 2023, www.lapresse.ca/actualites/environnement/2023-06-19/planete-bleue-idees-vertes/revolution-verte-a-la-cafeteria-de-l-hopital.php.
124 LA RÉCOLTE ENGAGÉE, Bilan des récupérations 2017-2024, 2025.
125 À partir des 11 établissements des catégories « Marché public » et « Kiosque » associés au marché Jean-Talon dans les tableaux de la DIA. Le nombre réel de marchands est plus élevé, mais ceux-ci sont classés dans d’autres catégories. Il s’agit donc d’une estimation visant à permettre le calcul pour ces deux catégories, et non d’un reflet de ce que chaque marchand donne individuellement.
126 MOISSON MONTRÉAL, op. cit., p. 18. Il est possible qu’une part de ces aliments provienne de dons d’aliments qui auraient pu être vendus faits par des entreprises, et non de surplus alimentaires à proprement parler. D’après les membres de la direction de Moisson Montréal consultées, cette part est négligeable. Nous ne disposons pas de données permettant de la quantifier.
127 STRATZER, Portrait du gisement de matières organiques disponible dans les industries, commerces et institutions de l’agglomération de Montréal, 2021, p. 23. Calculs de l’IRIS.
128 Les établissements de la catégorie « Brasserie » qui ont un menu complet ont été classés avec les restaurants.
129 Cette catégorie de la DIA contient des cuisines de résidences privées qui sont aussi utilisées pour la préparation d’aliments destinés à la vente, mais qui produisent moins de 100 kg par mois de nourriture à des fins commerciales.
130 « Meals Recovered », ReFED, 2024, docs.refed.org/methodologies/impact_calculator/meals_recovered.html (page consultée le 30 juillet 2025). Ce chiffre permet d’avoir un ordre de grandeur raisonnable et réaliste, mais une analyse détaillée du nombre de repas épargnés devrait prendre en compte une variété de facteurs, dont le type de nourriture donnée, la composition nutritionnelle des aliments et les caractéristiques sociodémographiques des mangeurs et mangeuses.
131 CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS, Plan d’action régional intégré : portrait des enjeux 2023-2025, 2023, p. 35.
132 Eve-Lyne COUTURIER, Le revenu viable en 2025. Le logement encore au cœur de la sortie de pauvreté, IRIS, 2025.
133 CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS, op. cit., p. 38.
134 MOISSON MONTRÉAL, Bilan-Faim 2024, op. cit. Jessica CHEN, « Plus de 2 millions de visites en un mois dans les banques alimentaires du pays », Radio-Canada, 28 octobre 2024, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2115512/insecurite-alimentaire-record-canada-2024.
135 « Impact Calculator », ReFED, 2025, insights-engine.refed.org/impact-calculator (page consultée le 31 juillet 2025).
136 « Greenhouse Gas Equivalencies Calculator », United States Environmental Protection Agency, 2025, www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator (page consultée le 31 juillet 2025).
137 OREGON DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY, Life Cycle Assessment of Edible Food Rescue, 2019.
138 « Des plats réutilisables maintenant offerts dans les commerces et restaurants de Prévost », Ville de Prévost, 2024, www.ville.prevost.qc.ca/actualites/des-plats-reutilisables-maintenant-offerts-dans-les-commerces-et-restaurants-de-prevost (page consultée le 26 août 2025).
139 Les paramètres suivants ont été utilisés : « Retail – Standard Mix » (correspondant à un assortiment de produits typiques pour la vente au détail) pour les épiceries, supermarchés, marchés publics, dépanneurs et magasins d’alimentation, « Retail – Breads & Bakery » (vente au détail de pains et pâtisseries) pour les boulangeries et « Foodservice – Standard mix » (assortiment typique de denrées dans les établissements avec service) pour les autres catégories.
140 Pour plus de détails sur la méthodologie du calcul de l’empreinte matérielle, voir Colin PRATTE, Krystof BEAUCAIRE et Sophie ELIAS-PINSONNEAULT, L’empreinte matérielle de la couverture des besoins de base au Québec, IRIS, 2023. Les données fournies ici sont des estimations globales qui pourraient être raffinées en étudiant précisément la composition des aliments récupérés. Par exemple, l’empreinte matérielle de la viande est beaucoup plus grande que celle du pain.
141 D’après les données du rapport annuel 2024-2025 de Moisson Montréal, la banque alimentaire assume un coût d’approvisionnement et de transport de 18,9 ¢/kg en 2024 et de 18,4 ¢/kg en 2025. MOISSON MONTRÉAL, op. cit., 2025, p. 43. Calculs de l’IRIS.
142 De plus, pour plusieurs organismes, les autres frais couvrent aussi d’autres volets d’action comme des cuisines collectives, des projets d’éducation alimentaire ou des projets d’agriculture urbaine, en plus de la récupération alimentaire.
143 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, Analyse des impacts actuels et futurs des activités de Moisson Montréal, 2015, p. 37.
144 Il va de soi que les coûts assumés par la Ville de Montréal permettent de réduire le fardeau financier des organismes et vice-versa.
145 RECYC-QUÉBEC, op. cit., p. 28
146 Ibid., p. 27.
147 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, Comprendre les causes […], op. cit., p. 26.
148 ALIMA, CENTRE DE NUTRITION SOCIALE PÉRINATALE, Rapport 2023-2024 sur le coût du Panier à provisions nutritif et économique de Montréal, 2024.
149 MOURAD, 2018, op. cit., p. 230-231. Laurence BHÉRER et Agathe LELIÈVRE, « Les frigos collectifs : l’émergence d’une pratique autonome dans le paysage de la redistribution alimentaire à Montréal et à Québec », Lien social et politiques, no 90, 2023, p. 245. CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS, op. cit., p. 23.
150 EY, op. cit., p. 6.
151 « Qui sommes-nous? », Comerso, 2025, www.comerso.fr/qui-sommes-nous (page consultée le 1er août 2025). « Qui sommes-nous? », Phenix, 2025, www.wearephenix.com/phenix/qui-sommes-nous/ (page consultée le 1er août 2025).
152 « À propos », Synergie Québec, synergiequebec.ca/a-propos/ (page consultée le 22 septembre 2025).
153 « Financer son virage vert », PME MTL, pmemtl.com/blogue/financer-son-virage-vert (page consultée le 22 septembre 2025).
154 « Informations pour les donateurs », Banques alimentaires du Québec, 2025, banquesalimentaires.org/informations-pour-les-donateurs/ (page consultée le 1er août 2025).
155 REVENU QUÉBEC, Demande d’accès à des documents N/Réf. 25-1067813, 26 juin 2025.
156 REVENU QUÉBEC, Demande d’accès à des documents N/Réf. 25-1068287, Déduction pour dons (ligne 253), 28 août 2025.
157 « La Stratégie de valorisation de la matière organique : une vision commune pour un meilleur avenir », Recyc-Québec, 2025, www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/matieres-organiques/strategie-valorisation (page consultée le 1er août 2025).
158 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, op. cit., p. 11.
159 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON et STRATZER, Analyse d’impact réglementaire d’une interdiction d’éliminer les résidus alimentaires pour des ICI, 2023, p. 47.
160 Yerina MUGICA et Terra ROSE, Tackling Food Waste in Cities: A Policy and Program Toolkit, 2019, p. 40.
161 Juliana BEECHER, « Mastering Logistics Of Edible Food Recovery And Donation », BioCycle, 10 juin 2025, www.biocycle.net/mastering-logistics-of-edible-food-recovery-and-donation/.
162 Guillaume HÉBERT et Simon TREMBLAY-PEPIN, La sous-
traitance dans le secteur public : coûts et conséquences, IRIS, 2013.
163 Pour les critères des trois niveaux de labellisation, voir « Label national anti-gaspillage alimentaire », Ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation et ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, 2025, www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/label-national-anti-gaspillage-alimentaire (page consultée le 1er août 2025).
164 MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE, Expérimentation réglementaire en lien avec la réduction du gaspillage alimentaire. Synthèse des résultats des ateliers de rétroaction, 2025, p. 4.
165 MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE, Rapport de la phase de prototypage, op. cit., p. 16.
166 Camille FLEURENT, Impact d’un règlement sur le gaspillage alimentaire au sein des organismes d’aide alimentaire dans la Ville de Montréal, rapport de stage (santé publique environnementale), Montréal, Université de Montréal, 2023, p. 17.
167 Ibid.
168 MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE, Expérimentation réglementaire […], op. cit.
169 Ibid., p. 26.
170 Ibid., p. 15.
171 AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, Quelles solutions […], op. cit., p. 16.
172 Ibid., p. 22.
173 BOUFFE-ACTION DE ROSEMONT, Fleurir avec la communauté. Rapport annuel 2023-2024, 2024, p. 21.
174 « La communauté nourricière du Sud-Ouest en action : découvrez l’ÉpiCamion », Ville de Montréal, 2025, montreal.ca/articles/la-communaute-nourriciere-du-sud-ouest-en-action-decouvrez-lepicamion-78271 (page consultée le 6 août 2025).
175 Ce délai était d’un an en France.
176 VILLE DE MONTRÉAL, Montréal, zéro déchet 2020-2025. Stratégie du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal, 2020, p. 30.
177 Ibid., p. 16.
178 MOISSON MONTRÉAL, 2025, op. cit., p. 42.
179 CALRECYCLE, SB 1383 Model Food Recovery Agreement, op. cit. « Don alimentaire : un modèle de convention entre distributeurs et associations », Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 2025, agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations (page consultée le 6 août 2025).
180 « Guide for Hiring a City Food Waste Coordinator », Natural Resources Defense Council, 2020, www.nrdc.org/resources/guide-hiring-city-food-waste-coordinator (page consultée le 6 août 2025).
181 MAISON DE L’INNOVATION SOCIALE, Expérimentation réglementaire […], op. cit., p. 10.
182 À cet égard, bien que la Ville de Montréal ait aussi des ressources limitées, elle dispose de plus de marge de manœuvre que les organismes communautaires en tant qu’administration ayant un pouvoir de taxation et ayant la possibilité de faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour élargir ses compétences et sa capacité d’agir.
183 Dans cette perspective, le Programme Éco-quartier pourrait servir d’inspiration. Il s’agit d’un exemple de programme porté par des organismes communautaires avec le soutien de la Ville et des arrondissements. « Historique du programme Éco-quartier », Regroupement des éco-quartiers, www.eco-quartiers.org/historique-du-programme-eco-quartier (page consultée le 23 septembre 2025).
184 COMMISSION PERMANENTE SUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS, op. cit., p. 27.
185 Plusieurs organismes ont constaté une diminution des dons dans les dernières années, ce qui implique qu’ils disposent d’une certaine marge de manœuvre pour gérer une augmentation des quantités reçues. Ils n’ont toutefois pas nécessairement les ressources pour gérer une augmentation du nombre de donateurs. C’est dans cette perspective que les ressources pour transporter et récupérer les aliments apparaissent comme une priorité.
186 « Les Tables de quartier », Coalition montréalaise des Tables de quartier, 2025, www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-quartier/ (page consultée le 7 août 2025).
187 COLLECTIF RÉCOLTE, Fiche d’apprentissage : spécialiste en approvisionnement local communautaire, 2023.
188 Dans son rapport, Camille Fleurent note que la majorité des organismes interrogés « affirment qu’ils ont les installations nécessaires pour accueillir plus de dons de tous types dès demain ». Certains organismes mentionnent aussi qu’ils ont un surplus de bénévoles. Ces données laissent croire qu’il existe un potentiel de partage et de mutualisation des ressources entre organismes. Camille FLEURENT, Impact d’un règlement sur le gaspillage alimentaire au sein des organismes d’aide alimentaire dans la Ville de Montréal, rapport de stage (santé publique environnementale), Montréal, Université de Montréal, 2023, p. 17.
189 Par exemple, certains aliments récupérés pourraient être utilisés pour préparer des repas pour les enfants en garderie ou pour les élèves des écoles. La récupération alimentaire pourrait ainsi être un ingrédient de la mise en place éventuelle d’un programme d’alimentation scolaire universel. Pour plus de détails sur les bénéfices d’un tel programme, voir Anne PLOURDE, Un programme universel d’alimentation scolaire pour le Québec : état des lieux, bienfaits et estimation des coûts, IRIS, 2023.
190 Ibid. p. 4-5.
191 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC et VIVRE EN VILLE, Guide pour l’élaboration d’un plan de développement d’une communauté nourricière, 2022.
192 MOISSON MONTRÉAL, Rapport annuel 2023-2024 : 40e anniversaire et encore tant à faire, 2024, p. 27.
193 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC, Portrait des initiatives favorisant la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, 2022, p. 3.
194 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, New York State Food Donation and Food Scraps Recycling Law: Report to the Governor and Legislature, 2022, p. 3.
195 MOISSON MONTRÉAL, 2025, op. cit., p. 20.

Photo: Thomas Bresson (Wikipédia)
Faits saillants
- En France, en Californie et dans l’État de New York, l’obligation de don a mené à une augmentation substantielle de la quantité d’aliments comestibles récupérés. Elle a aussi permis la diversification des denrées récoltées.
- Dans ces États, l’enjeu récurrent de la qualité des dons met en lumière la nécessité de mettre en place des mesures de gestion de la qualité et de prévoir du financement et de l’accompagnement pour soutenir les organismes d’aide alimentaire.
- À Montréal, il serait possible de récupérer de 649 à 1 636 tonnes d’aliments par année auprès des grands établissements, ce qui représente entre 1,2 million et 3 millions de repas.
- Auprès de l’ensemble des établissements alimentaires, il serait possible de récupérer de 3 928 tonnes à 9 489 tonnes d’aliments, ce qui représente entre 7 millions et 17,5 millions de repas.
- La récupération de ces aliments permettrait d’éviter l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre annuelles de 581 à 1 439 voitures (pour les grands établissements) et de 3 314 à 7 987 voitures (pour tous les établissements).
- La création d’un service municipal de coordination de la lutte contre le gaspillage alimentaire permettrait de soutenir les donateurs et les organismes d’aide alimentaire. En finançant la mise en place d’infrastructures de collecte et l’embauche de personnel de coordination à l’échelle des quartiers et des arrondissements, ce service répondrait à des besoins exprimés par les acteurs montréalais de la récupération alimentaire.
