Diminution des coûts de santé : le rôle des organismes communautaires
18 septembre 2025
Lecture
40min
Cette note met en évidence qu’une hausse du financement des organismes communautaires au Québec est susceptible d’engendrer d’importantes économies dans le réseau public de la santé et des services sociaux (RSSS). En combinant les données des rapports financiers annuels des établissements de santé aux données sur le financement des organismes communautaires au Québec, nos estimations montrent que les organismes communautaires qui œuvrent au soutien social et économique de la population permettent de générer d’importantes économies dans le réseau de la santé grâce à l’incidence positive de leur travail sur les déterminants sociaux de la santé.
Table des matières
1. Introduction
1.1 Mise en contexte
La loi québécoise sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé stipule qu’« aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d’une année financière1 ». Cela explique pourquoi le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec talonne actuellement les établissements de santé pour qu’ils atteignent l’équilibre budgétaire pour l’année financière 2024-20252. Devant une hausse des coûts expliquée notamment par la prévalence croissante des maladies chroniques, le recours aux agences privées de placement et les imposants salaires gagnés par certain·e·s professionnel·le·s de la santé, réduire les dépenses du réseau de la santé au Québec semble relever de l’impossible3. Selon cette logique, les établissements de santé québécois seraient donc condamnés à diminuer la gamme de services offerts à la population afin de respecter leurs obligations financières.
Cependant, une telle logique fait abstraction du fait que les mesures préventives et les politiques de santé publique peuvent réduire la prévalence de certaines maladies, ce qui a le potentiel de diminuer ensuite la demande en services de santé. Une telle baisse de la demande se traduit généralement par une diminution conséquente des coûts supportés par le réseau de la santé, que ce soit par la diminution du temps de travail des employé·e·s du réseau ou en raison d’un plus faible recours aux technologies, aux médicaments ou aux procédures médicales coûteuses. De plus, l’adoption de politiques axées sur la prévention des maladies est recommandée depuis près de 40 ans par divers rapports et commissions qui placent tous « la prévention au cœur de tout redressement d’un système à bout de souffle et qui ne peut plus répondre adéquatement à la pression de la demande de services4 ».
La nature des mesures préventives qui réduisent la demande en services de santé est multiple. Qu’il s’agisse de campagnes de vaccination de masse, de taxes sur le tabac et l’alcool ou encore d’aménagement d’infrastructures urbaines favorisant la mobilité active, de telles mesures ont le potentiel de réduire la prévalence de plusieurs maladies chroniques et infectieuses au sein de la population. Cependant, la littérature scientifique tend à démontrer de plus en plus que les facteurs socioéconomiques, tels que le revenu, la richesse accumulée, le niveau d’éducation et le soutien social, sont parmi les éléments les plus déterminants dans l’évolution de l’état de santé des individus5. Autrement dit, implanter des politiques publiques qui ont pour effet d’améliorer les revenus, le niveau d’éducation et le soutien social des individus permettrait, à terme, de réduire les coûts de santé en intervenant directement sur les déterminants sociaux de la santé (DSS). Les DSS correspondent, en gros, aux facteurs socioéconomiques qui orientent de manière générale l’état de santé des individus tout au long de leur vie.
Au Québec, il existe plusieurs milliers d’organismes communautaires qui ont pour mission première d’aider quiconque vivant une situation problématique particulière. Que ce soit en matière d’aide au logement, de soutien à l’emploi ou encore d’accompagnement lors de problèmes de consommation de substances illicites, ces organismes sans but lucratif offrent une multitude de services qui agissent directement sur les DSS6. De plus, certains organismes offrent des services de santé en dehors des établissements du réseau de la santé, notamment à l’aide d’unités mobiles ou en offrant du soutien à domicile. Ces services ont aussi le potentiel de réduire les coûts dans le réseau public de la santé lorsqu’ils permettent de limiter l’occurrence et la gravité de certains problèmes de santé.
Mais qu’en est-il réellement ? Les montants octroyés aux organismes communautaires permettent-ils vraiment de réduire les coûts dans le réseau de la santé au Québec ? Si oui, quelle est l’ampleur des économies générées ? Et sur combien de temps ? Ces économies sont-elles similaires dans toutes les régions du Québec ? Et certains types d’organismes communautaires sont-ils susceptibles d’engendrer plus d’économies que d’autres ? Cette note socioéconomique vise à répondre à toutes ces questions en se basant sur les meilleures pratiques utilisées dans la littérature en économie de la santé et en recherche sur les services de santé. Cette littérature est décrite sommairement dans la prochaine section.
1.2 Revue de la littérature
Très peu d’études scientifiques se sont intéressées aux liens existants entre le financement des organismes communautaires et les dépenses en soins de santé. Il existe deux exceptions récentes à ce phénomène, soit 2 études publiées en 2020 et en 2022 dans la revue Population Health Management7. La première étude utilise des données provenant de 1 660 comtés aux États-Unis afin de montrer qu’une hausse de 10 $ par habitant·e dans les services sociaux est associée à une baisse significative de deux hospitalisations évitables8 (par 100 000 habitant·e·s) sur 4 ans9.
La deuxième étude, aussi réalisée avec des données étasuniennes, conclut que des niveaux moins élevés de dépenses dans les programmes publics visant l’amélioration des DSS sont associés à une augmentation des dépenses personnelles de santé chez les individus âgés de 55 à 64 ans ayant une assurance privée fournie par l’employeur. Cependant, aucune de ces deux études ne réalise d’analyse coût-bénéfice complète et rigoureuse. De plus, aucune de ces deux études n’est capable d’isoler un effet de causalité clair entre les niveaux de dépenses publiques dans des programmes ciblant les DSS et la consommation de ressources médicales de manière générale.
L’incapacité à correctement isoler un effet causal entre (au moins) deux variables est généralement engendrée par l’absence de variations exogènes entre ces mêmes variables. Dans les grandes lignes, on peut définir une variation exogène comme une variation qui n’est pas influencée, directement ou indirectement, par l’élément que nous désirons étudier (soit les dépenses de santé dans le cas qui nous intéresse). Autrement dit, une variation exogène est exempte de causalité inverse : la relation de causalité (potentiellement) présente entre les variables est à sens unique. Plusieurs méthodes ont été développées dans les dernières décennies pour surmonter un tel problème, la méthode des variables instrumentales étant la plus populaire parmi les économistes (voir la section 2.2 pour plus de détails à ce sujet).
De manière connexe à notre sujet d’étude, certaines recherches récentes en économie de la santé ont évalué l’effet des dépenses en santé publique sur les dépenses en santé grâce à des stratégies basées sur une ou plusieurs variables instrumentales. Par exemple, Stephen Martin et ses collaborateurs emploient un modèle de régression linéaire avec variables instrumentales et trouvent que de hausser les dépenses britanniques en santé publique d’un montant d’un milliard de livres sterling générerait environ trois fois plus de gains de santé que le même montant dépensé en soins curatifs traditionnels (206 398 contre 67 060 années de vie ajustées pour la qualité, respectivement)10. Brown et Murthy utilisent aussi une méthode basée sur des variables instrumentales afin de statuer que chaque dollar investi en santé publique dans les administrations de comté aux États-Unis réduit, en moyenne, les dépenses publiques de santé (principalement les dépenses de programmes comme Medicaid) de 3,12 $ au cours de l’année subséquente11.
Finalement, Mays et Mamaril utilisent une méthode basée sur des variables instrumentales et des données étasuniennes pour affirmer qu’une hausse de 10 % dans les dépenses locales de santé publique réduit, en moyenne, de 0,8 % et de 1,1 % les dépenses liées au programme Medicare après 1 an et 5 ans, respectivement12. Les auteurs estiment ensuite un ratio bénéfices-coûts d’environ 1,10 sur 5 ans, soit que chaque dollar investi en santé publique aux États-Unis générerait en moyenne 1,10 $ de coûts évités dans le programme Medicare lors des cinq années suivant l’investissement en santé publique. Les auteurs notent aussi que les coûts évités sont plus importants dans les communautés dont les taux de pauvreté sont plus élevés et qui disposent de faibles taux de couverture d’assurance privée, ainsi que dans les communautés aux prises avec des pénuries de personnel au sein du réseau de la santé.
2. Données et méthodes
2.1 Sources et caractéristiques des données
Tout d’abord, la variable dépendante (c’est-à-dire celle que l’on veut expliquer) utilisée dans cette note est le niveau des dépenses de santé par habitant·e. Elle correspond à la somme des coûts directs nets ajustés de tous les établissements publics de santé au Québec, coûts auxquels ont été ajoutées les subventions octroyées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) aux établissements privés conventionnés ayant des ententes avec le gouvernement québécois. Ces établissements privés correspondent majoritairement aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les montants recueillis ont été extraits des rapports financiers annuels des établissements de santé (rapports AS-471) des années 2008-2009 à 2022-2023, et ce, pour chaque région administrative du Québec13. Notons que les coûts directs nets ajustés comptabilisent exclusivement les coûts liés à la prestation de services de santé (c’est-à-dire ceux qui excluent les investissements et l’amortissement des immobilisations) et sont ajustés de façon à retirer certains coûts exceptionnels liés à la pandémie de COVID-19. Le graphique 1 montre l’évolution temporelle de tels coûts pour l’ensemble du Québec. On remarque rapidement la présence d’un changement de tendance important dès l’année 2020-2021, changement qui coïncide avec le début de la pandémie de COVID-19 malgré les ajustements apportés par les établissements de santé.
Ensuite, les montants versés aux organismes communautaires constituent nos variables explicatives d’intérêt et proviennent du document Répartition régionale du soutien financier gouvernemental en action communautaire14. Ce document est publié sur une base annuelle depuis 2001 dans le but d’accroître la transparence du gouvernement quant au financement des organismes communautaires au Québec. Il est le fruit de l’adoption de la politique gouvernementale sur l’action communautaire et est produit par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Les montants décrits dans cette publication sont ceux versés à l’ensemble des organismes communautaires en fonction de leurs missions respectives par les différents ministères du Québec. Les données qui en sont extraites couvrent les années financières 2001-2002 à 2022-2023 et sont séparées par région administrative. Elles sont toutefois représentées pour l’ensemble du Québec dans le graphique 2. On constate une légère stagnation entre les années 2009-2010 et 2014-2015, stagnation qui a pris fin après que plusieurs organismes communautaires ont entamé un mouvement de grève en réponse à leur sous-financement chronique15.
Les autres données utilisées dans cette note proviennent de trois sources différentes : la Banque de données statistiques officielles du Québec (BDSO), l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et Statistique Canada. La plupart des variables de contrôle employées pour l’analyse proviennent de la BDSO : taux d’emploi, taux de mortalité, salaire horaire médian, revenu disponible, pourcentage de femmes, pourcentage d’individus âgés de 65 ans et plus et pourcentage d’individus âgés de 80 ans et plus. Ces variables permettent de prendre en compte les éléments qui pourraient influencer à la fois les montants versés aux organismes communautaires et les dépenses en soins de santé16. Il en est de même pour la densité de médecins spécialistes et la densité de médecins généralistes par 100 000 habitant·e·s pour chaque région administrative, variables fournies par l’ICIS et qui permettent de tenir compte de l’offre globale de soins de santé par région. Finalement, toutes les sommes d’argent analysées dans cette note ont été divisées par la population régionale et ajustées pour l’inflation à l’aide de l’indice implicite des prix fourni par Statistique Canada pour le Québec17.
2.2 Analyse économétrique
L’analyse économétrique effectuée dans cette note est une analyse de données de panel en seconde différence (ou double première différence) avec effets fixes temporels18. Une telle approche est plus robuste aux changements de tendance et aux racines unitaires que les approches en niveau ou en première différence. De plus amples détails sur la méthode employée sont fournis en annexe. Les résultats pour tous les modèles en première différence sont disponibles sur demande auprès de l’auteur. De façon simplifiée, cette méthode permet d’expliquer les variations observées dans les dépenses en santé par année-région à l’aide de variables d’intérêt et de variables de contrôle. Ici, les variables d’intérêt sont les montants versés aux organismes communautaires par région lors de l’année courante (on parle alors d’effet contemporain) et lors des cinq années précédentes afin d’isoler un effet cumulatif sur six années consécutives.
Considérant les différences importantes qui existent entre le Nord-du-Québec et les autres régions administratives québécoises, notamment au niveau de l’organisation du système de santé et de la nature du travail des organismes communautaires, cette région n’a été incluse dans aucune des analyses économétriques. Il importe aussi de noter que la méthode des moindres carrés pondérés a été employée pour toutes les estimations afin de tenir compte des différences de taille populationnelle entre les régions du Québec19. De plus amples détails sur la méthode employée sont fournis en annexe. Des résultats de simulation de Monte Carlo sont aussi disponibles en annexe afin de démontrer la pertinence de la méthode employée.
Les variables de contrôle utilisées dans cette note ont été énumérées à la section 2.1. Elles comprennent leurs valeurs contemporaines et leurs valeurs retardées d’un an, à l’exception de la proportion de femmes, du pourcentage d’individus âgés de 65 ans et plus et du pourcentage d’individus âgés de 80 ans et plus, où seules les valeurs contemporaines sont incluses. Les valeurs retardées d’un an permettent de prendre en compte les effets de la mortalité, du taux d’emploi, du revenu disponible, du salaire horaire et de la densité des médecins (généralistes et spécialistes) sur les dépenses de santé par région lors de l’année suivante, ce qui est utile afin d’expliquer une partie significative des variations observées dans les dépenses de santé. Par exemple, le taux de mortalité permet de tenir compte du niveau général de morbidité dans la population, ce qui est fortement corrélé avec plusieurs conditions chroniques qui peuvent prendre un certain temps avant de pousser à la hausse la consommation de ressources médicales dans une région donnée.
Afin de bien isoler l’effet causal du financement communautaire régional sur les dépenses de santé, il est nécessaire que les sommes versées aux organismes communautaires ne soient pas guidées par le niveau courant ou prévu des dépenses de santé au sein de chaque région. Si tel est le cas, un problème de causalité inverse apparaît et il devient généralement impossible de quantifier précisément l’effet désiré sans avoir recours à d’autres méthodes plus sophistiquées.
Supposons que nous désirons connaître l’effet d’une variable X (p. ex., les montants versés aux organismes communautaires) sur une variable Y (p. ex., les dépenses des établissements de santé au Québec) en éliminant toute possibilité qu’une quelconque causalité inverse puisse « contaminer » l’effet souhaité. Dans ce contexte, un (bon) instrument est une variable Z qui est (fortement) corrélée avec la variable X, mais qui ne doit être aucunement corrélée avec la variable Y. Si une telle variable Z existe, il devient alors possible d’isoler une relation de cause à effet dans le sens désiré sans se soucier que les enjeux de causalité inverse puissent invalider les résultats obtenus.
De manière générale, il est assez difficile de trouver un bon instrument ou de bons instruments20. Considérant qu’il est aussi très difficile d’évaluer la qualité d’un instrument quelconque, nous n’emploierons pas de variables instrumentales afin de répondre aux différentes questions de recherche posées à la fin de la section 1.1. Nous utiliserons plutôt une hypothèse d’exogénéité relativement plausible afin d’obtenir une estimation prudente de l’effet du financement des organismes communautaires sur les dépenses en santé au Québec, et ce, pour un horizon temporel de six ans21. Cette hypothèse d’exogénéité est la suivante : les montants versés aux organismes communautaires qui œuvrent en dehors de la mission « Santé et Services sociaux » (SSS) du MSSS ne sont pas influencés par le niveau courant ou prévu des dépenses de santé au Québec. Si une telle hypothèse est fondée, alors les relations entre le financement de ces organismes communautaires et les dépenses de santé au Québec représentent les liens de cause à effet du premier vers les deuxièmes.
Par conséquent, l’analyse a été effectuée à l’aide de trois catégories de financement communautaire. La première catégorie n’emploie que les montants versés aux organismes communautaires en SSS. Ces montants correspondent, en moyenne, à 55 % du montant annuel total versé aux organismes communautaires par les ministères québécois et sont relativement stables depuis 20 ans, ce qui est présenté au graphique 3. La deuxième catégorie concerne le financement ministériel à tous les organismes communautaires qui œuvrent en dehors de la mission SSS du MSSS. Finalement, la troisième catégorie comprend tout le financement ministériel versé aux organismes communautaires, soit la somme des deux premières catégories.
Cette division a été réalisée en raison du fort potentiel de causalité inverse entre les montants versés aux organismes communautaires en SSS et les dépenses totales de santé. En effet, il est réaliste et probable qu’une hausse de la demande de soins puisse faire augmenter les dépenses de santé, ce qui se répercute sur les organismes communautaires en SSS, considérant l’incapacité du réseau de la santé à absorber une hausse de la demande. Une telle logique est d’autant plus réaliste dans un contexte où le financement par entente de services facilite le transfert de tâches du réseau public aux organismes communautaires financés par le MSSS (voir la section 4).
Un tel transfert de demande crée donc une association positive entre les dépenses en santé et les montants versés à ces mêmes organismes communautaires, même si l’augmentation du financement communautaire permet de générer des économies au sein des établissements publics de santé. On parle alors d’un biais d’endogénéité positive, car le lien causal qui nous intéresse est surestimé en raison du caractère endogène (c’est-à-dire qui n’est pas exogène) de la relation entre les deux variables analysées. Dans le milieu communautaire, on parle plutôt d’effet déversoir considérant que le réseau public de la santé semble déverser certaines de ses tâches aux groupes communautaires À l’inverse, un biais d’endogénéité négative apparaît si une hausse des dépenses de santé entraîne une réduction du financement des organismes communautaires en SSS (ou ailleurs) en raison de contraintes budgétaires privilégiant les dépenses au sein des établissements de santé. Une telle situation n’est pas improbable et peut facilement sous-estimer la relation causale entre les variables.
Si les montants versés aux organismes communautaires en SSS sont fort probablement endogènes par rapport aux dépenses totales de santé, cette note fait l’hypothèse que ce n’est pas le cas (ou, du moins, que ce l’est très peu) pour les montants versés aux organismes communautaires œuvrant dans d’autres missions ministérielles. Autrement dit, il est supposé que les montants versés aux organismes communautaires œuvrant dans les missions autres que la santé et les services sociaux ne sont pas fortement influencés par les dépenses totales de santé au Québec, en particulier celles prévues dans les trois à cinq années suivantes. Cette hypothèse est considérée comme suffisamment réaliste pour deux raisons. La première est qu’une hausse de la demande de soins de santé est peu susceptible d’augmenter la demande pour les services fournis par ces mêmes organismes. En effet, entre 40 et 65 % du financement communautaire hors SSS est versé par le MESS à des organismes communautaires aidant des personnes à faible revenu ou sans emploi, peu importe leur état de santé (voir le graphique 422).
La deuxième raison évoquée est qu’il est peu probable que les dépenses totales de santé aient pu contraindre d’une quelconque façon les montants aux organismes communautaires hors SSS, notamment en raison de la croissance relativement stable des sommes versées à ces organismes communautaires au fil du temps. Cette évolution est présentée au graphique 5. Toutefois, il est vrai que le financement octroyé à ces organismes communautaires a stagné entre les années 2009-2010 et 2014-2015, pour ensuite diminuer de manière importante lors des deux années subséquentes. Si un tel épisode de stagnation-
diminution est le fruit de restrictions budgétaires forçant le transfert aux établissements de santé de certains montants initialement consacrés aux organismes communautaires, cela aura pour effet de créer un biais d’endogénéité négative dans nos estimations. Advenant le cas, les économies générées par une hausse du financement des organismes communautaires hors SSS seraient dès lors surestimées.
Malheureusement, il n’est pas possible de confirmer ou d’infirmer empiriquement l’hypothèse d’exogénéité du financement des organismes communautaires hors SSS, à moins de trouver une ou des variables instrumentales non corrélées avec les dépenses totales de santé et pouvant aussi prédire le financement octroyé à ces organismes pour chaque année-région. Il est cependant réaliste de penser que les deux biais potentiels, soit le biais d’endogénéité positive et le biais d’endogénéité négative, puissent mutuellement s’annuler dans le présent contexte. Dans un tel cas, les résultats obtenus représenteraient des estimations crédibles de l’effet causal du financement communautaire hors SSS sur les dépenses en soins de santé. Nonobstant cela, il reste peu probable que les effets à long terme (c’est-à-dire avec plus de deux ans de délai) du financement communautaire sur les dépenses de santé soient affectés par un quelconque biais d’endogénéité, car cela impliquerait que les montants versés aux organismes communautaires sont influencés par les prévisions budgétaires du MSSS sur un horizon temporel de plus de deux ans. Le biais d’endogénéité (positive ou négative) diminuerait donc vraisemblablement de façon progressive avec la distance temporelle entre le financement communautaire et les dépenses de santé au Québec. C’est ce sur quoi nous nous basons pour interpréter les résultats présentés à la section suivante23.
Finalement, il importe de mentionner que la période couverte par l’étude compte deux événements socioéconomiques majeurs : la crise économique de 2008-2009 et la pandémie de COVID-19. Comme la méthode d’estimation que nous employons est relativement robuste aux bris structurels, nous pouvons incorporer les années pandémiques plus récentes dans l’estimation et ne pas craindre que cela biaise trop sévèrement les résultats. Par souci de transparence, nous varions les années couvertes par l’étude afin de procéder à des analyses de sensibilité. Ces analyses nous permettent de savoir si les résultats obtenus avec l’ensemble des années disponibles sont robustes au retrait de certaines années en particulier, notamment les années plus récentes, années où la pandémie de COVID-19 a certainement modifié la nature du travail des organismes communautaires au Québec.
3. Résultats
3.1 Résultats agrégés
Nous présenterons d’abord les résultats agrégés, soit les résultats pour l’ensemble des régions administratives du Québec (à l’exception du Nord-du-Québec) et pour toutes les années disponibles. Comme toutes les variables utilisées dans chacun des modèles sont exprimées en logarithme, les coefficients estimés représentent des élasticités, soit l’effet multiplicateur en pourcentage d’une hausse de 1 % de la variable sélectionnée sur les dépenses totales de santé au Québec. L’effet total sur 6 ans d’une hausse de 1 % du financement communautaire au Québec est calculé en additionnant l’effet contemporain aux 5 effets retardés et est présenté pour chaque catégorie de financement communautaire dans le bas du tableau 124.
Les résultats présentés au tableau 1 indiquent clairement que l’effet du financement communautaire sur les dépenses de santé au Québec varie selon la catégorie d’organismes communautaires et au fil du temps. La première colonne montre que d’augmenter de 1 % les montants versés aux organismes communautaires en SSS serait susceptible de diminuer les dépenses de santé de 0,132 % et de 0,089 % durant la deuxième et la troisième années suivant la hausse du financement communautaire respectivement (en comptant le financement contemporain comme la première année25). Il s’agit des deux seuls effets significatifs à un niveau de confiance de 95 % dans cette première série de résultats, ce qui contraste avec ceux présentés à la deuxième colonne. En effet, les résultats présentés à la deuxième colonne montrent que d’augmenter de 1 % les montants versés aux organismes hors SSS est susceptible de diminuer les dépenses de santé d’un niveau variant entre 0,070 et 0,135 % lors de toutes les années suivant la hausse du financement communautaire, à l’exception des première et troisième années où les diminutions ne sont pas statistiquement significatives. Notons aussi que l’effet du financement contemporain sur les dépenses de santé n’est jamais statistiquement significatif, même lorsque la somme du financement communautaire est considérée (troisième colonne).
Ces résultats sont interprétés de la façon suivante : les organismes communautaires dédiés à la mission santé et services sociaux ont tendance à améliorer la qualité de vie et l’état de santé des individus à court terme, ce qui réduit les dépenses de santé lors des trois premières années suivant une hausse de leur financement. Inversement, les organismes communautaires oeuvrant dans les missions autres que la santé et les services sociaux ont tendance à agir davantage sur les déterminants sociaux de la santé (p. ex., l’accès au logement, l’aide au revenu, etc.), ce qui se traduit par une amélioration de l’état de santé à plus long terme, notamment au-delà de trois ans26. Confirmer de telles interprétations en analysant plus en détail la nature du travail des différentes catégories d’organismes communautaires dépasse cependant la portée de cette note socioéconomique.
De plus, l’absence de significativité de l’effet du financement communautaire contemporain sur les dépenses de santé témoigne de la présence d’un biais d’endogénéité positive entre les deux variables. Autrement dit, ces résultats laissent croire qu’il existe bel et bien un effet déversoir entre le RSSS et les organismes communautaires considérant les faibles valeurs des coefficients présentés à la première rangée, notamment celui de la première colonne. De tels résultats semblent dès lors confirmer l’hypothèse évoquée dans la section 2.2, soit que l’effet du financement communautaire contemporain sur les dépenses de santé au Québec est sous-estimé par la méthode employée. Il est toutefois peu probable qu’une telle sous-estimation contamine aussi les coefficients associés aux années suivantes, considérant les valeurs relativement élevées pour la plupart des coefficients estimés (rangées 2 à 6).
La troisième colonne du tableau 1 montre l’effet du financement communautaire total sur les dépenses de santé au Québec. Comme l’effet du financement communautaire change au fil des années selon le type d’organismes, combiner le financement des deux catégories d’organismes génère des effets qui ne sont pas significatifs statistiquement, sauf lors de la deuxième année. Ces résultats démontrent l’importance d’analyser l’effet du financement communautaire séparément selon la nature du travail des organismes considérés. Autrement dit, analyser l’effet du financement communautaire total ne permet pas de bien représenter les dynamiques propres à chaque catégorie d’organismes communautaires, comme en témoignent les deux premières colonnes du tableau 1. Il importe aussi de noter que les coefficients présentés dans la troisième colonne n’ont pas à se retrouver forcément à mi-chemin des coefficients présentés dans les deux premières colonnes.
Finalement, la septième rangée du tableau 1 présente l’effet cumulé du financement communautaire sur les dépenses de santé au Québec, soit la somme des coefficients de chaque colonne. Bien que l’effet cumulé sur six ans ne soit pas statistiquement significatif pour les organismes en SSS, cela peut être causé par le biais d’endogénéité positive mentionné précédemment. Néanmoins, les deuxième et troisième colonnes du tableau 1 montrent qu’une hausse du financement des organismes hors SSS et du financement communautaire total possède un effet cumulatif important et significatif sur les dépenses de santé au Québec lors des six années suivantes.
En utilisant les montants totaux versés aux organismes communautaires et les dépenses totales de santé au Québec pour l’année 2022-2023, il est possible de transformer les élasticités cumulatives présentées au tableau 1 en ratios bénéfices-coûts27. Ces ratios indiquent l’économie monétaire, en moyenne sur six ans, générée au sein du système de santé pour chaque dollar investi dans chacune des catégories d’organismes. Les détails de ces calculs sont présentés en annexe. Notons qu’un ratio bénéfices-coûts de 1 implique que le financement du communautaire se rembourse à même les économies générées au sein du réseau de la santé, mais sans créer d’économies supplémentaires. De façon similaire, un ratio bénéfices-coûts entre 0 et 1 implique des économies qui ne suffisent pas à compenser les montants versés aux organismes communautaires, alors qu’un ratio négatif implique que chaque dollar investi dans les organismes communautaires entraîne des dépenses supplémentaires dans le réseau de la santé.
Le tableau 2 montre les résultats d’une telle analyse des bénéfices-coûts effectuée avec les résultats présentés au tableau 1, mais aussi les ratios bénéfices-coûts obtenus lorsque nous modifions les années incorporées au modèle qui génère les élasticités entre le financement communautaire et les dépenses de santé au Québec. La première rangée du tableau 2 montre que, lorsque nous utilisons les résultats du tableau 1, chaque dollar investi dans les organismes communautaires hors SSS permet d’économiser entre 7,08 et 34,68 $ sur 6 ans au sein du réseau de la santé. À l’inverse, la première colonne du tableau 2 montre que chaque dollar investi dans les organismes communautaires en SSS ne permet pas de générer des économies statistiquement significatives au sein du réseau de la santé, ce qui est cohérent avec les résultats présentés au tableau 128.
Les rangées suivantes du tableau 2 présentent les résultats de l’analyse de sensibilité lorsque nous modifions les années incorporées au modèle. De manière générale, on remarque que le retrait des années pandémiques (rangées 2 à 4) a tendance à faire augmenter les ratios bénéfices-coûts pour les organismes en SSS alors que c’est plutôt l’inverse qui se produit pour les organismes hors SSS. Autrement dit, la pandémie de COVID-19 semble avoir accru l’impact du travail des organismes communautaires hors SSS sur la santé des individus contrairement aux organismes dédiés à la mission santé et services sociaux. Nous expliquons de tels résultats par le fait que divers enjeux socioéconomiques ayant des répercussions négatives sur l’état de santé des individus aient pris une ampleur considérable depuis l’année 2021, notamment en lien avec la hausse de l’inflation. Or, les organismes communautaires hors SSS sont les mieux outillés afin de traiter ces problèmes en amont, soit avant que l’état de santé des individus affectés par de tels enjeux se détériore significativement.
Le tableau 2 montre aussi que le retrait des années fiscales se trouvant au début de la période étudiée (rangées 5 à 7) n’a que très peu d’incidence sur les ratios bénéfices-coûts, et ce, pour chacune des colonnes du tableau 2. Cette stabilité des ratios bénéfices-coûts est rassurante puisqu’elle permet d’affirmer de manière crédible que les ratios bénéfices-coûts présentés dans les dernières rangées du tableau 2 sont susceptibles de représenter fidèlement la réalité québécoise encore aujourd’hui. C’est pour cette raison que nous pouvons affirmer que d’augmenter de 1,00 $ le financement des organismes communautaires au Québec permet de réduire les dépenses de santé d’environ 12,00 $ sur 6 ans considérant la valeur des ratios bénéfices-coûts présentés dans la première et les dernières rangées de la troisième colonne du tableau 2.
3.2 Résultats par groupe de régions
Les intervalles de confiance présentés au tableau 2 montrent que les économies générées au sein du système de santé pour chaque dollar versé aux organismes communautaires peuvent varier de plus ou moins 15 $ selon les années sélectionnées. Une telle incertitude peut être expliquée par la présence d’une importante hétérogénéité entre les différentes régions du Québec, c’est-à-dire une variation de l’effet du financement communautaire sur les dépenses de santé d’une région à l’autre. Afin d’explorer une telle avenue, nous répétons l’analyse économétrique décrite à la section 2.2, mais pour six groupes de régions administratives. Ces groupes sont décrits dans le tableau 3.
Ces groupes ont été formés suivant les caractéristiques géographiques et démographiques des régions. Ils ont aussi la particularité de générer des estimations plus précises que tous les autres regroupements essayés jusqu’à maintenant. Comme il existe plusieurs milliers de regroupements possibles, il est difficile, voire impossible de comparer les résultats obtenus pour chaque regroupement possible. Il existe cependant plusieurs algorithmes de regroupement dont l’objectif est de déterminer (relativement) rapidement le meilleur groupement possible en ce qui a trait à la précision des estimations obtenues29. L’utilisation de tels algorithmes pour identifier un meilleur regroupement que celui présenté dans le tableau 3 demande toutefois beaucoup de puissance computationnelle et dépasse le cadre de la présente note socioéconomique.
Le tableau 4 montre les différents ratios bénéfices-coûts avec leur intervalle de confiance respectif par catégorie de financement communautaire, par groupe de régions administratives et par période couverte pour l’analyse30. La partie supérieure du tableau 4 couvre les années 2010-2011 à 2022-2023 alors que la partie inférieure retranche la première année pour ne conserver que les années 2011-2012 à 2022-2023. Cette partie inférieure permet de constater que le retrait de cette première année rend tous les ratios bénéfices-coûts de la première colonne non significatifs sur le plan statistique. Cela est cohérent avec le fait que l’analyse différenciée par groupe nécessite l’introduction de beaucoup plus de variables dans le modèle comparativement à l’analyse agrégée, ce qui réduit la précision de tous les ratios estimés, notamment lorsque le nombre d’années utilisé pour l’analyse est diminué. Nous rappelons ici que d’augmenter le financement des organismes communautaires en SSS dans la plupart des régions du Québec risque de réellement réduire les dépenses de santé, notamment à court terme, mais il n’est pas possible de confirmer hors de tout doute raisonnable une telle intuition avec les résultats présentés aux tableaux 2 et 4 considérant l’imprécision des résultats.
De l’autre côté, la deuxième colonne du tableau 4 montre que d’augmenter le financement des organismes communautaires hors SSS diminue significativement les dépenses de santé dans les régions de Montréal, Laval, de la Montérégie et de l’Estrie, et ce, même si l’année 2010-2011 est retranchée de l’analyse. Une conclusion semblable peut être déduite à partir des résultats présentés dans la partie inférieure de la troisième colonne du même tableau. Toutefois, la partie supérieure du tableau 3 montre que d’augmenter le financement de tous les organismes communautaires est susceptible de réduire les dépenses de santé à travers toutes les régions du Québec, sauf dans l’Est du Québec où le ratio bénéfices-coûts n’est pas statistiquement différent de 1. Comme les ratios moyens ne changent pas beaucoup entre les deux parties de la troisième colonne, nous considérons comme crédibles les résultats présentés dans la partie supérieure du tableau 4. Autrement dit, augmenter de manière générale le financement des organismes communautaires risque de réduire les dépenses de santé dans toutes les régions du Québec de manière significative lors des six années suivantes. Ces résultats montrent aussi que les plus grandes réductions de dépenses sont susceptibles de survenir dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de l’Estrie. Il serait donc pertinent d’étudier davantage le travail des organismes communautaires dans ces régions afin de mieux comprendre pourquoi leur financement permet de réduire autant les dépenses en santé.
4. Discussion et conclusion
L’objectif de cette note socioéconomique était d’isoler l’effet du financement des organismes communautaires sur les dépenses en santé au Québec. Si cette question est en apparence simple, y répondre rigoureusement est néanmoins fort complexe. Plusieurs éléments influencent les dépenses de santé au fil du temps, que ce soit les innovations technologiques, l’évolution des salaires des médecins ou encore l’augmentation du nombre d’individus requérant des soins plus complexes et plus coûteux que les soins dits traditionnels.
Malgré de telles difficultés, les résultats obtenus dans la section 3.1 montrent que d’augmenter de 1 $ le financement des organismes communautaires permet, en moyenne, de diminuer les dépenses de santé au Québec d’environ 12,00 $ sur 6 ans. Ce résultat semble ne pas être influencé par la crise économique de 2008-2009, mais plutôt par la pandémie de COVID-19 où les économies moyennes générées par les organismes communautaires ont eu tendance à augmenter depuis le début de la pandémie. Ce résultat est substantiellement plus élevé que les ratios bénéfices-coûts obtenus en analysant l’incidence des dépenses de santé publique sur les dépenses de santé aux États-Unis31. Nous expliquons une telle différence par le fait que les organismes communautaires agissent principalement sur la qualité de vie des individus et les déterminants sociaux de la santé, ce qui est généralement plus efficace que les dépenses de santé publique afin de contrer la détérioration de l’état de santé des individus à court et long termes32.
Les résultats obtenus dans la section 3.2 montrent que les ratios bénéfices-coûts estimés sont susceptibles de varier à travers les régions administratives au Québec. En effet, si l’on se fie aux résultats obtenus dans la partie supérieure du tableau 4, le groupe de régions comprenant les Laurentides et Lanaudière présente le ratio bénéfices-coûts moyen le plus élevé pour le total des organismes communautaires (19,01), alors que le groupe comprenant les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine présente le ratio bénéfices-coûts moyen le plus faible (10,08). Néanmoins, il importe de rappeler que ces résultats peuvent être sous-
estimés en raison du phénomène de causalité inverse : une hausse prévue des dépenses de santé peut entraîner une augmentation des montants versés aux organismes communautaires, ce qui viendrait diminuer la taille des ratios bénéfices-coûts présentés aux tableaux 2 et 4.
Une telle hypothèse est validée, en partie, par la part importante du financement communautaire qui est consacrée à des ententes de services et à des projets ponctuels, ce qui est montré au graphique 6. Cette part atteignait presque la moitié du financement communautaire au début des années 2000. Elle est ensuite descendue à environ 35 % du financement communautaire total en 2006-2007 pour mieux remonter progressivement ensuite. Le financement par ententes de services et projets ponctuels est considéré comme étant beaucoup plus susceptible de varier selon la demande de soins dans le réseau de la santé, les ententes de services étant souvent caractérisées par un transfert de certaines tâches et responsabilités du secteur public aux organismes communautaires33.
Le graphique 6 montre aussi que les organismes œuvrant au sein de la mission SSS du MSSS ont reçu entre 13 et 30 % de leur financement grâce à des ententes de services ou à des projets ponctuels, ce qui est bien moins élevé que la moyenne des autres organismes communautaires. Cela signifie-t-il que l’endogénéité positive est moins forte dans ces organismes communautaires comparativement aux autres ? La réponse à cette question n’est pas forcément affirmative, car la nature des activités de ces organismes fait en sorte qu’ils peuvent offrir certains services semblables à ceux offerts au sein des établissements de santé, et ce, même sans entente de service ni projet ponctuel.
Une telle réalité rend très difficile l’isolement de l’effet causal réel d’une hausse du financement des organismes communautaires en SSS sur les dépenses en santé, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Malgré cela, nos estimations montrent tout de même que l’augmentation du financement des organismes communautaires en SSS engendre des réductions de dépenses de santé significatives à court terme, mais pas forcément à long terme. Nos résultats montrent aussi que c’est plutôt l’inverse qui survient lorsque le gouvernement augmente le financement des organismes communautaires hors SSS. De plus amples recherches sont nécessaires afin de confirmer ou d’infirmer de tels résultats. De plus amples recherches sont aussi nécessaires afin de mieux comprendre la nature des activités réalisées au sein des différents organismes communautaires au Québec, ce qui permettrait de valider jusqu’à quel point l’effet déversoir mentionné précédemment sous-estime les différents ratios bénéfices-coûts estimés dans cette note socioéconomique.
Finalement, nos résultats montrent qu’il est approprié d’analyser séparément les différentes catégories d’organismes communautaires pour mieux apprécier l’incidence respective de leur travail sur le système de santé et sur l’état de santé des individus. Plusieurs catégorisations supplémentaires pourront être réalisées dans le futur afin d’estimer la portée de certains types d’organismes communautaires sur les dépenses de santé et sur l’état de santé des populations. Nonobstant cela, nos résultats indiquent que de financer davantage de manière générale les organismes communautaires au Québec est un moyen efficace pour réduire la croissance des dépenses de santé autant à court qu’à long terme.
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Loi sur l’équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, Assemblée nationale du Québec, Québec, Éditeur officiel du Québec, 2024, www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-12.0001.
2 Daniel BOILY et Davide GENTILE, « Opération retour à l’équilibre budgétaire dans le réseau de la santé », Radio-Canada, 26 août 2024, ici.radio-canada.ca/nouvelle/2099304/sante-hopitaux-chsld-deficit-dube-quebec.
3 INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION SUR LA SANTÉ, Health Care Cost Drivers: The Facts, Ottawa, Institut canadien d’information sur la santé, 2011.
4 ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, La Réduction de la Maladie au Québec, Montréal, ASPQ, vol. 1, 2023.
5 Paula BRAVEMAN et Laura GOTTLIEB, « The Social Determinants of Health: It’s Time to Consider the Causes of the Causes », Public Health Reports, vol. 129, no 1, suppl. 2, 2014, p. 19-31; J. Michael MCGINNIS, Pamela WILLIAMS-RUSSO et James R. KNICKMAN, « The Case For More Active Policy Attention To Health Promotion », Health Affairs, vol. 21, no 2, 2002, p. 78-93.
6 RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (RQ-ACA), « L’action communautaire autonome », Montréal, Réseau québécois de l’action communautaire autonome, 2019, rq-aca.org/aca/.
7 J. Mac McCULLOUGH et Kevin CURWICK, « Local Health and Social Services Spending to Reduce Preventable Hospitalizations », Population Health Management, vol. 23, no 6, 2020, p. 453-458; Simone R. SINGH et J. Mac McCULLOUGH, « Exploring the Relationship Between Local Governmental Spending on the Social Determinants of Health and Health Care Costs of Privately Insured Adults », Population Health Management, vol. 25, no 2, 2022, p. 192-198.
8 Par hospitalisations évitables, on entend des hospitalisations qui auraient pu être évitées grâce à un meilleur accès aux soins de base ou grâce à de meilleures pratiques de prévention.
9 Andrew B BINDMAN, Kevin GRUMBACH, Dennis OSMOND, Karen VRANIZAN, Nicole LURIE et Anita STEWART, « Preventable Hospitalizations and Access to Health Care », JAMA, vol. 274, no 4, 1995, p. 305-311; Mehdi AMMI, Emmanuelle ARPIN, F. Antoine DEDEWANOU et Sara ALLIN, « Do expenditures on public health reduce preventable mortality in the long run? Evidence from the Canadian provinces », Social Science & Medicine, vol. 345, 2024, article 116696.
10 Stephen MARTIN, James LOMAS et Karl CLAXTON, « Is an ounce of prevention worth a pound of cure? A cross-sectional study of the impact of English public health grant on mortality and morbidity », BMJ Open, vol. 10, no 10, 2020.
11 Timothy Tyler BROWN et Vishnu MURTHY, « Do public health activities pay for themselves? The effect of county-level public health expenditures on county-level public assistance medical care benefits in California », Health Economics, vol. 29, no 10, 2020, p. 1220-1230.
12 Glen P. MAYS et Cezar B. MAMARIL, « Public Health Spending and Medicare Resource Use: A Longitudinal Analysis of U.S. Communities », Health Services Research, vol. 52, suppl. 2, 2017, p. 2357-2377.
13 « Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux – Rapports financiers annuels des établissements 2022-2023 », Ministère de la Santé et des Services sociaux, publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003608/ (consulté le 15 octobre 2024).
14 SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES SOCIALES (SACAIS), Répartition régionale du soutien financier gouvernemental en action communautaire, période de 2013-2014 à 2022-2023, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2024.
15 Michel MARSOLAIS, « Les groupes communautaires en grève lundi et mardi », Radio-Canada, 1er novembre2015, ici.radio-canada.ca/nouvelle/747466/greves-organismes-communautaires-fermetures-austerite-sous-financement-precarite.
16 Il aurait été souhaitable d’ajouter d’autres variables de contrôle, comme les taux de pauvreté ou la prévalence de certaines maladies chroniques par année-région, mais il n’a pas été possible d’obtenir ces données dans les délais souhaités. Certaines variables de contrôle ont aussi été retirées de l’analyse en raison de leur forte colinéarité avec d’autres variables présentes dans les modèles (p. ex., la densité populationnelle par région).
17 Abe DUNN, Scott D. GROSSE et Samuel H. ZUVEKAS, « Adjusting Health Expenditures for Inflation: A Review of Measures for Health Services Research in the United States », Health Services Research, vol. 53, no 1, 2018, p. 175-196.
18 Jeffrey M. WOOLDRIDGE, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2e éd., Cambridge, The MIT Press, 2010; Daniel MILLIMET et Marc F. BELLEMARE, « Fixed Effects and Causal Inference », SSRN Electronic Journal, 2023, www.ssrn.com/abstract=4467963.
19 Gary SOLON, Steven J. HAIDER et Jeffrey M. WOOLDRIDGE, « What Are We Weighting For? », The Journal of Human Resources, vol. 50, no 2, 2015, p. 301-316.
20 Isaiah ANDREWS, James H. STOCK et Liyang SUN, « Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice », Annual Review of Economics, vol. 11, no 1, 2019, p. 727-753.
21 Cette logique correspond à celle employée par Ammi et ses collaborateurs·trices (2024) afin de justifier le non-emploi de méthodes basées sur une ou des variables instrumentales, ainsi que l’imprécision généralement plus grande générée par de telles méthodes comparativement aux méthodes sans variable instrumentale.
22 La tendance décroissante représentée dans le graphique 4 signifie que les ministères autres que le MESS et le MSSS ont augmenté de façon importante leur financement communautaire au cours des 20 dernières années.
23 Voir l’annexe pour plus de détails à ce sujet.
24 Par souci de concision, les estimations associées aux variables de contrôle et aux effets fixes temporels n’ont pas été incorporées dans la présentation des résultats. Les résultats pour les variables de contrôle pour chacune des catégories d’organismes communautaires sont toutefois disponibles en annexe.
25 Le financement contemporain correspond à l’effet après une année (soit l’année en cours). Le financement retardé d’un an correspond alors à un effet deux années plus tard et ainsi de suite.
26 Nous considérons ici les effets à court terme comme étant les effets du financement contemporain jusqu’à ceux du financement retardé de deux ans. Les trois autres effets sont considérés comme des effets à plus long terme.
27 Changer l’année de référence pour le calcul des ratios bénéfices-coûts n’entraîne aucun changement important dans les ratios eux-mêmes.
28 Des ratios bénéfices-coûts qui sont statistiquement significatifs sont définis comme des ratios qui ne contiennent pas la valeur un (1) considérant que nous nous intéressons aux économies supplémentaires générées par le financement des organismes communautaires.
29 Stéphane BONHOMME et Elena MANRESA, « Grouped Patterns of Heterogeneity in Panel Data », Econometrica, vol. 83, no 3, 2015, p. 1147-1184.
30 Les résultats complets par groupe de régions sont disponibles sur demande auprès de l’auteur.
31 Timothy Tyler BROWN et Vishnu MURTHY, op. cit.; Glen P. MAYS et Cezar B. MAMARIL, op. cit.
32 Paula BRAVEMAN et Laura GOTTLIEB, op. cit.
33 Ce qui est de plus en plus décrié par les actrices et acteurs du milieu. Voir notamment : Mylène FAUVEL, « Les organismes communautaires et la lutte pour la survie de leurs pratiques et spécificités », Le Devoir, 13 septembre 2024, https://www.ledevoir.com/opinion/idees/819771/idees-organismes-communautaires-lutte-survie-pratiques-specificites.
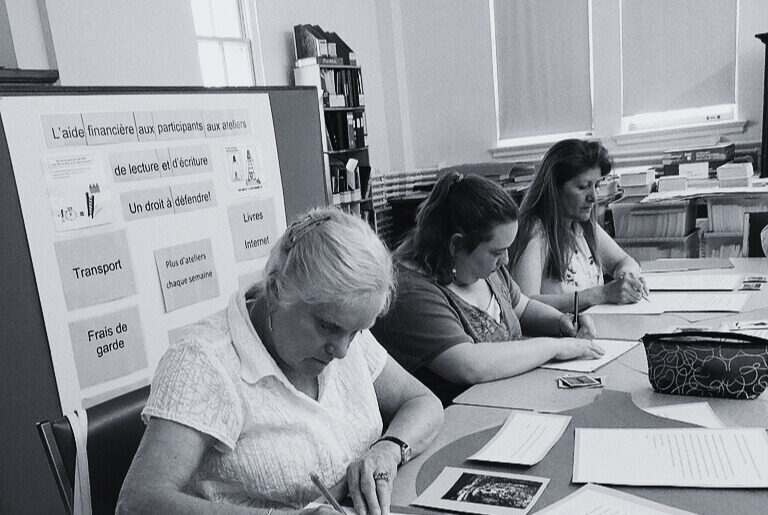
Photo: WikPSCMtl (Wikipédia)
Faits saillants
- Augmenter de 1 $ le financement des organismes communautaires au Québec permet, en moyenne, de générer des économies dans les dépenses publiques de santé d’environ 12,00 $ sur 6 ans.
- Les économies générées par les organismes communautaires œuvrant en dehors de la mission santé et services sociaux (SSS) ont tendance à augmenter avec le temps, surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19. Nos résultats montrent que c’est cependant l’inverse qui est observé pour les organismes communautaires dédiés aux missions santé et services sociaux.
- L’action des organismes communautaires œuvrant en dehors de la mission SSS entraîne elle aussi des réductions de dépenses de santé, quoi que plus tardives comparativement aux économies générées par les organismes œuvrant dans la mission SSS. Cela s’explique par le fait que ces organismes ont tendance à agir davantage sur les déterminants sociaux de la santé que sur l’état de santé lui-même.
- Nos résultats indiquent que de financer davantage de manière générale les organismes communautaires au Québec est un moyen efficace pour réduire la croissance des dépenses de santé autant à court qu’à long terme.
